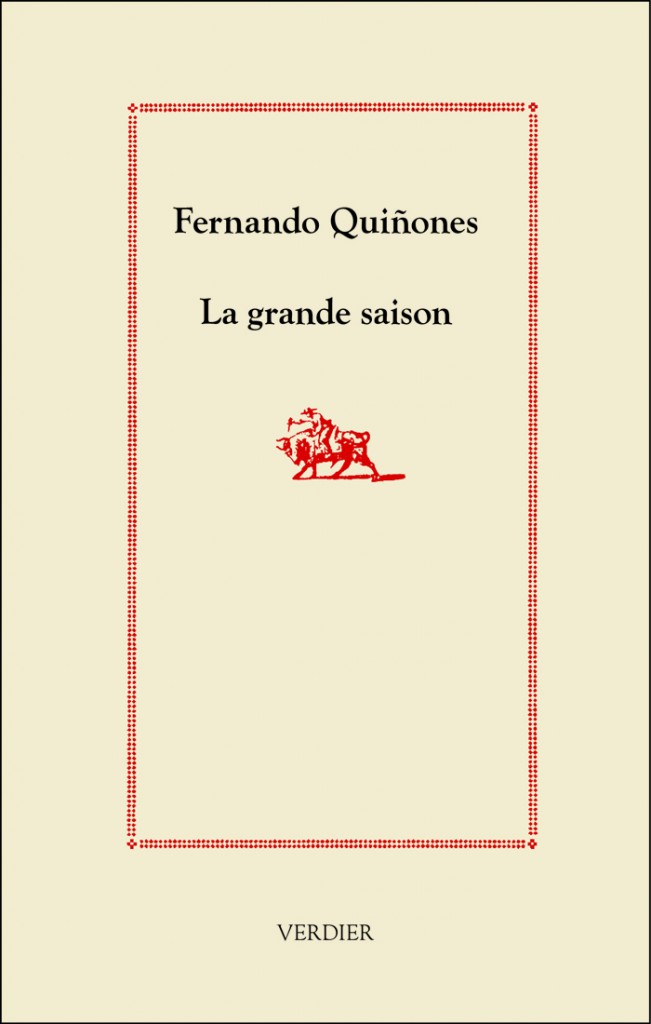
Fernando Quiñones
La grande saison
Nouvelles. Traduit de l'espagnol par Philippe Bataillon
Collection : Faenas
256 pages
15,01 €
978-2-86432-405-8
janvier 2004
Dans ces nouvelles dont la publication, en 1960, fut saluée par Ernest Hemingway, Fernando Quiñones fait un brillant détour en tauromachie. Cette collection de portraits d’humbles passionnés, de toreros au rencart, de cyniques margoulins des affaires taurines, ne laisse planer aucun doute : c’est dans ses marges que ce monde hors du commun se dit le mieux.
« Certainement, les applaudissements, les ornements et les lumières ne parviennent pas à conjurer les ombres, les solitudes, les ratages et, tôt ou tard, l’effondrement assuré des hommes », écrit-il dans la préface qu’il donna à une réédition.
Ils sont tous là, aficionados rongés par la passion, débutants tremblants dans l’angoisse étouffante du désir, ratés magnifiques qui jamais ne renoncent. Tous là, illuminés par la même clarté impitoyable de la passion sans partage. Car affronter un taureau, dit ici Quiñones, ce n’est pas réaliser un exploit sportif, ce n’est pas venir à bout de sa peur, pas même faire œuvre artistique, mais bien chercher passionnément les clés d’un mystère qui vous dépasse.
Il ressentait sa confiance nouvelle venue comme une tiédeur décontractée, libératrice et bien répartie dans son corps tout entier : ce quatrième toro, blanc taché de noir, et qui dès qu’il l’avait reçu dans le premier cercle, à la cape, lui avait si vilainement envoyé des coups de tête sur la gauche, semblait maintenant corrigé par les trois piques de Pucherete, le picador, et n’était plus qu’un être de simple circulation, de passage, non d’agressivité désordonnée et dolente. Tout cela était arrivé – l’homme ne savait pas comment – quelques secondes plus tôt et tout ce qui allait se passer après cet avènement imprévisible de son courage et de sa confiance serait aisance et liberté créatrice offertes comme un pur supplément, un simple régal, le prolongement de ce courage et de cette confiance. Il ne pensait pas cela mais néanmoins il le savait : rude et donnant des coups de corne pendant les passes d’approche et l’aidée, le toro avait ensuite complètement changé et lui, installé dans l’affrontement même des deux créatures en lutte, l’avait vu changer tout d’un coup et de manière aussi nette et instantanée qu’on voit un nuage passer du gris au doré sous un rayon de soleil. À la sortie de l’aidée par le haut, le toro vira sur ses sabots et attaqua la muleta sans ralentir. Mais sa corne gauche ne cherchait plus à frapper ; la tête (qui avec ce changement favorable ressemblait soudain à un crâne monté sur un chariot d’entraînement, obéissant enfin à l’élan rectiligne de son conducteur) ne recommença pas à se jeter ni vers le haut ni vers la gauche en occupant l’espace, pour chercher des cornes tout ce qu’elle pouvait atteindre. Et tout se passa alors comme si la main gauche de l’homme, qui subjuguait à nouveau le toro, devinait ce changement en recommençant à bouger, et l’homme n’avait plus qu’à suivre l’instinct de cette main, où qu’elle voulût aller et à son rythme, et derrière elle, harmonieusement, le bras et la taille, calme voyage, attentifs seulement à le contrôler, le corps à la distance exacte, sans le plus léger pas en arrière mais sans fanfaronner en serrant le toro : la vie à sa place et la mort à la sienne.