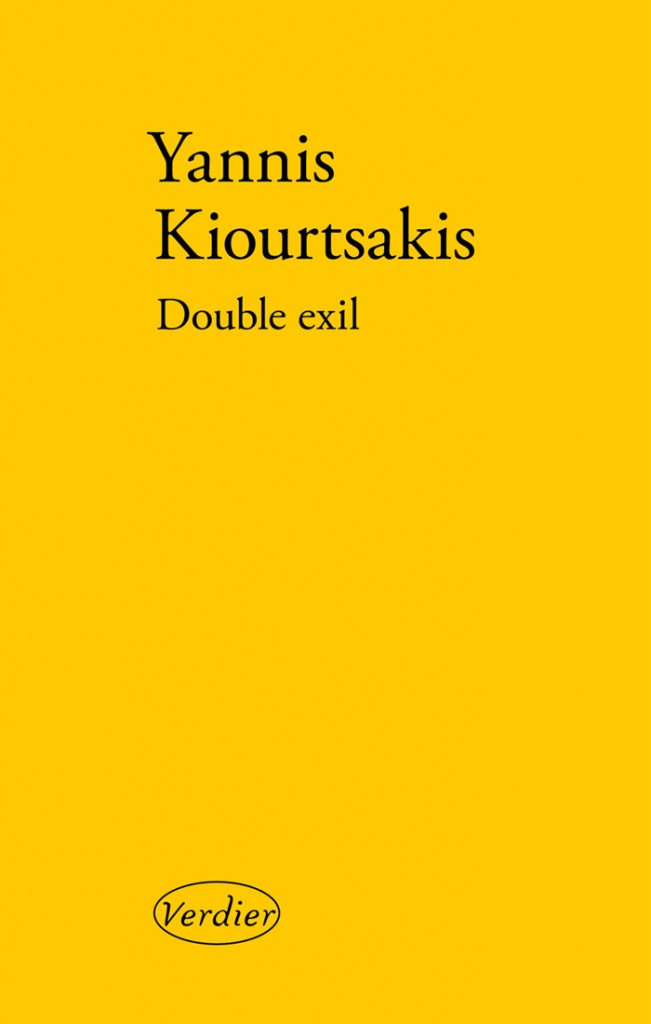
Yannis Kiourtsakis
Double exil
Roman. Traduit du grec par René Bouchet
Collection : Littérature grecque
336 pages
21,50 €
978-2-86432-748-6
janvier 2014
Double exil est le second volet de la grande trilogie romanesque de Yannis Kiourtsakis dont la traduction du premier volume, Le Dicôlon, a été remarquée par la critique.
L’auteur revendique fermement d’avoir écrit un roman, en même temps qu’il ne nie pas sa dimension biographique. Le récit est rédigé à la troisième personne, sans masquer pour autant que le héros et l’auteur du livre précédent ne font qu’un.
Ce « dédoublement » est le signe sous lequel est placée la totalité de l’œuvre de Kiourtsakis : on se souvient que, dans Le Dicôlon, le centre de gravité de la narration était occupé par la relation complexe du narrateur avec son frère aîné dont le suicide était pour lui une énigme à élucider.
Dans Double exil, Yannis Kiourtsakis quitte la Grèce pour venir, comme son frère, étudier en Europe : il choisit Paris et la faculté de droit ; il y rencontre une Française, Gisèle, sa future épouse. Le roman les accompagne à travers les années sombres de la dictature des colonels (1967-1974), puis au temps des premières années du retour du pays à la démocratie, avec l’avènement de la République.
Si l’exil est double, pour le héros de ce livre, c’est qu’il se découvre deux patries – la France s’ajoutant à la Grèce – sans appartenir pleinement à l’une ni à l’autre.
Mais l’écriture opère chez le romancier une métamorphose qui, pour finir, fera de lui un écrivain grec trouvant dans les mythes populaires de son pays un moyen de se comprendre.
Comme à la fin de la Recherche, le héros entrevoit soudain ce que sera son futur livre.
À compter de ce soir-là, la Grèce était devenue pour lui un conte, un conte sans fin qu’il composait surtout pour elle, à l’aide de tous ses souvenirs, mais plus encore de la nostalgie et de l’imagination, pour combler ses trous de mémoire. Comme s’il avait quitté la Grèce encore enfant et ne pouvait se la rappeler que vaguement. Mais n’était-ce point le cas, après tout ? N’avait-il pas vécu son adolescence si confiné dans son cocon que, tel un petit enfant, il ne s’était quasiment pas aperçu de ce qui se passait autour de lui, comme s’il en avait été absent par l’esprit ? Et voilà qu’à présent il en était absent physiquement. Après la disparition de Haris, il avait entamé une vie nouvelle et rompu tous les fils qui l’attachaient à l’ancienne – du reste, il n’avait plus « là-bas » aucun ami ; il ne correspondait avec personne. Et ici, à Paris, il ne voyait aucun Grec en dehors de Vassilis – qui avait, lui aussi, plus ou moins coupé les ponts avec la Grèce. Il y avait deux ans qu’il n’avait plus rien lu, plus rien écrit en grec ; il ne s’était occupé de rien qui eût un rapport avec la Grèce. Qu’est-ce qui le rattachait encore à cette lointaine patrie ? Rien d’autre, croyait-il, que sa mère et sa maison qui l’y attendaient toujours.
Mais à présent il ne cessait de penser à la Grèce – quand ses connaissances empiriques sur ce pays étaient incertaines, il n’hésitait pas à l’inventer, à le fabriquer à partir du matériau que ses nouvelles lectures lui fournissaient (il s’était mis soudain à dévorer tous les écrits relatifs à la Grèce qui lui tombaient sous la main). Aussi était-il libre d’en composer l’image qu’il souhaitait, dont il avait besoin.
Et la Grèce prenait en lui la forme d’une vision lointaine, inaccessible : un pays immaculé et lumineux ; un rivage désert sous un ciel limpide ; un matin clair, un matin grec comme les autres – qui pourtant devait être à tout jamais le premier matin du monde.
Le Monde des livres, 24 janvier 2014, par Florence Noiville
« Carnet nomade », France Culture, par Colette Fellous, 31 mai 2014, de 20 h à 21 h