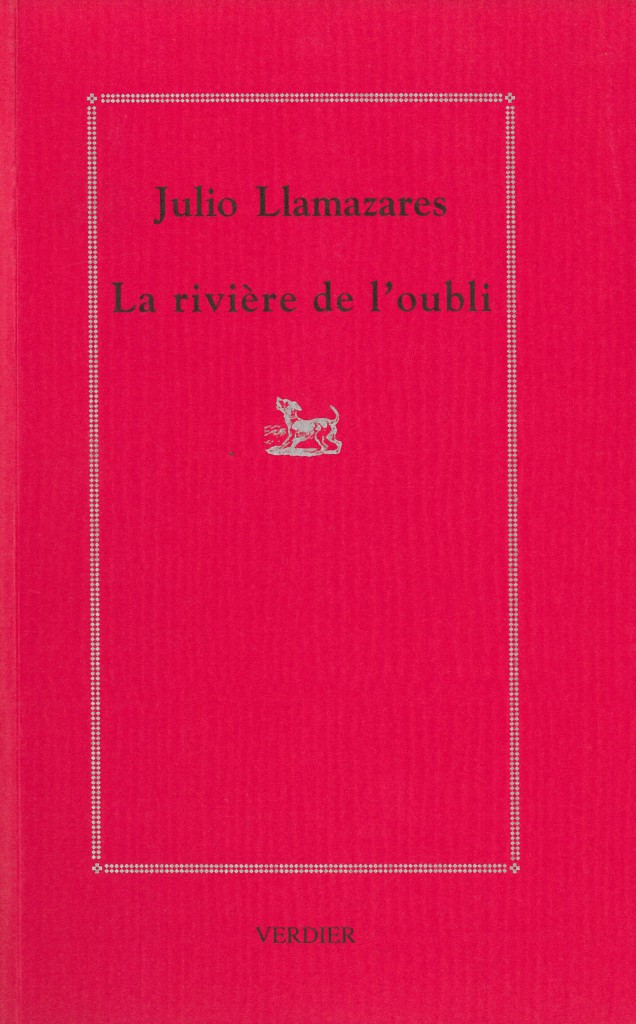
Julio Llamazares
La rivière de l’oubli
Voyage. Traduit par Jean-Baptiste Grasset
Collection : Otra memoria
224 pages
18,56 €
978-2-86432-139-2
janvier 1992
C’est aux sources du Curueño que nous emmène le voyageur – le retour au décor de l’enfance n’est-il pas le plus surprenant des dépaysements ? Il remonte à pied, en six jours, le cours que le torrent s’est taillé à grand-peine dans les montagnes sauvages de León.
Ce récit plein d’un charme désinvolte surprendra les lecteurs de Julio Llamazares que celui-ci n’avait guère habitués à ce ton si allègre, à cette espièglerie d’un promeneur amoureux qui passe avec aisance de l’humour à l’émotion.
Figures hautes en couleurs, paysages sublimes, rêveries et souvenirs, aléas du chemin et histoires du passé tissent l’épaisseur de ce parcours qui rejoint toutefois, sans en avoir l’air, les tensions profondes qui habitent l’œuvre.
Les chiens d’Aviados
Quand le voyageur atteint Aviados, l’horloge de l’église a depuis longtemps sonné une heure. Les rues du hameau sont désertes, silencieuses, esseulées sous le clair de lune et, derrière les fenêtres, les habitants sont depuis longtemps endormis, à l’ombre des ruines du château.
Malgré cette solitude, le voyageur entre dans Aviados avec discrétion. Non qu’il craigne d’être vu déambulant à pareille heure dans le village, ni qu’il croie (comme certains) que, par les nuits de lune comme celle-ci, l’ombre d’Al-Mansur erre solitaire à cheval en quête du trésor que, selon la légende, il aurait caché dans un fossé de ce château par lui-même détruit lors d’une de ses immenses chevauchées qui semaient la terreur à travers l’Espagne. La discrétion du voyageur vient simplement du fait qu’Aviados se trouve dans la montagne, loin de l’embranchement, et qu’il sait par expérience que dans ces villages-là, les chiens ne reçoivent généralement pas les voyageurs de la meilleure façon, surtout la nuit. Mais, en dépit de sa discrétion, les gardiens d’Aviados ne tardent guère à le repérer. Le voyageur n’a pas fait quatre pas dans le village que déjà tous les chiens aboient en chœur à chaque coin de rue, à chaque portail de maison.
Pourtant, aucun d’eux ne s’approche en montrant les dents pour essayer de lui barrer le passage. Le voyageur voit leurs yeux briller dans l’ombre des maisons, les entend qui le suivent en grondant, mais il traverse tout le village sans qu’aucun ne manifeste l’envie ou le courage de l’approcher. En revanche, ils ne cessent pas un instant d’aboyer. Ils aboient dans les cours, devant les portes, aux barbelés des potagers, près du lavoir de la place. Ils aboient comme si c’était le fantôme même d’Al-Mansur qui à cette heure, errant sur son cheval, avançait dans Aviados. Et déjà quelqu’un, quelque part, répond à ces aboiements, de la lumière apparaît dans une des maisons de la place, aussi le voyageur écrase sa cigarette, retourne sur le chemin et, sur le quai de la voie ferrée où il a laissé musette et sac à dos avant de monter, il s’allonge dans un coin, sur le ciment glacé, pour s’endormir du paisible sommeil des justes et retrouver les fantômes de ses rêves, loin des aboiements et des ombres des chiens d’Aviados.