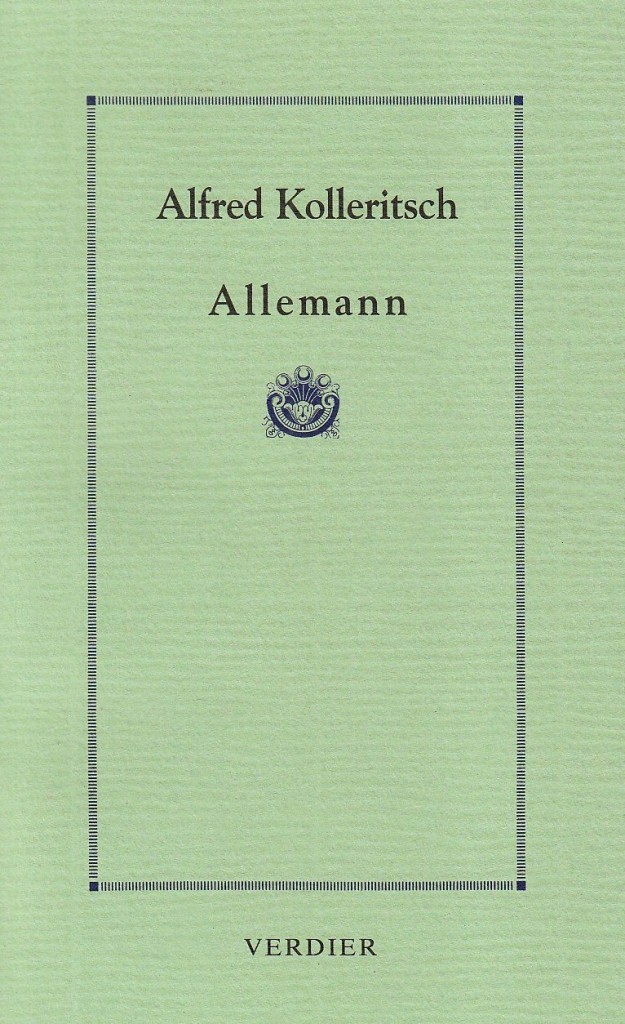
Alfred Kolleritsch
Allemann
Roman. Traduit de l’allemand (Autriche) par Claude Proriol
Collection : Der Doppelgänger
192 pages
14,70 €
978-2-86432-231-3
octobre 1996
Arraché à son village natal et à sa famille alors que la guerre fait rage et que l’idéologie national-socialiste règne, semble-t-il sans partage, investissant la plupart des consciences sans rencontrer de résistance, le jeune Josef est admis dans un lycée d’une grande ville d’Autriche et se retrouve bientôt confié à un foyer où la discipline et l’endoctrinement sont plus sévères encore que partout ailleurs. Au milieu du trouble général qui pousse les élèves à rechercher dans l’exercice solitaire ou collectif de la sexualité l’espace de liberté qu’on leur refuse, l’un des éducateurs, Allemann, se distingue par une attitude peu conforme à sa fonction et par une forme de résistance marginale qu’il paiera de sa vie.
Aucun romancier n’a su décrire comme Alfred Kolleritsch la réalité quotidienne au temps du nazisme, vue par les yeux d’un enfant pris en otage par un système qui lui répugne mais auquel il ne peut se soustraire. Faisant alterner les mois passés en ville et les retours au village natal dominés par la figure d’un grand-père qui, lui aussi, résiste à sa manière à l’esprit du temps, et par celle d’une déportée polonaise dont la douceur et les paroles sont une promesse d’avenir plus humain, ce roman en forme d’exorcisme reconstitue avec une intense sobriété l’itinéraire affectif et intellectuel d’un jeune garçon qui apprend à chercher en lui-même les forces qui lui permettront de triompher malgré tout de la « vérité » qu’on veut lui inculquer.
Josef remarqua qu’Allemann était le seul à être encore entouré d’un reste d’affection. Cette affection, les élèves la lui manifestaient en le martyrisant. Ils se vengeaient sur lui des sacrifices qu’ils avaient subis. Il avait une voix si douce que ses ordres n’étaient jamais respectés. Leur affection le mettait à la merci du danger. Ils le compromettaient, attiraient l’attention du directeur sur le fait qu’un éducateur pût ne pas être comme les autres. Et de ce point de vue, il était le seul. Ils lui manifestaient leur confiance en le déstabilisant autant qu’ils le pouvaient. Ils lui racontaient tout, comme à un confesseur dont on se sert pour avouer, une fois au moins, ses péchés. Il était asexué comme un prêtre. On n’attendait de sa part aucun sentiment. Josef savait que, le dimanche, Allemann partait avec tel ou tel élève et l’accompagnait chez ses parents. C’était une façon de leur montrer l’aspect humain du foyer.
Le « costaud » n’avait plus jamais invité Josef à venir dans l’autre dortoir assister aux séances collectives. Josef avait acheté des préservatifs qu’il avait cachés dans son portefeuille. Il en offrit un, dans un état d’excitation extrême, au petit ami de l’infirmière. Maintenant, quand il rencontrait l’infirmière, il avait le sentiment de partager quelque chose avec elle, il avait touché quelque chose qu’elle avait ensuite senti. Au dortoir, il était de plus en plus fréquent de voir des élèves se mettre ensemble au lit, surtout à la suite des exercices d’alerte qui leur tombaient dessus à l’improviste. Ils se donnaient de la chaleur, sans un mot. Ils fermaient les yeux malgré l’obscurité, comme pour oublier qui était allongé à leur côté. Ils se sentaient à tour de rôle homme ou femme, mais ils auraient tous préféré être femme. Les exercices les plus audacieux sur le terrain, les compétitions sportives les plus ambitieuses, l’entraînement militaire poussé à l’extrême et les messages d’horreur ou de gloire qui tombaient, rien ne diminuait leur envie de s’offrir cette vie parallèle, pour ainsi dire séparée de leur vie. Ils sentaient monter en eux un chant qu’ils ne comprenaient pas, qu’ils contenaient pendant la journée à coup d’obscénités – leur part de vie éveillée, celle qui échappait au camouflage, était d’ailleurs de plus en plus rude. Ils s’armaient de matraques qu’ils cachaient dans leurs culottes de golf. Ils sectionnaient à la lame de rasoir les tuyaux d’arrosage installés dans les jardins du Schlossberg, dont les galeries leur offraient un abri qui résistait à la menace venue du ciel. Ils introduisaient dans le tuyau des osiers coupés de frais. Le dimanche, ils s’attaquaient à d’autres garçons ou se bagarraient avec des bandes sur le Schlossberg. Ils marchaient d’un pas plus ferme lorsqu’ils se rendaient aux rassemblements de partisans. Ils effrayaient les vieilles femmes, leur parlaient de l’horreur des bombes, et semaient la panique en leur racontant qu’ils venaient d’entendre un message annonçant des bombardements. Ils se réjouissaient de la fréquence de plus en plus rapprochée des alertes aériennes. Ils faisaient des accrocs au règlement. Quand l’alerte était donnée à l’avance, ils quittaient l’école en toute hâte pour rentrer chez eux, ou se rendaient dans les galeries du Schlossberg où ils pouvaient traîner sans crainte. L’alerte aérienne, les bombardiers dans le ciel, l’éclat des grenades antiaériennes et les longues raies de lumière des projecteurs à la recherche des avions étaient devenus l’instance suprême. Face à elle, tous les professeurs, éducateurs, directeurs et autres hauts fonctionnaires n’avaient aucun pouvoir.
L’alerte aérienne procurait une curieuse sensation de liberté. Après les orages, la pluie, la neige et les nuages, arrivaient les avions, le bourdonnement et le grondement des moteurs qui faisaient trembler les vitres aux fenêtres. Maintenant, la plupart avaient à nouveau le sentiment de faire vraiment partie de l’ensemble de la nation. Ce sentiment donnait à nouveau l’énergie de se battre, renforçait le désir de consacrer l’ensemble de ses forces à résister.
Josef croyait savoir à quel moment ils se contentaient de suivre le mouvement et à quel moment ils s’en écartaient. Mais qui ne le croyait pas ?
Prix France Culture de littérature étrangère, 1997