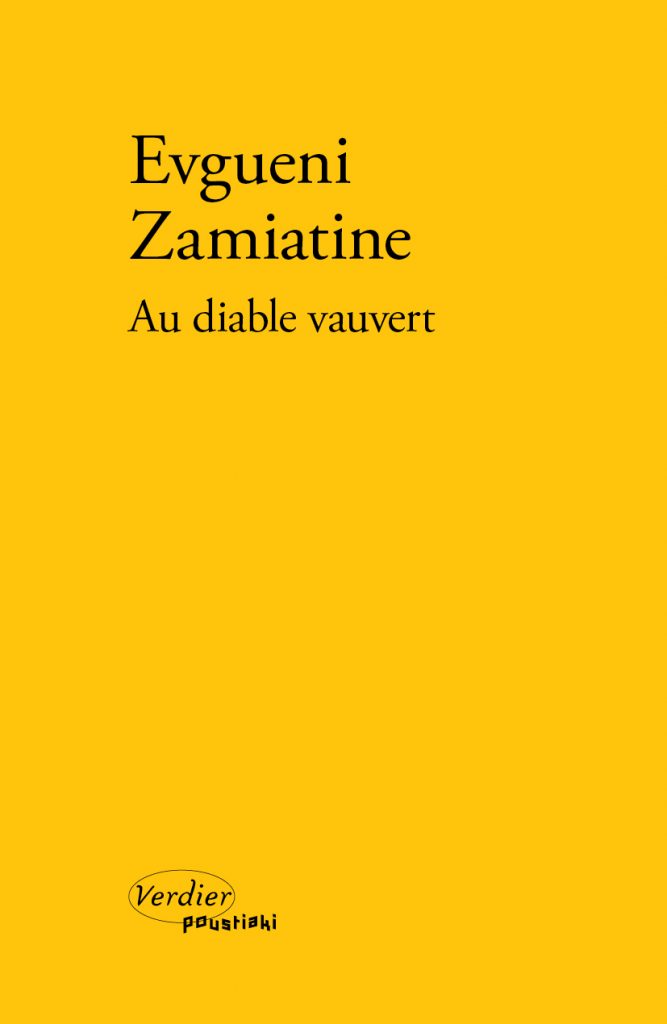
Evgueni Zamiatine
Au diable vauvert
Traduit du russe par Jean-Baptiste Godon
Collection : Poustiaki
192 pages
12,68 €
978-2-86432-458-4
janvier 2006
Les deux récits présentés ici, Au diable vauvert (1914) et Alatyr (1915), offrent le tableau d’une Russie provinciale, burlesque et colorée, à la veille du cataclysme de la Première Guerre mondiale pour l’un, et de l’apocalypse révolutionnaire pour l’autre.
Historiquement daté – les allusions à l’Alliance franco-russe permettent d’en situer l’action entre 1892 et 1914 –, Au diable vauvert est dépourvu d’indications topographiques précises. Il évoque le quotidien d’un détachement militaire quelque part aux environs de la frontière chinoise, du côté de la mer du Japon, en un lieu accessible uniquement par la mer. La Censure devait interpréter ce récit comme une « image profondément insultante des officiers russes ».
Alatyr, ville inventée dont le nom est aussi celui de la pierre légendaire des contes russes, vient compléter l’exploration imaginaire de l’ancienne Russie effectuée par l’auteur. Paradis originel qui, bien souvent, s’apparente à un enfer, la cité d’Alatyr est peuplée de bêtes craintives ou sauvages. La Censure reprochera à Zamiatine d’y avoir campé des personnages « qui n’ont pas figure humaine ».
Evgueni Zamiatine est perçu par nombre de ses contemporains, dès la parution de ses premiers récits, comme un nouveau Gogol, ce qui ne doit rien au hasard. En effet, à travers les plaisanteries grasses des soldats d’Au diable vauvert ou les rêves des jeunes filles d’Alatyr, Zamiatine fait rire, de même que Gogol dans Les Âmes mortes. Mais l’auteur qui, de son propre aveu, souffre d’hérésie chronique et tient la vie pour une tragédie, rappelle à la fin de chaque récit que son rire est avant tout une politesse du désespoir.
Cet ouvrage a reçu le Prix Russophonie 2007 pour la traduction.
Ce n’était pas pour rien que le lieutenant Tikhmen avait roulé sous la table : il était acculé. Tikhmen avait une maladie : penser. Or, sous nos latitudes, c’est une maladie grave. Mieux vaut encore écluser de la vodka en se regardant dans la glace, mieux vaut encore taper le carton du soir au matin. Tout sauf penser.
Les bonnes gens le lui avaient bien dit, mais il n’en faisait qu’à sa tête. Il avait beaucoup lu et en avait, bien sûr, tiré des conclusions : « Tout, disait-il, en ce bas monde n’est que reflet de ma conscience, perceptions, fruit de mon libre-arbitre. » En voilà, une nouvelle : et le capitaine Netchessa, il en avait, lui, un libre-arbitre ? Peut-être que le général lui-même en était pourvu ?
Mais il était comme ça, Tikhmen : lorsqu’il s’était mis quelque chose dans le crâne, il s’enferrait. Il se complaisait dans le mépris du monde, de la gent féminine, de l’élevage infantile : c’est ainsi que Tikhmen parlait d’amour. Les enfants, justement, il les aimait comme un chien aime le bâton :
« … De grâce, que me contez-vous là ? Moi, je vous dis que les parents sont des crétins, des carassins qui mordent à l’hameçon, parfaitement ! Ces prétendus enfants sont à l’homme ce qu’un boulet… ce qu’un boulet est à la marche. C’est la camarde à quatre pattes… un flétrissement, une mise à la casse, que c’est pour les parents… Du reste, puisque vous riez messieurs, eh bien, allez au diable ! »
Mais comment ne pas rire quand le nez de Tikhmen était si long et si tordu sur la gauche, et quand il agitait les bras comme un moulin à vent. Comment ne pas rire alors que Tikhmen ne jouait les grands sceptiques que lorsqu’il était à jeun, mais à peine se mettait-il à boire… Car ici, à l’écart, dans la souricière et, Dieu me pardonne, au diable vauvert, était-il possible de ne pas boire ?
À chaque fois qu’il était ivre, le dédaigneux Tikhmen se changeait en idéaliste : comme au paradis originel, le tigre et l’agneau se fondaient à merveille dans son âme russe.
Ivre, Tikhmen se mettait immanquablement à rêver : un château, une belle dame vêtue d’une robe bleu argenté et, face à elle, le chevalier Tikhmen, la visière baissée. Le chevalier à la visière… c’était bien plus commode ainsi, car grâce à la visière, Tikhmen pouvait enfin cacher son nez, ne laisser voir que ses lèvres, en un mot, être beau. Là, à la lumière des flambeaux, s’accomplissait le miracle de l’amour, et le temps passait si vite qu’apparaissaient déjà les jolies têtes blondes.
Cependant, à nouveau sobre, Tikhmen se traitait lui-même de crétin et de carassin avec la même ardeur qu’il mettait à maudire son prochain, et s’emplissait d’une haine plus grande encore pour ce concept qui joue de si mauvais tours aux hommes et que ceux-ci appellent négligemment « coquin de sort ».
Il y a un an… Oui, c’est cela : près d’un an déjà s’était écoulé depuis le jour où ce coquin de sort s’était si lâchement joué de Tikhmen.
C’était pendant les fêtes de Noël, ces fêtes absurdes, imbéciles, arrosées à l’extrême comme elles l’étaient ici. Le soir de Noël, le lieutenant Tikhmen, rassasié de civilités, repu d’alcool, était rentré chez lui à la tombée de la nuit, la visière baissée.
Le capitaine Netchessa était absent, l’ordonnance Lomaïlov avait couché la marmaille depuis longtemps déjà. Seule devant une appétissante table de fête, la femme du capitaine Netchessa languissait : les jours de fête sont souvent aussi tristes que des lendemains de fête.
Le chevalier Tikhmen avait baisé la main de la belle dame avec une galanterie inaccoutumée. Puis, en avalant le morceau de volaille qu’elle lui tendait, il avait prononcé ces mots :
« Comme je suis heureux qu’il fasse nuit !
— Et pourquoi donc ? »
Si Tikhmen avait été sobre, il se serait contenté de dire, en guise de politesse : « Parce que la nuit, tous les chats sont gris. » Mais le chevalier Tikhmen avait déclaré :
« Parce que la nuit nous révèle ce qu’il y a de magnifique et d’invisible à la lumière du jour. »
C’était du goût de la capitaine : elle avait joué de ses innombrables fossettes, secoué ses boucles rondes et lancé ses atours sur Tikhmen.
Le Monde, 28 avril 2006, par Philippe-Jean Catinchi
Numéro, mars 2006, par Sean James Rose
Libération, 2 février 2006, par Jean-Pierre Thibaudat
Le Figaro, 19 janvier 2006, par Sébastien Lapaque
L’Humanité, 19 janvier 2006, par Alain Nicolas
La Liberté, 4 janvier 2006, par Alain Favarger
Livres hebdo, 9 décembre 2005, par Jean-Maurice de Montremy
Les Carnets d’études, juin 2006, par Agnès Passot
« Les Mardis littéraires », France Culture, mardi 4 avril 2006