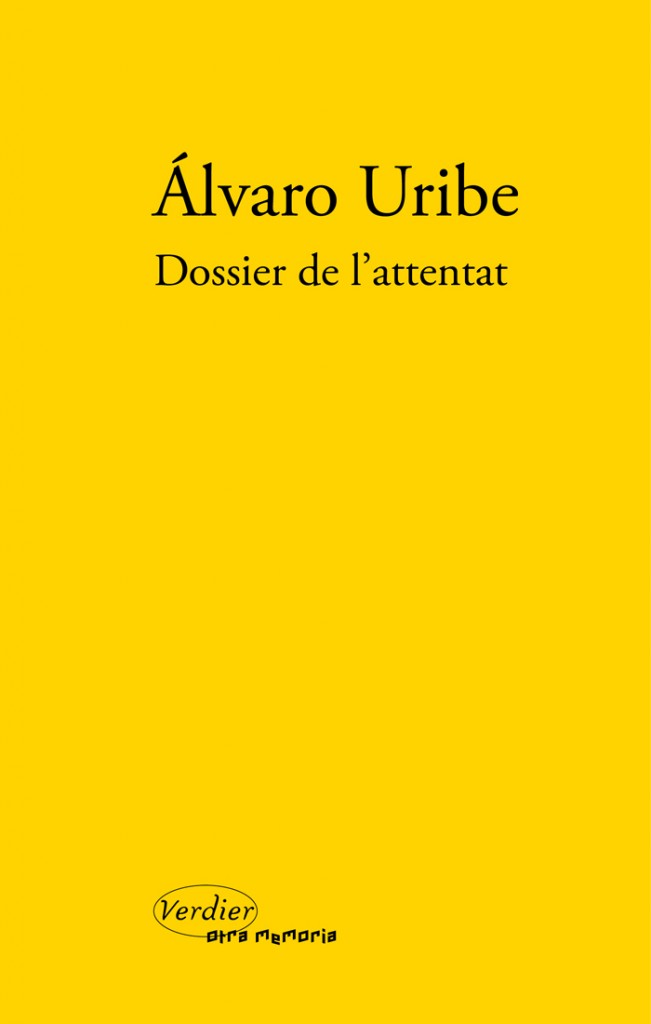
Álvaro Uribe
Dossier de l’attentat
Roman. Traduit de l’espagnol (Mexique) par Marie Córdoba
Collection : Otra memoria
192 pages
15,72 €
978-2-86432-569-7
février 2009
Qui a voulu tuer Porfirio Díaz : un fou, un ivrogne, un anarchiste ? Le saura-t-on jamais, puisque l’agresseur, Arnulfo Arroyo, est mort quelques heures plus tard lynché dans les locaux de la police. Mais qui l’a éliminé ? La foule en colère – comme on veut le faire croire – ou un groupe de sbires ? Et dans ce cas, quelle est la main secrète qui a armé les tueurs ? D’ailleurs, au final, a-t-on vraiment voulu assassiner le président ou s’agit-il d’une manipulation qui a échappé à ses propres instigateurs ? Mille questions agitent la société mexicaine en ce dernier trimestre de l’année 1897, après l’attentat raté qui a marqué le défilé du jour de l’Indépendance… Dossier de l’attentat, inspiré d’un événement réel, permet à Álvaro Uribe de composer une intrigue politico-policière haletante qui portraiture avec brio la vie à Mexico entre deux siècles, dans un voyage qui part de la plus grossière des cantinas, où on boit comme on respire, pour aboutir au palais présidentiel. Chronique qui met à jour l’opacité manœuvrière entourant le régime de Porfirio Díaz, le roman évoque aussi clairement, en manière d’apologue, le Mexique au présent : l’enchevêtrement des réseaux de pouvoir, le rôle de la presse, l’action de la police et le poids de la raison d’État.
Il se serait contenté de sentir ses jambes et son dos s’étirer dans cette confortable position. Mais Antonio Milanés n’avait pas fini d’alléger les conditions de son emprisonnement et il versait maintenant dans un verre transparent le contenu incolore d’une carafe. Pendant que son bienfaiteur l’aidait à se redresser pour lui donner à boire comme à un malade, Arnulfo Arroyo désira brièvement sentir dans sa bouche le goût âpre de l’alcool. À son grand étonnement, il trouva aussi agréable, voire plus, que le liquide frais qui humidifiait son bâillon et coulait dans sa gorge fût simplement de l’eau.
Antonio Milanés poussa la bienveillance jusqu’à lui offrir une cigarette, l’allumer lui-même avec le briquet qu’il avait dans une poche et la lui tenir entre les lèvres chaque fois qu’il aspirait. Gêné par la corde qu’il mâchait avec impuissance, Arnulfo Arroyo fuma avec délectation. Il était littéralement ému jusqu’aux larmes. Quand il sentit qu’il ne pourrait plus les contenir, il simula une violente quinte de toux. Il ne voulait pas donner à Milanés la moindre raison de croire que c’était le repentir, ou pire encore la peur, qui le faisait pleurer.
Il secoua la tête et remua les lèvres derrière son bâillon pour demander une autre cigarette, puis une troisième. Tous deux fumèrent en silence pendant un bon moment. Quand douze coups sonnèrent à la cathédrale voisine, Antonio Milanés baissa la mèche de la seule lampe qui était encore allumée jusqu’à réduire la lumière de moitié. À travers la fumée qui augmentait la pénombre du salon, Arnulfo Arroyo crut voir que l’autre gendarme, assis contre le mur alors qu’il y avait plusieurs fauteuils, semblait somnoler. Son ami avait également dû remarquer que personne ne les voyait ni ne les entendait, car il osa alors lui adresser la parole.
— La vie est drôlement faite, dit Antonio Milanés dans un murmure à peine audible. Tu as toujours été le meilleur de nous deux. Le plus beau. Le plus intelligent. Celui que tout le monde préférait. Et regarde où tu en es aujourd’hui. Moi j’étais le laid. Le niais. Le mal-aimé. Et voilà que maintenant, ta vie vaut moins que la mienne.
Arnulfo Arroyo, bien qu’engoncé dans la camisole de force, réussit à hausser les épaules pour admettre avec philosophie qu’en effet la vie était drôlement faite.
— Qu’est-ce qui t’est arrivé, Fito ?, poursuivit Antonio Milanés, utilisant ce diminutif qu’Arroyo détestait. Comment est-ce que tu as pu vouloir faire du mal à monsieur le président ? Tu imagines ce que deviendrait ce pauvre pays sans lui ?
À moitié assis pour faire face à Antonio Milanés, Arnulfo Arroyo essaya de lui dire que Porfirio Díaz méritait mille fois la mort. Il essaya de lui dire que le Mexique devait apprendre à vivre sans caudillos. Il essaya de lui dire que tôt ou tard quelqu’un d’autre viendrait terminer ce que lui avait commencé. Mais le bâillon, même distendu, l’empêchait de parler clairement.
Arroyo essayait de faire comprendre ses balbutiements inintelligibles quand Milanés, lui couvrant la bouche d’une main énergique, l’obligea à se taire. Tous deux se tournèrent en même temps vers la porte des bureaux de l’hôtel de ville, qui s’ouvrit brutalement dans un fracas de vitres cassées. Tout de suite après, on entendit une voix véhémente :
— C’est par ici, les gars. Vite !
Entre les jambes d’Antonio Milanés, qui s’était redressé d’un bond, Arnulfo Arroyo vit plusieurs hommes entrer à la hâte. Ils devaient être six, peut-être bien sept, même si le tumulte faussait les comptes. Mais tous avaient le bas du visage caché par un foulard qui ne découvrait que leurs yeux. Ils portaient tous des chapeaux enfoncés jusqu’aux sourcils. Ils étaient habillés de vêtements civils tout ce qu’il y a de plus banal. Et comme le devina Arroyo dans la pénombre alors qu’il s’appuyait sur le bras d’un fauteuil pour se mettre debout, ils brandissaient tous des couteaux : de grossiers couteaux de cuisine sur les lames desquels se reflétait la faible lumière de la seule lampe allumée.
L’Humanité, 19 mars 2009, par Alain Nicolas
La Croix, 12 mars 2009
Nouvelobs.com, 12 mars 2009, par Jennifer Richaud
La Lettre du libraire, 12 mars 2009
Page des libraires, mars 2009, par François Reynaud, Librairie Lucioles (Vienne)
Le Magazine littéraire, mars 2009, par Pierre Assouline
Livres hebdo, 30 janvier 2009, par Jean-Maurice de Montremy
« Le Choix des livres », par Céline Geoffroy, France Culture, vendredi 20 mars 2009.
« Un livre, un jour », par Olivier Barrot, France 3, mardi 17 mars 2009.
« La Fabrique de l’histoire », par Emmanuel Laurentin, France Culture, vendredi 6 mars 2009.