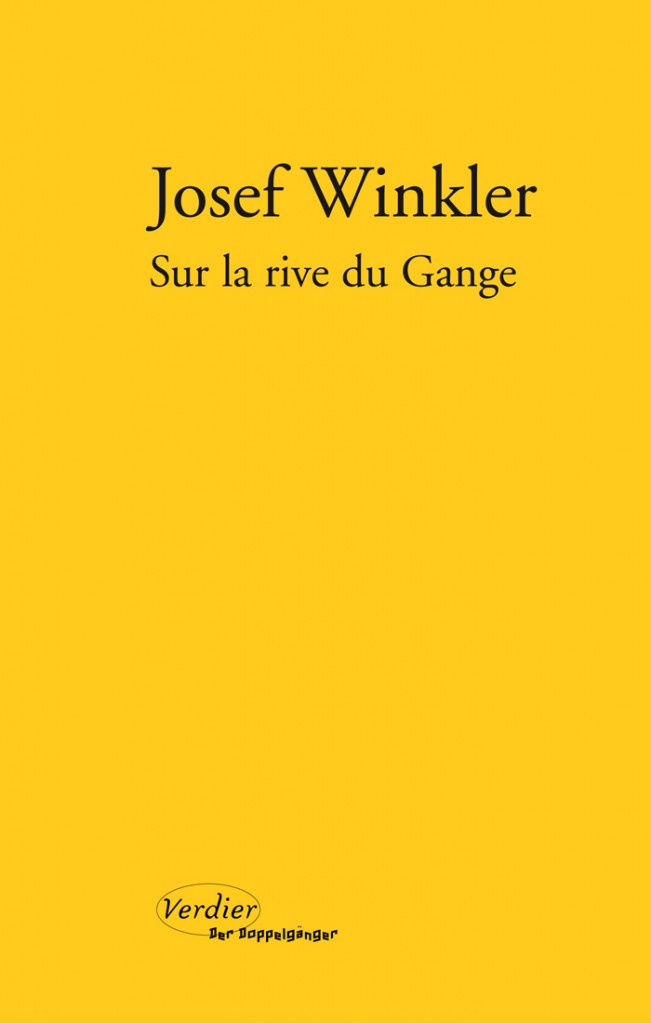
Roman. Traduit de l’allemand (Autriche) par Éric Dortu
Collection : Der Doppelgänger
256 pages
18,25 €
978-2-86432-424-9
octobre 2004
Sur la rive du Gange, depuis des temps immémoriaux, se déroule chaque jour le rituel immuable de l’incinération des morts, ou celui, réservé aux êtres purs – enfants et saints – de l’immersion dans le fleuve. De ces cérémonies, les domras sont les officiants : leur caste veille sur le feu sacré qui sert à allumer tous les bûchers.
Sur les Ghâts où ont lieu les crémations, il est interdit de filmer, de photographier et même de dessiner, quoique les animaux y circulent librement et que les cendres des morts, une fois les bûchers éteints, ne fassent l’objet d’aucun soin particulier.
Il n’est pas interdit de prendre des notes ; pourtant, en décrivant minutieusement les spectacles terribles et grandioses qui s’offrent à lui, mêlés aux réalités les plus triviales de la vie quotidienne, le narrateur fasciné sait qu’il ruse avec l’interdit.
Comme à Naples et à Rome dans Cimetière des oranges amères et Natura morta, ses précédents livres, Josef Winkler emporte en Inde le memento mori qui traverse toute son œuvre. Écrit à la lueur des bûchers funèbres, Sur la rive du Gange est un grand livre sur l’Inde, baigné de joie tragique, où le romancier relève le défi qu’il s’est lancé depuis qu’il écrit : celui de ne jamais fermer les yeux face aux réalités les plus terribles de la vie.
Au cours de nos premiers jours à Varanasi, nous allâmes à pied à la Godaulia et mon attention fut particulièrement attirée, dans les ruelles étroites, par une chèvre tachetée de blanc et de brun foncé qui grignotait un gros bâton fendillé à demi carbonisé, recouvert d’une pellicule grise de cendre. Tandis que ma compagne retrouvait chez un confiseur les sucreries indiennes de son enfance – « c’est exactement la même odeur qu’autrefois ! » –, j’étais assis dans le pousse-pousse, la langue paralysée, complètement épuisé et abattu par les impressions nouvelles et les images insolites qui se présentaient à moi, et j’observais le mouvement des côtes du chauffeur au torse brun qui pédalait en direction de notre hôtel. C’est à ce moment-là que je me demandai si le misérable petit muet que j’étais – ma compagne, pendant ce temps, s’extasiait sur le goût de pistache d’une friandise – si l’être privé de langage que j’étais ne ferait pas mieux de se précipiter hors du pousse-pousse et de se jeter sous les roues du gros camion qui arrivait en sens inverse, et je murmurai alors plusieurs fois à voix basse, agrippé à l’armature en bambou du pousse-pousse, le regard rivé sur le mouvement des côtes de notre chauffeur au torse brun qui pédalait : « Jamais plus tu ne pourras écrire une phrase ! » Ce soir-là, j’assistai à un concert privé donné dans la salle à manger de l’hôtel, assis, derrière les autres spectateurs, sur les marches d’un escalier menant à la terrasse, et tandis que je fixais la chanteuse et le joueur de cithare, je me mis à pleurer, dissimulé derrière un pilier de la rampe, et mordis jusqu’au sang l’ongle de mon pouce droit, le dos de la main inondé de larmes et de morve.