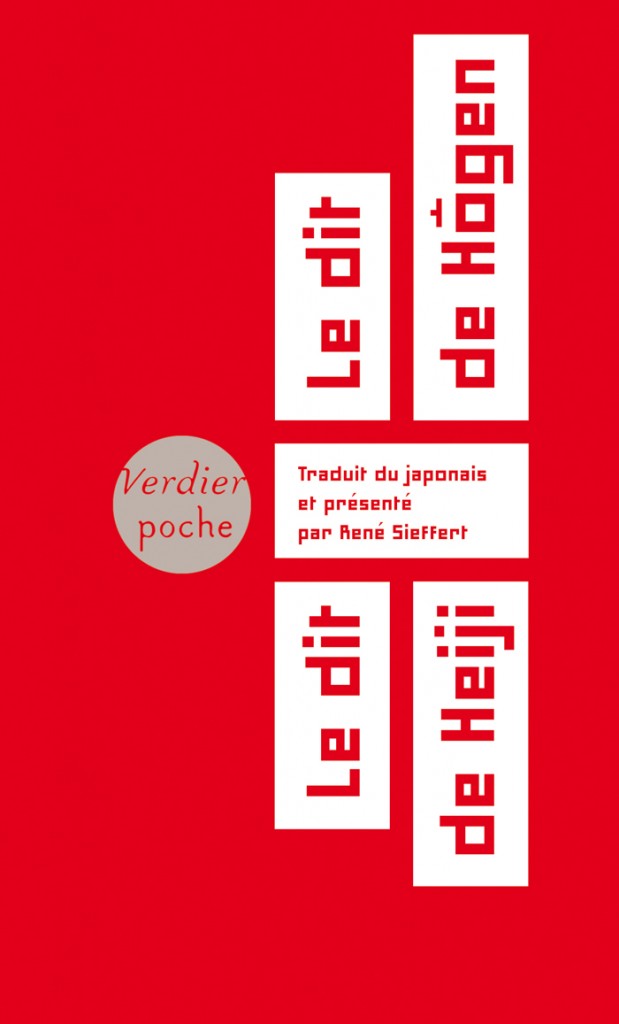
Le dit de Hôgen, le dit de Heiji
Traduit du japonais, annoté et présenté par René Sieffert
Collection : Verdier/poche
320 pages
9,63 €
978-2-86432-501-7
avril 2007
C’est au milieu du XIIe siècle que commence l’histoire du Dit de Hôgen. Le Japon vient de connaître la période la plus brillante de sa civilisation, et deux groupes mènent le jeu politique : la Cour, dominée par les Fujiwara, et le clan des guerriers, avec à leur tête les Taïra et les Minamoto, rivaux mais pas encore ennemis déclarés.
Le Dit de Hôgen et le Dit de Heiji relatent une véritable révolution : l’éviction des Fujiwara et la lutte sanglante pour le pouvoir entre les deux clans. On assiste ainsi à l’irruption de la province dans les affaires de la Ville et à la naissance d’une classe féodale qui va contester le pouvoir central pendant
des siècles.
Ces récits constituent la source où puiseront, à toutes les époques, les romanciers et les dramaturges. Ils étaient à l’origine colportés par des aveugles, les « moines au biwa », qui les racontaient partout, village ou château, à travers l’archipel.
Aujourd’hui, leurs thèmes vivent encore au théâtre, au cinéma et à la télévision.
La dame épouse de Taméyoshi se jette à l’eau
Yoshimichi était retourné à la Sixième Avenue près le Fossé pour rendre compte, et quand on lui eut dit que la dame n’était pas encore revenue de Yawata, aussitôt il partit en direction de Yawata ; il la rencontra à Aka.i-kawara. La mère quand elle aperçut Yoshimichi qui approchait, voulut lui demander ce qui se passait, et le cœur agité, elle souleva le store du palanquin : « Or çà ! or çà ! » dit-elle ; lors Yoshimichi se laissa glisser de sa monture et tout aussitôt versa un flot de larmes : « Par ordre de Sa Majesté, Messire le Religieux a dû être exécuté. Et les jeunes seigneurs de même, nous avons tous dû les mettre à mort ! En voici les reliques ! » dit-il, et il produisit les quatre sachets de papier. La mère se laissa choir du palanquin, pressa les cheveux laissés en souvenir contre son sein et se lamenta en se tordant de douleur : « Ah ! Yoshimichi ! Tuez-moi de même ! Que je puisse suivre le même chemin ! » dit-elle, et comme elle gémissait et criait, tous jusqu’aux humbles palefreniers et porteurs de tremper leurs manches à les tordre. Or voici ce que dit la dame nourrice : « Ne vous donnez point en spectacle au milieu de la route ! Vite, vite, revenez chez vous » dit-elle, et elle la fit remonter dans le palanquin. Et voici ce que dit la mère : « Eh bien, ces enfants, où donc les a-t-on tués ? — Au Mont Funaoka ! » dit-il, et lors : « Alors menez-moi là-bas, que je voie une dernière fois ne fût-ce que leurs corps sans vie ! » dit-elle, puis comme sur la berge de la Katsura-gawa on déposait le palanquin pour se préparer à traverser la rivière, elle se traîna hors du palanquin et subrepticement ramassa des pierres qu’elle glissa sous le revers de sa robe ; lors voici ce qu’elle dit, pleurant et pleurant : « Ce matin comme je partais pour Yawata, ces petits me suppliaient de les emmener, mais je n’avais personne pour les accompagner. Et si je n’en prenais qu’un ou deux les autres seraient mécontents, me disais-je, si bien que je les ai laissés. Ah ! combien ils ont dû m’en vouloir ! Si seulement j’avais su ce qui devait arriver, je les aurais certes emmenés tous ! Ou si du moins je n’en avais emmené ne fût-ce qu’un seul, et même s’il ne devait échapper à son destin, je pouvais le tenir par la main quoi que nous dussions devenir ! Hélas ! quand je songe que ce matin pour la dernière fois je les voyais ! “En voyant les visages émaciés de mes petits enfants, point n’ai pu les quitter !” Quelle vérité dans ce dicton ! Et l’on me dit que Hachiman-daïbosatsu a fait le serment de veiller jusqu’à la fin des temps sur quiconque naîtrait dans la Maison des Genji ! Ceux-là pourtant étaient d’authentique lignage ! Tout petits qu’ils fussent encore, ah ! que je lui en veux de les avoir abandonnés ! Si j’avais su qu’il en irait ainsi, qu’avais-je besoin d’aller à Yawata ? Quand les abstinences auxquelles je me livrais étaient avant toute autre chose des prières pour Messire le Prévôt, des prières pour mes enfants ! Si ce matin je n’étais allée à Yawata, je pouvais à mes enfants faire mes ultimes adieux ! Ah ! que je regrette d’avoir fait ce pèlerinage ! » Voilà ce qu’elle disait, la malheureuse ! Et pleurant et pleurant, elle reprit : « Je voulais aller au Mont Funaoka pour voir des cadavres sans vie, mais à présent pour sûr les chiens et les oiseaux les auront déchirés ! Et si je dois ici et là chercher les corps chéris, me dire : voici la main d’Otowaka, voilà le pied de Ten.ô, jamais mes yeux n’en supporteraient la vue, aussi vaut-il mieux que je n’aille point ! La fumée du soir sur la lande de Bagaï, le Mont Toribé ou les parages de Tôdaï, la rosée du matin sur Hokubô, dont on cite la poignante tristesse comme exemples de l’éphémère, voilà ce qu’est pour moi le Mont Funaoka ! J’irais bien à Saga ou à Uzumasa prendre l’habit, mais il me serait pénible que les moines puissent, en bien ou en mal, parler de l’épouse de Taméyoshi ! » Elle dit, et priant un porteur de lui prêter sa dague, de sa main elle fit tomber sa chevelure, la noua en plusieurs tresses, puis elle les dédia en offrande aux bouddhas, aux dieux, aux Trois Trésors, les enveloppa avec des pierres et les jeta dans la rivière. « L’homme, en un jour et une nuit, éprouve huit myriades de myriades et quatre mille soucis, nous enseigne le Bouddha, et moi, pauvre sotte, je me demandais comment cela se pouvait ! Pour compter mes peines à présent, dussent les cailloux de cette rivière en miettes se briser, qu’ils n’y suffiraient encore ! Le Sire Prévôt était dans sa soixante-troisième année ; il était homme à vivre jusqu’à soixante-dix ou quatre-vingts ans ! Quand j’y pense, que je regrette ces années perdues ! À plus forte raison, ces enfants avaient-ils un long avenir devant eux ! Si mes jours devaient se prolonger, indifférents, en ce monde de misère, je compterais les années de mes enfants, cette année, celui-ci aurait tel âge, celui-là tel âge, me dirais-je, et chaque fois que je verrais quelqu’un qui leur ressemblerait, je me consumerais en regrets, remuant sans cesse ma rancœur envers ceux qui les ont tués, ma pitié pour les enfants qu’on m’a tués ; je ne crois pas que je puisse ainsi vivre une heure seulement ! Si je devais, comme il est de coutume en ce monde qui n’obéit à nos desseins, survivre, indifférente, fût-ce un jour, fût-ce une heure, je me chargerais de péchés effroyables ! Et puisqu’il en est ainsi, mieux vaut que je me jette au fond des eaux ! “Sans regrets pour cette vie, ne désirez rien que la Voie Suprême”, nous enseigne le Bouddha ! » De la sorte elle se lamentait, pleurant et pleurant, sans vouloir remonter dans son palanquin. La dame nourrice la première, tout un chacun lui disait : « La douleur que vous éprouvez n’est point commune, mais depuis les temps les plus anciens jusqu’à ce jour, nombreuses en vérité furent celles qui, selon la loi de ce monde, survécurent à leur époux ou furent séparées de leurs enfants ; il n’est guère d’exemple cependant qu’elles eussent rejeté la vie pour autant ! Telle jadis, au pays des Barbares, à dix mille lieues par-delà les nuages, accusait son image en son miroir, et telle autre, enfermée dans le pavillon d’Enshi, par les nuits de givre et de lune se torturait le cœur. Selon le destin de chacun, la douleur de la séparation d’avec les êtres chers et la loi qui veut que l’on ne sait ni qui vit ni qui meurt sont choses coutumières et non point réservées à vous seule ! Au cours des derniers combats, la dame épouse du Religieux Lieutenant des Écuries de la Droite Hei a perdu ses quatre fils et leur père, et la dame épouse de Messire Saémon-no-Taïfu s’est vu arracher trois fils et leur père. Et pourtant elles ne se sont pas pour cela jetées à l’eau ! L’une et l’autre ont changé d’état et pris l’humble robe des religieuses. Certes, vous voulez emprunter la même route qu’eux, mais ceux qui se sont engagés sur les voies ténébreuses, vous ne les retrouverez plus. Les Six Voies, les Quatre États de la Vie se séparent au carrefour, et vous ne saurez quel chemin ils auront pris. Retournez plutôt au logis sans tarder, et veillez à leur rendre à chacun les funèbres devoirs. Si vous vous jetiez au fond de ces eaux, non seulement vous feriez gravement obstacle à votre propre salut, mais qui donc prierait pour que soient éclairés le Sire Religieux et vos petits enfants ? » Telles étaient les consolations qu’ils lui prodiguaient, cependant que rangés sur le bord de la rivière, ils ne la quittaient des yeux. La dame acquiesça : « Si je ne dois les retrouver en l’autre monde, à quoi bon me jeter à l’eau en effet ! Soit donc, retournons à la Ville ! » dit-elle, et comme elle s’approchait du palanquin comme pour y monter, rassurés ils s’écartèrent, mais tandis qu’ils se préparaient à traverser la rivière, elle s’échappa en courant et du haut de la berge se jeta à l’eau. La dame nourrice, dans sa douleur, s’y jeta derrière elle. C’était environ le vingt de la septième lune ; au vent qui descendait du Mont Arashi, des lambeaux de brouillard flottaient sur la rivière qu’ils cachaient par endroits, des averses tombaient de temps à autre, si bien que des eaux enflées on ne distinguait la profondeur et que dans le bouillonnement des blanches vagues, nul ne put la rejoindre aussitôt. Comme elle avait rempli ses manches de pierres, elle coula à pic et ne reparut point, hélas ! Tous ceux qui se trouvaient là avaient sauté dans la rivière et la recherchaient, mais quand, après un long moment, ils l’en retirèrent, loin en aval, elle était dans un état désespéré. Elle exhalait encore un souffle imperceptible qui bientôt s’éteignait ; on brûla le corps sur-le-champ et les cendres, envoyées à l’Engaku-ji, furent déposées au même endroit. « Le sage vassal ne sert pas deux seigneurs, la femme chaste ne se montre à deux époux », dit le Livre. De pitié et d’admiration, il ne fut personne, de l’Unique au sommet jusqu’aux dix mille en bas, qui ne trempât de larmes ses manches.