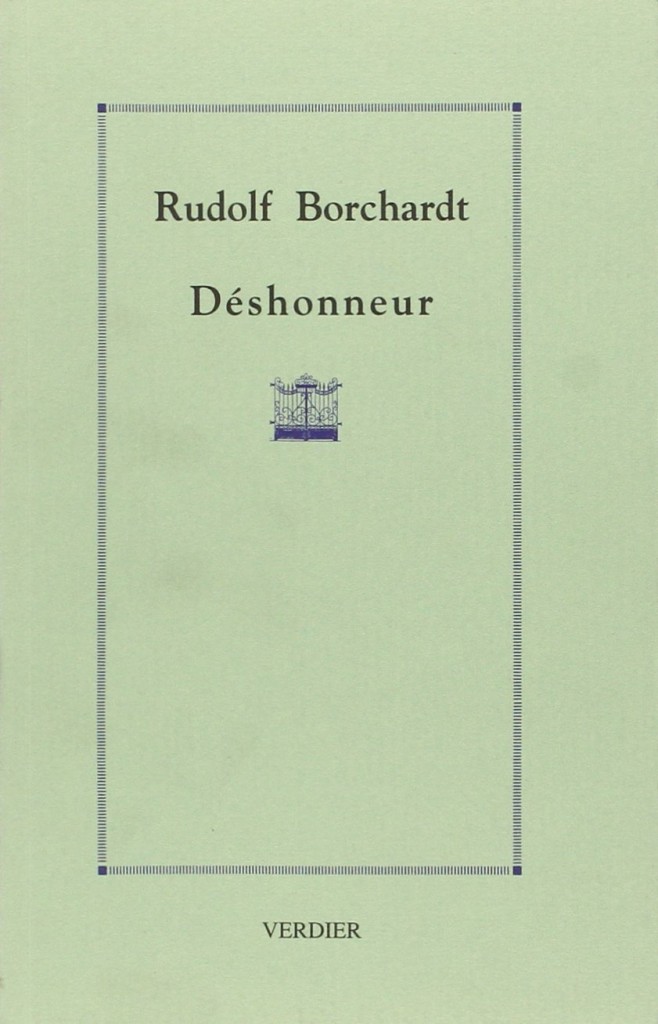
Rudolf Borchardt
Déshonneur
Traduit de l’allemand par Pierre-François Kaempf
Collection : Der Doppelgänger
160 pages
13,18 €
978-2-86432-127-9
mars 1991
Allemagne, 1923. Dans un château symboliquement situé au cœur des terres occupées par la France à titre de réparation pour les dommages de guerre encore impayés, l’arrivée d’un aventurier désœuvré en quête d’une position sociale, ex-officier de l’armée allemande démantelée, jette le trouble dans une famille aristocratique et révèle la ruine des valeurs anciennes que nul n’est capable de défendre plus longtemps.
Ce qui pourrait n’être qu’un drame bourgeois, autour d’une histoire d’adultère, est traité par Rudolf Borchardt, avec une cruauté visionnaire, comme une véritable tragédie en prose, avec unité de temps, d’action et de lieu. Le huis-clos infernal de quelques personnages confrontés à la même tentation du déshonneur permet à l’auteur, au cours des quelques journées symboliques d’un printemps traversé d’orages, de décrire la crise de conscience, selon le mot d’un des acteurs de la tragédie, de toute une « génération désespérée ».
Rentrant dans sa chambre en peignoir de bain, il trouva ses valises correctement défaites, ses costumes étalés, et une table de petit déjeuner servie d’abondance et avec soin. Il regarda sa montre, jeta son peignoir, massa son corps brun de la nuque aux talons, et lui fit faire une douzaine d’exercices de force et de souplesse, sans aucune peine. Puis il chercha vainement un miroir, se souvint d’en avoir vu un dans la salle de bains, et, entré là, s’avança devant la glace étroite, fixée à la verticale dans une armoire à toilette. Le miroir lui renvoya l’image qu’il souhaitait voir, celle d’un corps masculin parfait, noble et florissant, et qui était, en haut, juste à la limite de l’athlétique, – en bas, juste à celle du gracieux. Il leva ses mains, ses pieds, également conformés d’une façon presque féminine, avec des attaches qui marquaient une origine distinguée. Il tourna son cou et sa tête en gonflant les épaules, et donna à son visage une expression mobile. « Non, pas un dandy, mais un bel homme, un très bel homme. » Il avait raison. C’étaient là, transposées de façon virile, les traits d’une mère très belle, peut-être d’une lignée de belles aïeules. Les Schenius, qui avaient la réputation d’être des hommes à femmes, avaient sans doute su bien choisir, depuis des générations. La naissance de la chevelure aux courtes boucles, d’un blond moyen, au-dessus d’un joli front, avait encore, chez cet homme bientôt quadragénaire, presque une grâce de jeune fille. Dans les yeux clairs et hardis, qui pouvaient se montrer menaçants – pour ainsi dire – ou bien, avec un sourire de viveur, vous explorer – eût-on dit – de part en part, s’étaient, depuis des siècles, accumulés les artifices d’une douce séduction accoutumée à triompher. Le nez était ferme et délicat, la bouche, celle d’un flatteur : la princesse avait eu raison. Schenius se détourna. Chacun de ses mouvements eût supporté d’être fixé, pris en lui-même et figé, chaque contour de son corps était une victoire. Pour la centième fois, il se demanda s’il devait essayer de se raser complètement, et, comme toujours, abandonna l’idée. La moustache dorée, en brosse, mince et soyeuse, le caractérisait bien. Sans elle, les traits du visage eussent pu être trop accusés. Le contour des joues était encore celui d’un jeune homme. La blondeur de ses tempes dissimulait ses quelques cheveux blancs. Il se fit à lui-même un signe de tête, revêtit en toute hâte un costume de flanelle gris, commença de prendre son petit déjeuner, constata qu’il n’avait pas d’appétit, et se mit en devoir de parcourir la pièce, une cigarette au coin de la bouche. Puis il griffonna une ligne sur une feuille de son bloc-notes de poche, et sonna. Kiefer apparut. « Voudriez-vous avoir l’amabilité de porter ce salut à la baronne Klingen. » Il rencontra un regard énigmatique, et se tut. Il y avait eu un éclair d’ironie indéniable, aussitôt corrigé par un sursaut de bonnes manières. « Madame la baronne Klingen est partie s’installer à Altmannstetten. Aux ordres de mon capitaine » : telle fut la réponse du domestique. « Comment dites-vous ? Comment cela ? » Schenius perdit son calme un instant. « Partie pour toujours ? – Nous n’avons pas d’instructions sur ce point, répliqua Kiefer, inébranlable. Mon capitaine a-t-il d’autres ordres ? » On avait exercé une censure. Schenius avait remercié avec un sourire. Et ce sourire resta encore sur ses lèvres une fois qu’il fut resté seul, il ignora pendant combien de temps. À peine chassé, celui-ci revenait sans cesse, convulsif, douloureux.
Après avoir serré les poings, en rage, parlé à lui-même en grinçant des dents, laissé un bref instant s’échapper des larmes de colère entre ses cils, qu’il fit suivre d’un éclat de rire, d’un juron et d’un haussement d’épaules, Constantin Schenius retrouva lentement son calme. En cela, la renommée avait eu raison : il n’était pas au fond (et il se le disait à lui-même) une nature passionnée. C’était un être plein de mesure, et, même offensé ou irascible, il ne s’aveuglait pas jusqu’à la fureur et à l’intransigeance ; et il avait bien trop soif d’être choyé pour ne pas en venir de lui-même à une amabilité à tout prix, et à des solutions conciliatrices. « Difficile ? se demanda-t-il. Bien sûr que ça le sera. Comment en irait-il autrement ? J’ai été un sot, un idiot de ne pas y être préparé. En vertu de quoi devait-on m’accueillir ici les bras ouverts ? Parce que j’ai… » Il s’arrêta net ; il avait voulu se dire en lui-même : « Mais non, je ne l’ai pas séduite, leur sœur, elle s’est jetée à mon cou » ; mais il trouva l’atout inélégant à jouer, et sans le jeter par-dessus bord, il le garda en réserve. Puis il poursuivit : « Bien sûr que je l’ai séduite. En tant qu’homme, je prends naturellement la faute sur moi, devant ces gens. Ou plutôt, j’en porte déjà le poids, que je la prenne ou non sur moi. À leurs yeux, je porte la responsabilité de tout : l’éclat, le divorce et la situation présente.