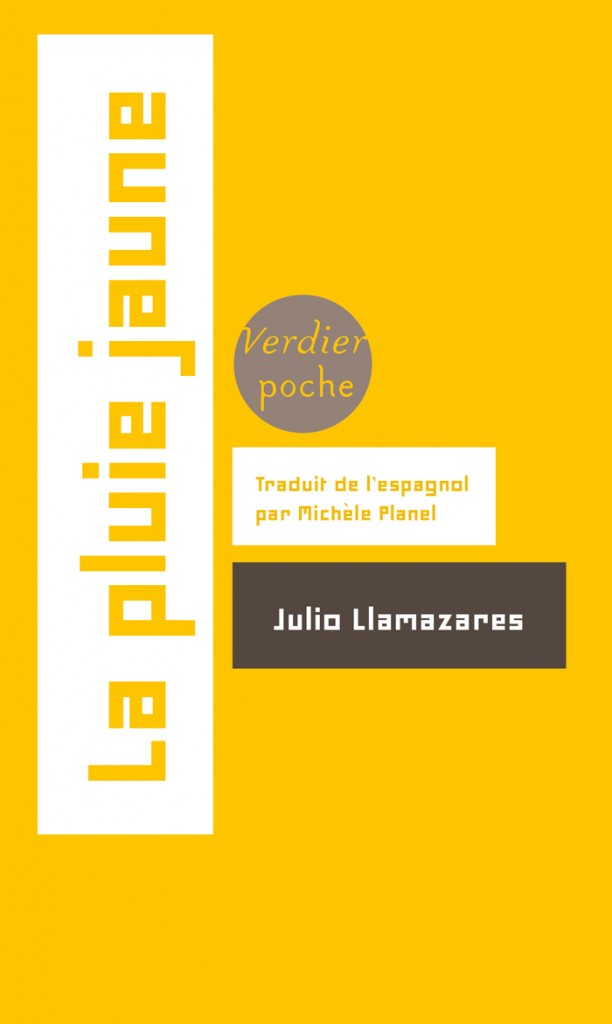
Julio Llamazares
La pluie jaune
Roman. Traduit de l’espagnol par Michèle Planel
Collection : Verdier/poche
144 pages
10,00 €
978-2-86432-583-3
septembre 2009
(collection d'origine : Otra memoria)
Au seuil de la mort, un homme achève l’expérience extrême de l’abandon. Pour conjurer la peur, il parle. Il raconte avec une grande pudeur et une douceur infinie, sa cruelle traversée. Il réveille dans ce village oublié des Pyrénées aragonaises, les visages disparus que la maladie, la vieillesse, la guerre mais surtout l’exode ont emportés jusqu’au dernier – lui. Il évoque sa résistance obstinée contre les forces de la nature, contre les mensonges de la mémoire, les illusions du réel ou les exaltations de la folie.
Ce chant âpre et fascinant – écrit dans une langue simple mais imagée, sensible, enveloppante, volontiers itérative au point de susciter ce sentiment étrange de déjà vécu – emporte celui qui écoute vers un point de vertige où s’évanouissent ensemble, dans la chute lente des feuilles de l’automne, l’éphémère et l’éternel.
Dans la rue, le brouillard s’accrochait aux murs et l’humidité glacée du givre rendait invisible toute empreinte récente. Un silence immense occupait le village entier, il introduisait sa grande langue sale dans la pénombre des maisons, fourrageant dans la rouille de l’oubli et la poussière accumulée par les ans. Je fermai sans bruit la porte derrière moi. Je cherchai dans la poche de mon pantalon le contact familier du couteau et, contrôlant ma respiration et les battements de mon cœur pour que de loin ils ne puissent pas me trahir, je me mis à marcher sur le chemin que Sabina suivait chaque nuit en solitaire. Lentement, mes sens se portant au-delà du brouillard et m’enfonçant dans la neige à chaque pas, je parcourus peu à peu tout le village sans trouver trace de son passage. Je regardai sous chaque porche, au détour de chaque rue, derrière chaque mur. Je fouillai Ainielle partout, rue après rue et maison après maison. En vain. On aurait dit que la neige et le silence l’avaient ensevelie, que sa figure émaciée s’était diluée à jamais dans le brouillard. Je jetai encore, malgré tout, un dernier coup d’œil aux ruines de l’église et j’étais sur le point de rentrer quand brusquement je me rendis compte qu’il y avait encore un endroit où je ne l’avais pas cherchée.
De loin, ombre parmi les ombres que dessinait le brouillard, j’aperçus d’abord la chienne couchée sur le chemin. Lovée dans la neige, sous la protection douteuse des peupliers sans feuilles, elle ressemblait à un animal noyé et abandonné là par la fureur de la rivière. Je traversai le pont et pressai le pas, je l’appelai à voix basse en m’approchant. Mais, quand elle me vit, au lieu de courir vers moi comme d’habitude, elle se releva sur place et recula lentement vers la porte du moulin sans cesser de me regarder un seul instant. Je me demandai si, par là, elle essayait de me guider ou si, au contraire, elle voulait me barrer le passage. Mais à ses yeux – et à l’étrange attitude menaçante que d’emblée elle avait adoptée (et qui me rappela sa solitude remplie de crainte tandis qu’elle surveillait le sanglier dans la nuit et la neige) –, je compris immédiatement ce qui m’attendait derrière elle et derrière la porte du moulin. Sans réfléchir un instant, je courus l’ouvrir d’un coup de pied : Sabina était là, elle se balançait, pendue comme un sac dans la vieille machinerie, les yeux immensément ouverts, et le cou brisé par la corde avec laquelle, quelques nuits auparavant, j’avais pendu le sanglier sous le porche de la maison.