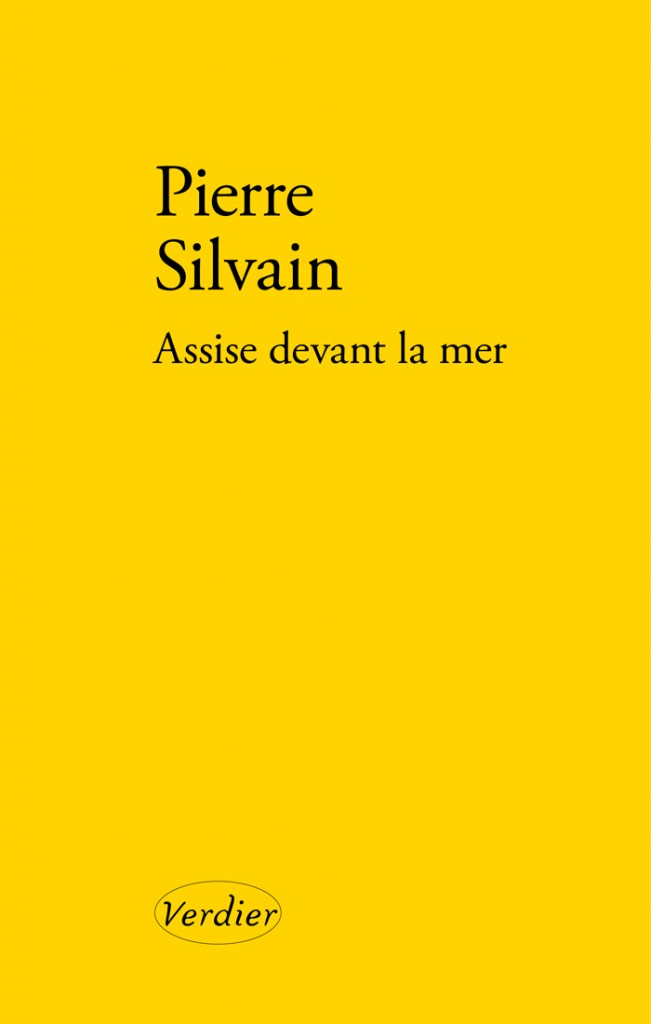
Pierre Silvain
Assise devant la mer
Collection : Collection jaune
128 pages
14,20 €
978-2-86432-585-7
août 2009
Un homme se souvient de son enfance marocaine, tout entière captive de l’amour inquiet et jaloux qu’il voue à sa mère – elle-même séparée de son fils par ses rêves mélancoliques, ses attentes vides, et plus tard les secrets de l’adolescent.
Désir, effroi, tendresse et provocation peuplent moins leurs paroles que leurs silences, car rien de ce qui constitue leur jeu, dans ce qu’il pourrait avoir de trouble et de cruel, ne saurait passer par le langage.
Mais – complicité des enfances qui ignorent l’espace et les générations – c’est auprès de la fillette que fut sa mère, dans les étés de La Geneytouse, qu’il trouve grâce et apaisement.
Le trajet amont dans le temps que le narrateur accomplit cette fois face à l’irréversible – sa mère vient de s’éteindre – opère paradoxalement en lui une métamorphose qui lui permet de dire je, tu – nous enfin réunis, confondus.
Après Julien Letrouvé colporteur, Pierre Silvain nous livre ici, dans une langue très maîtrisée, un récit construit sur une étrange et fascinante mise en abyme.
C’est le matin, le plein jour à présent, la chambre est paisible. Bien qu’elle soit entrée sans faire de bruit, l’enfant qui s’est réveillé près de la place vide du père, voit la mère s’approcher du lit. Elle se penche pour l’embrasser. Alors, il se détourne violemment, se cache le visage dans son bras replié et ne bouge plus jusqu’à ce qu’elle reparte et ferme la porte. Il passe la journée à l’éviter et tandis qu’elle s’occupe du ménage, de la cuisine, qu’elle termine un travail de couture en retard ou consacre un moment de répit à la lecture du feuilleton et des avis de décès du journal, il l’observe à la dérobée, sans trouver de quoi satisfaire ce qu’il s’efforce de découvrir, une fatigue, une absence, un cerne bistre sous ses paupières qu’elle n’a pas d’habitude, l’éclair d’une pensée heureuse au fond de son regard. Il ne remarque rien que ce qu’il a toujours vu, rien qui lui soit étranger et tout à coup inexplicable.
Il est décontenancé et sans se l’avouer, tout de même déçu. Il se dit que ce ne peut être sa mère, en chemise de nuit légère, qui, pieds nus sur le plancher froid, a rejoint le père dans le secret du lit, mais une autre créature, née du tourment ou d’une fantasmagorie de l’imagination. Pourtant, aussi longtemps qu’il reste à l’attendre la nuit suivante, comme un être de peu de réalité, à même de se manifester par quelque impénétrable dessein de la puissance qui tient les fils d’une marionnette ayant pris à s’y méprendre l’apparence de la mère, la visiteuse nocturne n’est pas reparue. Ou alors, de guerre lasse, a-t-il à cet instant perdu conscience et a-t-elle profité de cet endormissement de nourrisson à l’abandon pour s’approcher du lit, dans l’irréelle pâleur de la mince étoffe où elle frissonne de tout son corps, se hisser, s’allonger après avoir écarté le drap sur l’autre corps, s’abandonner à l’étreinte, d’abord immobile, fermant les yeux, recueillie, puis animée de mouvements précipités, soudain interrompus par la voix de l’enfant qui parle et s’agite au milieu d’un rêve. C’est alors qu’elle a dû, son cœur battant à grands coups, se redresser, sauter du lit et s’évanouir ainsi qu’une apparition au point du jour. Mais la nuit s’écoule avec une lenteur, une uniformité que, maintenant qu’il est réveillé, il endure comme si elle n’allait plus finir. Il a cessé de guetter par l’ouverture du volet la lueur d’une improbable aurore. De loin en loin, il entend le chant du rossignol, si beau et si esseulé, qu’il lui vient comme une envie de mourir d’une mort très douce.