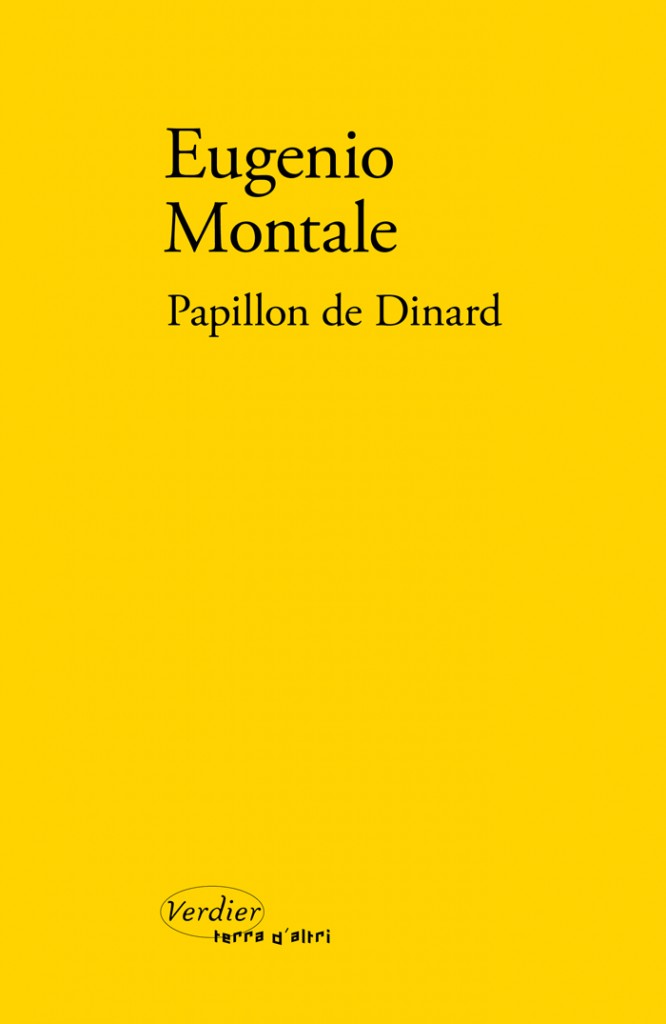
Eugenio Montale
Papillon de Dinard
Proses. Traduit de l’italien par Mario Fusco
Collection : Terra d’altri
224 pages
18,25 €
978-2-86432-606-9
février 2010
Les proses de Papillon de Dinard frappent par la variété de leur inspiration : on y trouve successivement des évocations de l’enfance et de l’adolescence au soleil ligure, des chroniques florentines, des portraits de femmes ainsi que les pages d’un carnet de voyage comme arrachées à un bottin mondain. Et pourtant, au fil de cette cinquantaine de récits, on entend monter la voix du poète, de plus en plus intime, de plus en plus étrange, de plus en plus énigmatique.
On ne met pas longtemps à se convaincre que l’un des plus grands poètes du siècle (Prix Nobel en 1975) fut un prosateur hors pair et parfaitement singulier. L’écriture épouse la circonstance comme le poème les « occasions » : parfois elle concentre tout dans une pure potentialité qui intrigue, parfois elle a la netteté du symbole.
On ferait volontiers de ces petits poèmes en prose un « spleen d’Italie » s’ils n’étaient aussi traversés par l’humour, par la drôlerie et le gag – on découvrira notamment comment un couple lutte contre une chauve-souris ou comment une comparaison malheureuse rend difficile une soirée en gondole. Enfin il y a ici tant d’animaux, du gros rat à la soubuse, de la limace à l’okapi, qu’il n’est pas faux de lire cette étrange phénoménologie de la mémoire comme un zodiaque que dominerait un étrange effet papillon.
Les enfants – les amis-ennemis des bêtes les plus naturels et les plus convaincus – n’ont pas toujours à portée de la main ou des yeux une faune suffisamment riche et variée, comme cela était le cas pour ceux qui pouvaient fréquenter les zoos des grandes villes avant que les bombes, tombant du ciel, n’eussent mis en liberté les serpents à sonnettes et les fauves des tropiques. Il existe, et ce sont les plus nombreux dans les pays dits (peut-être pour peu de temps encore) civilisés, des enfants pour lesquels le fabuleux bestiaire de l’enfance est presque totalement interdit ; des enfants pour lesquels les colonnes d’Hercule du monde animal sont représentées par le chien, le chat, le cheval, dans des exemplaires qui ne sont pas toujours merveilleux. En pareil cas, les garçons de ma génération, pour ainsi dire ignorants du sport, du football et des jouets mécaniques compliqués, se défendaient avec leur imagination, et avaient éventuellement recours aux légendes des vieilles gens. Là où la ménagerie n’existait pas, ils savaient s’en fabriquer une à leur façon. Un enfant que je connais fort bien et que tout le monde appelait Zebrino, le petit zèbre, en raison du maillot à rayures qu’il portait d’habitude (et déjà, dans le choix de ce surnom, il y avait peut-être une prescience de ses aptitudes et de ses goûts), se trouvant amené à vivre dans un pays très démuni d’espèces zoologiques bizarres, avait précisément eu recours aux sources des anciens, aux humeurs de l’imagination populaire, et il en avait retiré de bons fruits. Il passait les mois de liberté de son année, ceux de l’été, sur une langue de terre en face de la mer, séparée du reste du monde par de hautes murailles de roches. Dans ce village, il n’existait pas de voies carrossables, le train passait enfermé dans de longs tunnels, et seuls quelques tremblements du sol et la fumée qui sortait des trous creusés dans les rochers donnaient une trace de son passage. Monde d’abordage, monde désertique où seuls le loir, les écureuils et les oiseaux pouvaient trouver une demeure plus ou moins fixe : non pas les loups, ni les sangliers qui ont besoin de vastes clairières ou de forêts étendues. Zebrino n’était pas encore chasseur, et ce n’est que rarement qu’il accompagnait à la chasse les hommes du village. Les variétés des oiseaux de passage n’étaient pour lui que des noms qui faisaient faiblement vibrer son imagination. Mais avec quelques volatiles de l’endroit – le suce-chèvres, la soubuse – il avait lié amitié depuis ses premières années. Dire qu’il les avait vraiment vus serait trop prétendre. Avec le suce ou tète-chèvres mort, et sa bouche en forme de ventouse, pilifère et dépourvue de bec, d’oiseau-sangsue, il avait fait connaissance au moins une fois, bien que, dans la région, les chèvres fussent excessivement rares. Mais la soubuse ? Son existence même était mise en doute par les hommes les plus sérieux, ceux qui avaient fréquenté la ville. Et aucun des chasseurs rencontrés par Zebrino ne pouvait se vanter d’en avoir tué une seule. C’était, ou ce devait être, un rapace plus gros que le faucon et moins que l’aigle, pourvu de fortes ailes, mais pas suffisamment larges pour lui permettre de prendre son vol depuis la terre. Quand il était surpris par un chasseur, il se jetait du haut d’une roche et demeurait en l’air comme un planeur ou un cerf-volant, pour se poser ensuite plus bas ou plus haut, selon la faveur du vent et la gravité du danger, mais toujours sur un rebord qui permettait de nouveaux plongeons. Un démon imprenable, tardigrade et rusé, coriace et à l’épreuve des chevrotines. Des faucons ou des crécerelles morts, des huppes ou des pics noirs pouvaient parfois sortir fripés et flasques comme des mouchoirs sales, des poches des braconniers ; mais pas une soubuse, c’était un rêve irréalisable.
Tageblatt, mai 2010, par Corina Ciocârlie
La Liberté, 13 mars 2010, par Alain Favarger
Blog Lectures buissonnières, 24 février 2010, par Martine Laval
Les papillonnages d’Eugenio Montale, et une nouvelleNote sur l’origine du livre
Montale lui-même fournit des éclaircissements à propos de l’origine de ce livre, dans la quatorzième des Trentadue Variazioni (Prose e racconti, p. 575) :
La prose qui précède [il s’agit de « Il lieve tintinnio del collarino »] devait figurer dans mon livre La Bufera e altro qui parut en 1956. Mais elle fut écrite en 1943 et maintenant je ne sais pas pourquoi je l’ai exclue d’un recueil où apparaissent aussi deux autres petits poèmes en prose. Le sujet, nettement réel, aurait pu fournir la matière d’une chronique plus longue et plus élaborée ou mieux encore d’un bref récit, de ceux qu’on lit toujours plus rarement dans les pages des quotidiens. Mais une semblable destination était à exclure parce que jusqu’à ce moment je n’étais l’auteur de rien qui pût se dire narratif et que je n’avais aucune intention de m’inscrire sous cette étiquette. En outre, ce qui aurait manqué, c’était le destinataire, le journal. J’avais déjà sur la conscience un bon nombre de proses, mais toutes de critique littéraire, et éparpillées dans des quotidiens de deuxième ordre ou dans des revues. Ce n’est qu’après la libération de Milan que j’aboutis à un grand quotidien et, dans ce nouveau siège, on me fit comprendre que l’espace était compté et que la critique littéraire devait, au moins de façon provisoire, entrer en quarantaine. Alors disparut pour de bon l’illusion de pouvoir devenir un émule d’Aloysius Bertrand, un ciseleur de brefs joyaux en prose « d’art ». D’autre part, j’étais dépourvu de l’imagination du narrateur-né, et je ne pouvais compter que sur des souvenirs personnels, sur des expériences vécues. Je ne disposais certes pas d’une corne d’abondance, car j’avais toujours mené une vie retirée et, depuis 1940, semi-clandestine. En revanche, ces quelques souvenirs avaient peu à peu levé et me semblaient de jour en jour plus irréels. Je ne pouvais pas les fondre en un tout homogène, en une continuité. Ils se refusaient à s’organiser selon un ordre et une perspective. Je devais les laisser sortir à leur guise et c’est ce qui se passa. Ainsi naquirent les récits non-récits, les poésies non-poésies que, des années après, je recueillis sous le titre de Papillon de Dinard. Je m’aperçus ensuite que ce livre écrit à Milan plongeait une partie de ses racines dans une ville, Florence, que j’avais regardée avec les yeux d’un étranger amoureux de l’Italie. Qu’ensuite cette tentative, tout à fait involontaire, eût rencontré deux handicaps prévisibles, c’était bien clair. Les yeux de l’étranger étaient, pour moi, freinés par le fait qu’à Florence, je devais travailler, non pas contempler, et travailler dans des conditions qui me rendaient Italien à cent pour cent. En outre, la Florence qui m’intéressait était en voie de dissolution. Les sanctions iniques étaient parvenues à la vider d’une grande partie de ses reliques vivantes : des hommes qui avaient vécu dans cette ville des heures qui désormais ne pourraient plus se répéter. En substance je devais me nourrir de souvenirs alimentés par de précédents souvenirs, ceux d’autres personnes, d’inconnus. Pourtant, à l’intérieur de ces limites assez pesantes, je suis parvenu à donner, ne fût-ce qu’en quelques pages, non pas un chapitre, mais deux lignes d’un livre hypothétique qu’un jour, quelqu’un devra se décider à écrire et qui portera à peu près ce titre : Étrangers à Florence. Ce n’est pas que des tentatives de ce genre aient manqué tout à fait, mais personne, que je sache, n’a été à la hauteur de la question. Ce qu’il y a eu de mieux, c’est Emilio Cecchi qui l’a fait, lui qui, toutefois, avait émigré à Rome vers l’âge de trente ans et qui n’avait pas cet avantage d’être un étranger.