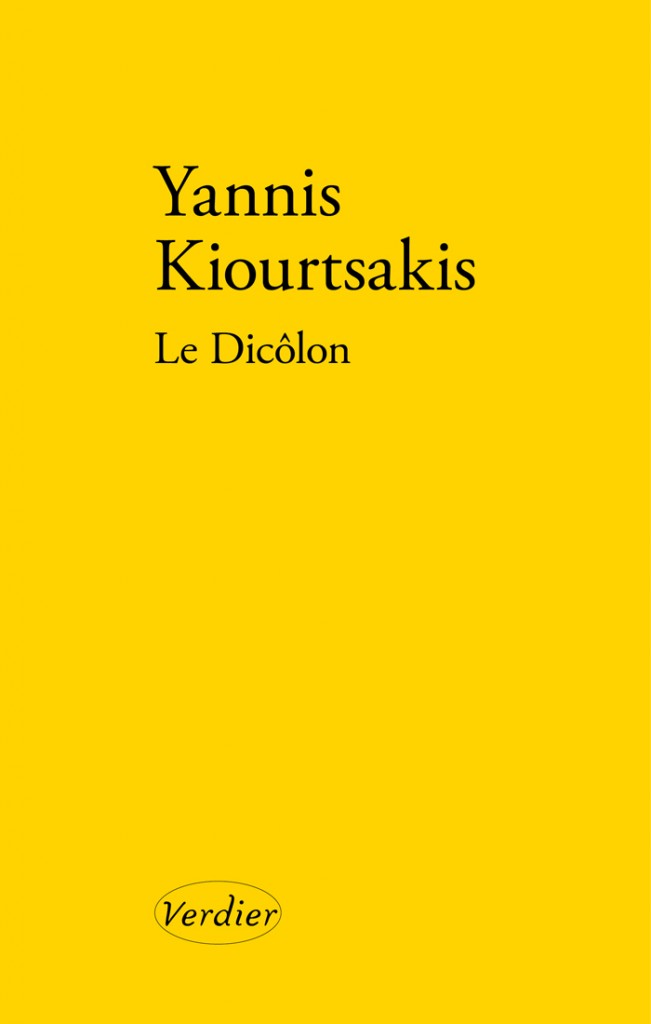
Yannis Kiourtsakis
Le dicôlon
Traduit par René Bouchet
Collection : Littérature grecque
512 pages
26,36 €
978-2-86432-634-2
février 2011
Le Dicôlon – figure qui hante le narrateur et l’engage à raconter son histoire – est ce personnage à deux corps du théâtre populaire grec, ce héros de carnaval qui porte en permanence sur son dos le corps mort de son frère.
Le conflit intime du même et de l’autre va jeter Haris, le frère, dans un désenchantement qui touche aussi bien la terre d’origine – une Grèce mythique – que la terre d’accueil – une Europe idéalisée –, et aboutit à l’échec amoureux puis au suicide dans la solitude de l’exil.
Mais le mort que l’on porte en soi, au point que les deux corps n’en forment qu’un, se révèle, au fil du récit, comme le signe de la fraternité fécondante de la vie et de la mort, capable d’engendrer du sens, une parole et une existence renouvelées.
« C’est toujours ainsi que les choses se passent : toutes nos idées ne sont-elles pas toujours dues à des morts, que nous devons ramener à la vie et pousser plus avant ? Et si nous étions tous d’une certaine manière Dicôlon ? »
Ce fut l’année où les deux scènes de notre « théâtre » familial s’unirent encore plus intimement dans mon esprit, grâce à mes expériences et à mon imagination. Je vivais à Athènes et au même moment je vivais dans cette Europe dont je sentais qu’elle s’insinuait de plus en plus profondément dans ma vie. Le samedi soir, je sortais avec mon père et ma mère dans « Athènes » : nous allions au cinéma ou flânions dans les rues et allions nous asseoir au Zonar’s pour manger une nougatine ou un mille-feuilles et, pour finir, nous nous retrouvions généralement au « Panthéon », le restaurant de la rue Panépistimiou, où je choisissais et goûtais des plats aux noms exotiques pour mes oreilles, comme vol-au-vent financière, côtelette pannée jardinière, escalope viennoise ou filets mignons sauce madère (et ces mots, ma façon de les épeler et de les ressasser avaient certainement leur part dans mes plaisirs gustatifs), tandis qu’au-dessus de nos têtes, au-dessus des garçons vêtus de noir qui couraient dans la salle et qui s’inclinaient sur notre table pour y déposer un plat fumant, en haut, au balcon, un petit orchestre parachevait notre festin familial en jouant quelque ouverture d’opéra bien connue ou une valse de Vienne. Là survivait ce climat de l’Europe centrale et de l’entre-deux-guerres qui convenait si bien à mon père et qui continuait à imprégner, en de rares endroits, la vie de notre capitale méditerranéenne – même s’il était désormais obsolète dans ces années cinquante où l’Amérique manifestait chaque jour un peu plus sa présence en tous lieux : dans les films que nous voyions, dans les magazines suspendus à la devanture des kiosques à journaux de la place Syndagma ou de la place Omonia, dans les chansons que les jeunes fredonnaient ou dans les danses qu’ils dansaient, dans les voitures, toujours plus nombreuses, qui circulaient dans les rues, et même dans la solitude d’Ékali où, pour équilibrer le budget familial, notre maison de campagne était désormais louée à un officier de la mission américaine. La domination de l’Amérique était à son zénith, mais nos regards restaient fixés sur l’Europe.
De toute façon, notre vie se déroulait entre deux mondes : deux mondes différents, voire opposés, mais en même temps fraternellement unis, dont la coexistence forcée et néanmoins pacifique se manifestait dans les noms des cinémas d’Athènes – leur simple énumération résonne encore en moi comme un manifeste : d’un côté le « Panthéon », l’« Orpheus », l’« Hespéros », l’« Attikon », l’« Asty », le « Pallas » (qui pouvait aussi bien se lire Palace) ou encore l’« Arès » ou l’« Atthis » de mon quartier, de même que les cinémas en plein air « Hellénis » et « Athéna », deux pâtés de maisons plus loin ; de l’autre, l’« Astor », le « Maxim », le « Rex », l’« Idéal », le « Mondial », le « Metropol » ; tant d’autres encore… Nous circulions entre ces deux séries de noms, qui du reste ne se distinguaient pas clairement dans mon esprit à cette époque (après tout, les racines grecques ne se mêlaient-elles pas continuellement à cette nomenclature ?), et nous participions ainsi de toute façon à ces deux mondes. De même que nous participions à deux mondes par les noms que nous portions nous-mêmes, chrétiens pour les uns, païens pour les autres – encore que même ces derniers prenaient parfois une allure « européenne », voire « américaine » : comme cet antique et archaïsant « Haridimos », le nom de baptême de mon frère (le nom, m’avait-on dit, d’un antique stratège athénien, qui restait toujours vivant sur les terres de Crète), que Haris lui-même avait si naturellement américanisé en « Harry », chaque fois qu’il l’écrivait en caractères latins.