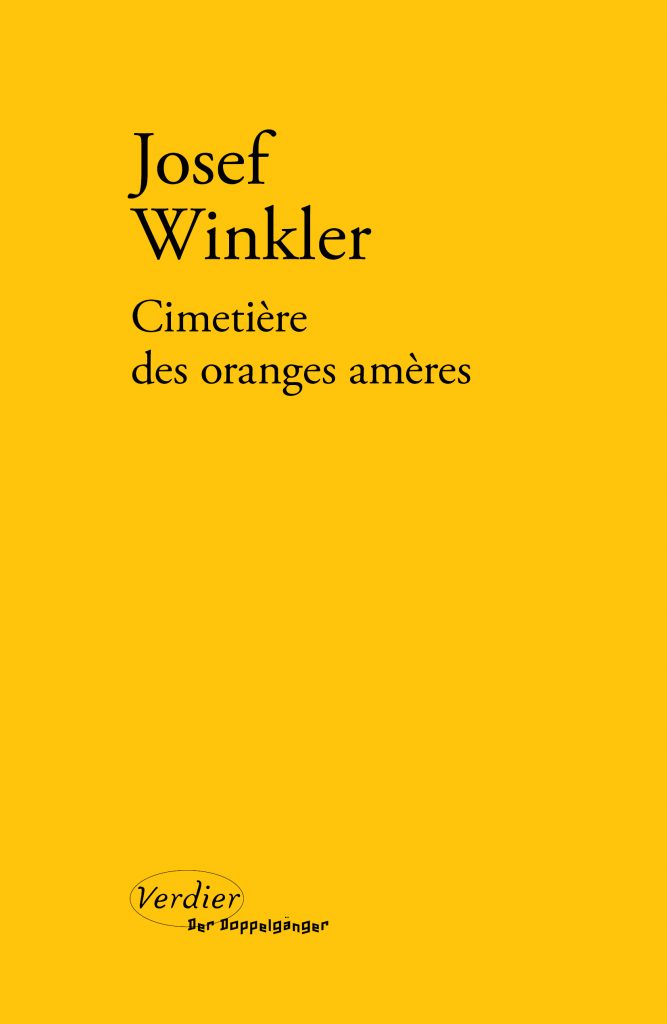
Josef Winkler
Cimetière des oranges amères
Roman. Traduit de l’allemand (Autriche) par Éric Dortu
Collection : Der Doppelgänger
416 pages
23,33 €
978-2-86432-288-7
avril 1998
Fuyant son village natal de Carinthie, dans le sud de l’Autriche, dont il décrivait l’intolérance et la cruauté dans Le Serf, Josef Winkler se réfugie en Italie et tente, par l’écriture, de lutter contre les démons de son enfance. Peine perdue : qu’il soit romain ou autrichien, le catholicisme, sous le faste de ses rites, semble devoir engendrer partout le même obscurantisme et la même cruauté. Aussi la splendeur des processions en l’honneur de la Vierge et des saints, la profusion ridicule des magasins en bondieuseries, la superstition partout répandue, sont-elles pour Winkler une source inépuisable de délectation qui alimente sa verve blasphématoire. Mais le regard de l’écrivain ne s’en tient pas à la pure satire. Dans les gares, sur les marchés, dans les jardins publics de Naples et de Rome, la vue des mendiants et des travestis ou le contact avec les jeunes prostitués et les voyous suscitent chez Josef Winkler une connivence mêlée d’inquiétude, l’obligeant à prendre conscience de sa fraternité avec toutes les formes de la marginalité, en même temps que remonte en lui le souvenir obsédant des prières de son enfance. « Je suis contre la prière, mais je prie. Je suis contre l’amour et la haine, mais je hais et j’aime, je suis aimé et haï. » Brassant un monde où l’imaginaire, l’histoire et l’autobiographie sont étroitement mêlés, ce grand livre baroque composé dans une langue éblouissante, tel un nouveau Triomphe de la mort oscillant sans cesse entre la précision de l’observation et l’incantation extasiée, se veut à l’image du cimetière des oranges amères de Naples, cette orangeraie plantée sur une ancienne fosse commune : le tombeau tragique et somptueux de tous les laissés-pour-compte de notre temps.
En apercevant dans un supermarché de Rome une poupée amputée à hauteur de la hanche, je me souvins d’un récit de guerre du laboureur. Au cours d’un bombardement, le corps d’un soldat fut sectionné en son milieu. Des camarades saisirent le buste ensanglanté, le placèrent au sommet d’un tas d’ordures et le maintinrent à la verticale au moyen de plusieurs pieux, sous les applaudissements des autres soldats. Le laboureur nous raconta qu’un jour, un valet de mon grand-père qui refusait d’avaler la mauvaise nourriture qu’on leur servait, jeta, sous les yeux des enfants, des paysans, des valets et des servantes assis à la table du déjeuner, un beignet bien gras sur le crucifix d’angle de la cuisine. Récemment encore, comme un plat rempli de beignets trônait une fois de plus au milieu de la table, et que ni mon père ni ma mère n’étaient présents dans la cuisine, je me mis à titiller mon frère en lui disant : Allez, vas-y, ne sois pas lâche ! Jette un beignet sur le crucifix d’angle ! Toi d’abord, me dit-il, et après, j’en lancerai un aussi ! Mais pas plus que mon frère, je n’osai exécuter le geste et jeter un beignet sur le crucifix. Le valet qui avait commis ce sacrilège, tel fut le terme du laboureur, fut sur-le-champ renvoyé par mon grand-père. Celui-ci s’était levé de la table du déjeuner en poussant des cris et lui avait montré la porte à tout jamais.
Konstantin ! Souvent lorsque je suis assis devant un verre de lait, comme maintenant à la cafétéria de la stazione Termini, à Rome, ou lorsque je vois des boîtes de lait dans le réfrigérateur d’un bar, je ne puis m’empêcher de penser à notre père. S’il est entre six et huit heures du soir, il est assis, le front plissé, sur son trône de traite, entre les flancs maculés de bouse de ses vaches. Lorsque à l’âge de quatorze ans, tu quittas la ferme pour aller à l’école à Vienne, tu allas encore à l’étable, le matin de ton départ, pour lui dire au revoir. Notre père te tendit la main et, de son doigt qui sentait le lait et la peau des bêtes, il traça un signe de croix sur ton front. Lorsqu’il partit à la guerre, sa mère lui fit ses adieux de la même façon, et lui donna un livre de prières qu’il lisait pendant les trêves tandis que les autres jouaient aux cartes. Lorsque tu allais encore au collège de Feistritz, tu devais encore aider aux travaux d’étable avant de prendre l’autobus de sept heures. Pas moyen de te réveiller, racontait notre mère. Souvent, c’était elle qui t’enfilait tes chaussettes alors que tu dormais encore. Puis il te fallait mettre tes bottes de caoutchouc noir toutes crottées et transporter le fumier hors de l’étable. Le soir, le rituel des matières fécales se répétait. Tout d’abord, tu partais aux champs en bicyclette, tu ouvrais la clôture de barbelés afin de laisser passer les vaches qui sortaient en hochant la tête et en remuant la queue. Enfant, personne n’a reçu autant de coups que toi, dit un jour notre mère. Il fut une époque où nous te harcelions tous, de nos mots et nos mains. Nous nous vengions sur toi, de dix ans notre cadet, pour tout ce que nous avaient infligé la vie à la ferme, le village en forme de croix et l’Église. Tu fus le premier de la fratrie à recevoir des jouets manufacturés, un gros tracteur en plastique sur lequel tu pouvais monter et redescendre le village, un train en bois, des voitures en plastique ou en métal, plus tard une bicyclette, alors que nous, mes autres frères, ma sœur et moi, n’avions pas une seule poupée, pas plus que de tracteur en plastique ou de cheval à bascule auquel nous aurions pu donner comme toi le nom de notre cheval de trait.
Ne fut-ce pas merveilleux, le jour où je restai debout, torse nu sous la grêle, au milieu du champ de tournesols, ma chemise froissée dans les mains, puis me couchai à terre, ouvris la bouche jusqu’à ce qu’elle fût pleine de grêlons, me relevai et crachai les grains de glace comme s’il s’était agi de mes dents de vieillard ? J’étais en train de regarder l’épouvantail, sur l’épaule duquel s’était perchée une corneille mantelée au bec sanguinolent, lorsque le ventre sombre des nuages se déchira, inondant de grêle la terre toujours grasse de notre pays natal. Un officier de l’armée inspecta les rangs de tournesols au garde-à-vous et leur ordonna de tourner la tête en direction du soleil de midi. Le soir, ils déployaient leurs feuilles sur leurs graines mûres et noircies, et penchaient la tête. N’avons-nous pas, Jakob et moi, couru entièrement nus sur la berge du ruisseau, au milieu des prés, brandissant une fourche afin de tuer une carpe ? Et n’avons-nous pas dû parcourir le même chemin en sens inverse parce que le poisson avait fait demi-tour et remontait le cours d’eau en respirant convulsivement ? Je revois encore aujourd’hui le membre de Jakob battre contre ses cuisses fermes tandis qu’il poursuivait avec sa fourche le poisson pantelant et le tuait. Nous avions allumé un feu au milieu des prés et fait cuire le poisson tout en fourrageant dans la braise avec une badine de noisetier, accroupis entièrement nus autour du foyer. Une fois notre repas terminé, nous nous étions à nouveau baignés dans les bras morts de la Drave, puis avions enlevé les sangsues qui recouvraient le corps de l’autre. Nous étions allongés, Jakob et moi, dans le berceau de foin, sous les toiles d’araignées, et entendions le couinement des rats. Je penchai ma tête sur ses hanches aussi blanches que la chair des amandes et glissai dans ma bouche son sceptre rouge gorgé de diamants incolores. Toutes les fois où, de mes doigts, je saisissais son membre flasque et faisais glisser son prépuce d’un mouvement rapide de va-et-vient, il se transformait en sapin qui, sous les assauts d’une tempête, répand de chauds flocons de neige. Des chauves-souris étaient suspendues aux poutres, au-dessus de nos corps devenus moites. Le foin bruissait. Tandis que les éclairs dans le ciel se croisaient au point de jonction des deux bras de la croix dessinée par notre village, Jakob m’expulsa sa semence dans la bouche. Je me penchai sur ses cuisses, relevai ses testicules blonds et humai le parfum de son bas-ventre. Comme il s’arc-boutait et écartait largement les jambes, j’introduisis ma langue dans son anus au duvet blond. Bien que Jakob soit maintenant mort depuis plus de dix ans déjà, et pourrisse dans la terre grasse du cimetière de Kamering, je sens encore sur mon palais le goût de sa semence. Jusqu’à la fin de mes jours, je la porterai partout avec moi, dans mon intestin.