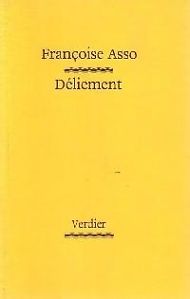
Françoise Asso
Déliement
Collection : Collection jaune
112 pages
15,01 €
978-2-86432-126-2
avril 1991
Un récit mille fois répété ; des tentatives vaines pour sortir d’un malaise dont on ne sait s’il est réel et combien réel il est, en appliquant deux thérapies qui semblent s’opposer ; l’impossibilité de ramasser en un seul geste parlant une image de soi qui tienne sur un miroir ou sur une page ; un questionnement où est en jeu ce que peut être une description de la jalousie : voilà quelques-uns des thèmes qui composent l’essence de ces histoires.
Ce qui les lie en un ensemble unique, c’est cette capacité diabolique, qui est le don de Françoise Asso et qui en fait une puissance créatrice, de nous offrir des paroles tout à fait nouvelles pour dire des choses que nous croyons connaître ; les sentiments et les modes qui les content tracent un écart profond et dangereux entre la réalité qui les fait naître et le réel qui inlassablement les travaille. Ainsi, « ce qui est terrible dans la jalousie… », c’est le silence cuivré qui garde l’écho des mots glissants et poisseux, de mots qui durcissent et ne passent plus ; tandis que l’envers de la jalousie tiendrait dans un langage constitué uniquement d’harmoniques dont on ne percevrait que le flottement, ou quelques points lumineux reliés entre eux qui ne cessent de se transformer en grouillements.
L’écriture est ici comme un état liquide qui se glisse subrepticement entre les failles de tous les discours convenus et recrée une langue nouvelle où l’esprit se meut dans les plis et les replis d’une casuistique baroque et la lettre dans la plus grande pureté classique.
Il y a dans mon histoire des trous qui m’attirent, des blancs qui m’aveuglent, des temps morts, ou plutôt il y a, dans ce que j’appelle mon histoire, des vides trompeurs dans lesquels elle se fait et se défait, et si rapidement que le temps d’énoncer une vérité suffit à la ruiner ou, pire encore, à l’altérer, comme si j’étais trop lent pour ma vie, comme si, en retard toujours d’une mesure, d’un mouvement, je ne la rassemblais que lorsqu’elle est sur le point de s’effilocher – ce qui suppose que, dans les moments de stase, je ne dise rien, alors qu’il serait si simple de profiter de ces moments-là pour dire qui je suis, où je suis, dans quel état, sous quelle forme. Ce que j’appelle mon histoire, et parfois ma vie – cette déplorable absence de rigueur tend à pallier l’incertitude où je suis de mon statut réel par un flottement terminologique –, a pris ces derniers temps une allure singulière en se limitant à trois points, que je crois reliés entre eux d’un crayon très fin ; peut-être est-ce mon goût des figures qui me fait voir ou dessiner moi-même les côtés de mon histoire triangulaire, mais des trois points eux-mêmes, l’histoire de ma parole, l’histoire de mon regard sur elle, l’histoire de son regard sur moi, je suis certain, ainsi que de leur fixité comme points-idées, et de leur mouvance comme points-masses, car le point c’est, bien sûr, ce qui de loin scintille, signe de surface, de profondeur, de volume et de bruit, fiché vibrant dans l’œil, et susceptible de déplacements infinis, quoique toujours dans l’œil qui, sans doute, avec lui va trembler un peu plus loin. Et les vides qui se creusent ici ou là, à l’endroit même où le point vibrait il n’y a qu’un instant, sont comme de vertigineuses échappées où l’histoire se tapit pour m’attendre ; non qu’il y ait une histoire des surfaces et une histoire des profondeurs, celle-ci puissante à la mesure de l’ombre où elle se relègue, mais c’est là que l’histoire se fait et se défait, là qu’elle se prendrait pour qui voudrait la raconter, là qu’elle se refuse aussi à qui veut la saisir en son vrai commencement. Je hausse épaules et sourcils à me surprendre à penser en ces termes – ne parvenant pas à décider ce qui prévaut en moi de l’agacement et de la surprise, je fais les deux signes simultanément, en m’y reprenant à plusieurs fois.