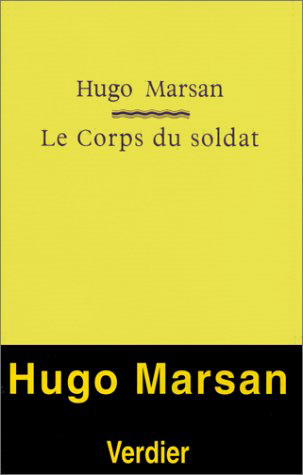
Hugo Marsan
Le corps du soldat
Trente ans plus tard, peut-on inverser le dénouement d’une histoire d’amour et de mort ? C’est le thème de la pièce qu’un couple de comédiens joue pour la dernière fois. Ils ont mis en scène la Guerre d’Algérie, telle que le narrateur du roman en garde mémoire.
Pour cette ultime représentation, les deux hommes sont revenus à Heavenbad, ville de canaux dont le rituel touristique cache d’innommables secrets. Le Corps du soldat est le dernier acte de la tragédie du souvenir. Un exorcisme que le personnage principal mène à son paroxysme, après que son compagnon malade l’a quitté. Il erre dans la ville morte, à la recherche de l’homme sans regard qui, comme lui, aima jadis l’enfant-soldat dont la chair sacrifiée est au cœur de l’histoire.
Le Corps du soldat est le récit d’une vengeance, seule violence possible dans un monde perpétuellement en guerre. Après Le Labyrinthe au coucher du soleil et Le Balcon d’Angelo, ce roman est le troisième volet d’une patiente épreuve de la mémoire, un huis clos impitoyable où le partenaire est le porte-parole et le témoin du passé. Les crimes ont toujours pour cible le bonheur des autres. Comme dans les polars, dont Le Corps du soldat est parfois un subtil pastiche, il arrive que la victime retrouve le bourreau, tapi derrière son reflet, et ne sache plus ce qui de la haine ou de l’amour inspire le meurtre.
Le troisième jour après notre arrivée, à l’heure de la sieste, le sergent donna le spectacle qui l’avait rendu célèbre dans toute la compagnie, une sorte de tribunal sommaire où de juge il se transformait en bourreau. Ce simulacre de justice immanente avait établi sa réputation. Il en répétait de loin en loin le rituel pour maintenir son autorité et sa légende.
L’accusation portée sur les villageois était dérisoire, le plus souvent inventée. Enfreignant les règles, huit hommes auraient été aperçus dans une rue du village après le coucher du soleil. Les coupables étaient convoqués au poste. J’ai toujours pensé qu’ils choisissaient eux-mêmes leurs boucs émissaires. Le chef du village faisait en sorte que tous les hommes valides subissent à tour de rôle les foudres de l’envahisseur. Le sergent-chef alignait les hommes au garde-à-vous, répétant l’ordre une bonne douzaine de fois jusqu’à créer un climat de panique. Il passait lentement devant eux, au plus près de leur corps dans ce goût qu’il avait de la promiscuité physique que le respect de la hiérarchie rend équivoque, s’arrêtait longuement pour rectifier du bout de sa badine l’alignement d’une jambe tremblante, frappait d’un coup sec une main qui ne gardait pas l’immobilité, redressait d’un coup plus violent une tête inclinée. La terreur s’imposait peu à peu qui gagnait les soldats eux-mêmes, au début supporters narquois, puis témoins muets des atrocités. Lorsque l’état de prostration était enfin obtenu, le sergent enfilait des gants qu’il réservait à cet office. Il se figeait face au premier de la rangée et frappait son visage de son poing. Si le fellah criait, il cognait une deuxième fois, un coup bref et précis qui atteignait l’arcade sourcilière. Chacune des huit victimes était ainsi méthodiquement tabassée.