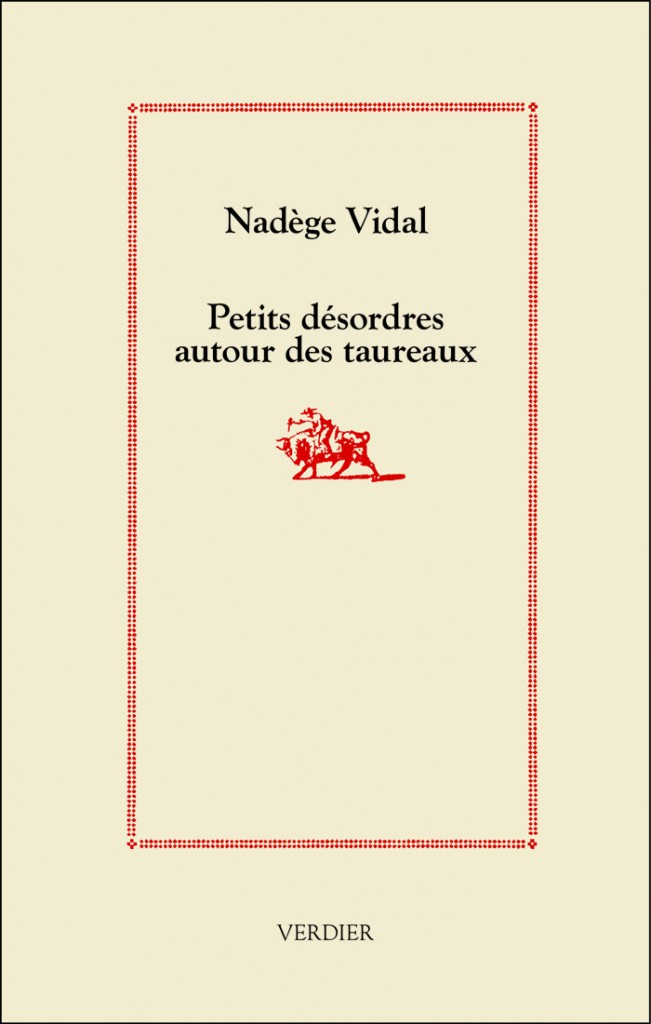
Nadège Vidal
Petits désordres autour des taureaux
Collection : Faenas
96 pages
14,00 €
978-2-86432-542-0
août 2008
Ce qui fait le prix des nouvelles de Nadège Vidal, c’est que pour la première fois, dans une fiction, un œil féminin, riche et complexe, éclaire la tauromachie d’une autre lumière. Pas en y projetant le point de vue politique classique (« le monde de la tauromachie est un monde d’hommes qui rejette les femmes ou les enferme dans les stéréotypes masculins » – ce qui est malheureusement le plus souvent la vérité), mais par le recours de la langue elle-même. Ce léger décalage, le tremblement des mots et des sentiments, représente un apport très original dans la prose taurine contemporaine.
J’ai voulu suivre une histoire plutôt qu’une nature, lâcher la bride à l’imaginaire en mes désirs retenu, enfourcher un risque pour affronter des chimères. Il fallut alors confronter mon image, ou ce qu’il en restait, au miroir où mon reflet a disparu, puisque je reviens d’un continent lointain et noir. Un jeune homme, presque un señorito, les mains dans les poches, a déréglé l’horloge du petit monde, en laissant quelque part un cadavre de poupée. Désormais, je me meurs au réel, disons à un certain réel, je quitte ma peau de femme, pour devenir un et trouver une harmonie convenable dans l’art de conjuguer, d’accorder un corps et un langage où les fautes ne sont pas exclues. À la toise, ce jeune homme n’appartient pas au cercle des Gargantua, mais ce n’est pas honteux, d’autant que j’ai usé de subterfuges matériels pour lui inventer, sous sa braguette, des frivolités. Sur le sol, mes mèches de cheveux sacrifiées signent l’abandon et le renoncement, tandis que mon nez un peu fort et ma mâchoire carrée jouent leur jeu. Sans état d’âme, j’avais bandé, avec application, mes petits seins. Il s’est tourné, et j’ai constaté que ses fesses n’étaient pas trop grosses, juste un peu rebondies. Seuls mes pieds et mes mains pouvaient le trahir. Je flottais dans les mocassins, trois pointures de trop, et j’avais glissé une chevalière à un auriculaire, sans conviction, rajouté une couche de gomina sur ma toison courte, tenté d’infléchir le sol de ma voix vers le mi-dire.
Au Londres, au Sofitel, les toreros ne tarderaient pas à revêtir leurs collants de coton, leurs bas de soie, leurs chaînes, médailles et bijoux, leurs paillettes et leurs ballerines.
Et quitter la glace pour la vitre.
Depuis la fenêtre de ma chambre, à la pension Alemania, celle que je préfère à San Sebastián, la Concha se déployait comme une tasse à café au lait.
La séance de métamorphose terminée, il était 15 h 35, je descendis sous l’œil surpris du cerbère n° 1, et j’allai au restaurant El Molinero engloutir quelques raciones, parce que, s’il faut appartenir aussi au siècle de l’ordre alimentaire, je préfère me goinfrer.
Je vérifiai ma carte de presse : en Espagne, les noms des fleuves et des rivières sont tous masculins. Pour les prénoms, les accords, le lexique ne tolère aucune ambiguïté. Un a ou un o vous change la vie. En France, s’appeler Dominique ou Claude, permet d’empocher la levée, tandis que sur les participes passés des verbes en er, le doute plane. Un jour, on ne pourra jamais plus tricher, se couler dans les personnages des rêves, s’inventer un monde différent, on aura une puce dans le cerveau ou sous la peau terrorisée qui déclinera tout de nous, nos convictions, nos faiblesses et nos forces. Un genre de confession grandeur nature, un jugement dernier, une inquisition flamboyante, et ce sera la fin de l’homme et le début des langues mortes. En attendant, on croit ressembler à une ombre tranquille.