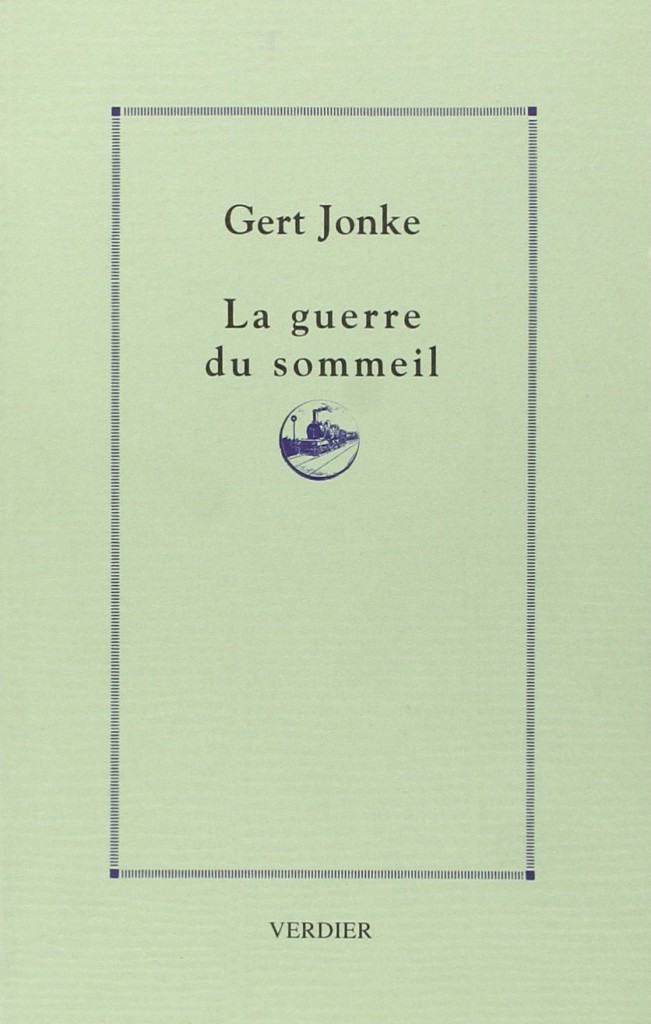
Gert Jonke
La guerre du sommeil
Traduit de l’allemand (Autriche) par Uta Müller et Denis Denjean
Collection : Der Doppelgänger
224 pages
15,22 €
978-2-86432-216-0
mars 1995
La ville que parcourt en titubant le musicien Burgmüller n’est pas tout à fait, sous ses allures de cité baroque d’Europe centrale, une ville comme les autres. Son altitude varie selon l’heure du jour, ses façades peuvent sournoisement changer de forme, et l’on n’est jamais tout à fait sûr d’y retrouver une gare à l’emplacement où on l’a laissée la veille ! En proie au chagrin d’un amour perdu, Burgmüller en découvre les étranges habitudes : des Caryatides et des Atlantes, que ses divagations passionnent et qui voudront bientôt apprendre de lui le secret de cette merveilleuse faculté qui leur est refusée depuis toujours : le sommeil.
Bien d’autres aventures prodigieuses que l’on ne saurait résumer attendent le héros de ce livre, quand les inspirations fantasques de son amie retrouvée l’entraîneront, pour la plus grande joie du lecteur, dans les errances capables de mettre à mal nos certitudes les moins contestables sur la réalité de l’espace et du temps. Au fil des pages, la formidable puissance d’invention comique de Gert Jonke défie d’un même mouvement les lois de la perception, les conventions narratives, et tout ce qui, dans les discours, les idées, les comportements sociaux ou individuels, a trop vite conquis le rang d’évidence. Car il s’agit ici, comme chez Diderot, chez Jean-Paul ou chez Sterne, de nous mettre en garde : sait-on jamais qui écrit l’histoire ? Et comment distinguer le vrai du faux ?
Le matin, d’ordinaire, la ville est enveloppée d’un épais nuage dont elle se dégage lentement ; puis, à grand-peine, selon les exigences variables du jour, elle monte vers l’auguste matin d’au moins trois ou cinq mètres, voire de sept ou neuf, dans les escaliers des arènes célestes.
À midi déjà, cette respectable position commence à lui peser, voilà pourquoi elle redescend en douce à son niveau habituel, afin de pouvoir s’adosser ensuite à l’après-midi confortable ; là, elle doit encore endurer bien des choses avant d’atteindre enfin le soir, dont elle se remonte la fourrure grise jusque sur les oreilles, avant de s’abaisser lentement de plusieurs mètres encore, de s’émietter à travers la membrane mitée qui recouvre la plaine ; on dirait que ses maisons se font aspirer, qu’il ne surnage plus que les quelques bonnets à pointe des cheminées, qu’il ne reste plus rien à part quelques impuissants battements d’ailes des toits, voltigeant et se balançant dans un murmure à peine audible sur la marée montante du crépuscule strié de crevasses ; puis le scintillement de la ville s’estompe et elle échappe au regard de l’observateur.
Le matin, les murs se mouchent et crachent par les fenêtres des chambres la literie mal réveillée ; les greniers toussent par les cheminées asthmatiques, quelques immeubles éternuent par les lucarnes ouvertes, çà et là un portail rejette dans la rue des escaliers éventrés, toutes marches à l’air, parfois même une enfilade entière de pièces s’éjecte des murs sur la place publique, et les caves voûtées tiennent à carreau leurs tas de patates qui rebondissent en pleine rébellion, alors que d’innombrables nuages en forme de méduse, pleins à craquer de poussière de charbon, soufflent par les fenêtres grillagées sur la circulation qui s’agite.
Il y a des jours où les immeubles rentrent leur ventre en encorbellement ; pudiques, ils replient les pointes élégantes de leurs balcons à balustres comme s’ils obéissaient à un ordre et se mettaient au garde-à-vous, murs droits, crépi lisse, au rapport devant les clochers de l’Hôtel de Ville, leurs supérieurs, qui en guise de bâton de maréchal arborent les chicots pointus de leurs clochetons à girouettes.
Il y a des jours où les rails des tramways bondissent hors de l’asphalte, s’ébrouent, se débarrassent d’arrêts inopportuns et transfèrent leur terminus quelques mètres plus haut, dans l’air.
Qu’étiez-vous venu chercher dans cette ville, Burgmüller ?
Dans cette ville, certaines nuits ont l’habitude d’amarrer leurs flottilles de voiliers noirs aux bouées à la cime des clochers, si fermement que leurs essaims de poussière s’y amassent encore le lendemain et que leurs ombres de rapaces nocturnes volent loin au-dessus de la tête des citadins, griffonnant tous les murs de leurs amples mouvements, ainsi que le plafond peint de la voûte céleste.
Qu’aviez-vous perdu dans cette ville, Burgmüller ?
Oui, les journées dans cette ville donnaient parfois l’assaut de leurs rayons solaires nés de la nuit, une explosion de champs fleuris jaillissait de l’aube, une pluie de pétales, une grêle rythmée de bourgeons de lumière se précipitaient hors des tunnels aériens, sous le poids d’une chaleur lourde, saturée d’une vapeur comme on en trouve dans la ouate sombre des greniers les jours d’orage. Tout se concentrait en un faisceau d’impacts, en étincelles de feu, de glace et de pierre. Quiconque se trouvait dessous avait intérêt à faire attention, à se cacher un moment – tout comme Burgmüller – de même qu’il ne fallait pas s’attarder sur les îles du fleuve qui dérivaient avant de s’évaporer, épuisées par leurs habitants.
Burgmüller n’était pas le seul à traverser de telles journées comme un interminable tunnel de lumière qui emprisonnait tout et qui, lentement, engloutissait la ville dans son tuyau tissé de rayons de soleil ; maintenant il lui collait à la peau, comme un préservatif extra-fin qui à tout instant menaçait d’éclater si jamais les immeubles, engoncés dans leurs murs, s’obstinaient à ôter le chapeau de leurs combles au fil de leurs salutations réciproques, et à lancer dans le vent leurs bonnets brodés de tuiles à des hauteurs telles qu’ils risquaient de s’y perdre.
Dans la période qui suivit, ce n’était pas seulement par de telles journées que Burgmüller s’éclipsait.
Car il avait fait la connaissance d’autres habitants de la ville, remarquablement différents ; depuis un certain temps déjà il s’entretenait longuement avec eux. De plus en plus attentif, il avait profondément plongé en eux, il examinait leur mode de vie. Il voulait le saisir dans tous ses détails, ainsi que le monde, tout à fait impénétrable pour lui, où ils séjournaient et où, certes, ils se mouvaient, malgré leur apparente immobilité.
Libération, 6 juillet 1995, par Gérard Meudal
Le Monde, 21 avril 1995, par Pierre Deshusses
« Panorama : Germaniques », par Michel Bydlowski, France Culture, 14 avril 1995.