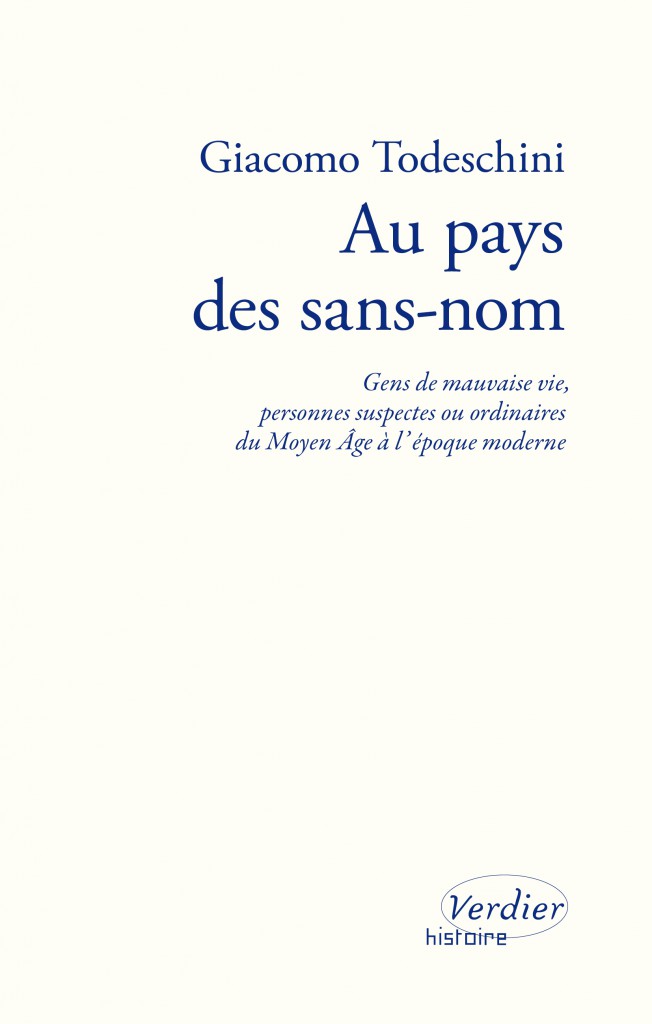
Giacomo Todeschini
Au pays des sans-nom
Essai traduit de l’italien par Nathalie Gailius. Préface de Patrick Boucheron
Collection : Histoire
400 pages
25,00 €
978-2-86432-785-1
mars 2015
Les infidèles, les malfaiteurs, les juifs, les hérétiques, les usuriers ; mais également ceux qui exerçaient un métier considéré comme vil ou déshonorant : bourreau, prostituée, domestique ; et plus largement les étrangers, les femmes et les « inférieurs » : les êtres difformes, les pauvres. Dans un crescendo de la suspicion et de la défiance, vont être catalogués comme « infâmes », des sujets privés de « renommée » en raison de leur provenance ou de leurs actes délictueux, ou simplement de leur condition sociale ou physique, qui ne pourront alors jouir pleinement des droits de la « civitas chrétienne ». Ce catalogue s’allonge démesurément au cours des siècles jusqu’à viser dangereusement la population tout entière.
À travers quelles pratiques et quels discours prit forme en Europe le code social de l’exclusion ? Qui contribua à en tracer les contours ? Quelles en furent les victimes ? Nourries par une analyse subtile des textes, telles sont les questions et les réflexions inquiètes abordées par cet historien majeur de l’efficace sociale du discours ecclésiastique.
Préface
L’infamie des hommes infimes, par Patrick Boucheron
Introduction
I. La cruauté des infidèles
1. Férocité
2. La ville et la forêt
3. Sectateurs de Caïn
4. Foi et crédibilité
II. L’infamie évidente
1. Ce qui est su de tous
2. Le catalogue des « infamies »
3. Ceux qui viennent d’ailleurs
4. L’infamie de droit
5. L’infamie de fait
III. Montrés du doigt
1. Les concubines
2. Le scandale et l’obéissance
3. Au vu de tous
4. Réintégrés et irrécupérables
IV. L’usurier en place publique
1. Usure et infamie publique
2. L’impudence de l’usurier
3. Usure, hérésie, extranéité
4. Préciosité et anonymité du temps
V. Les réprouvés utiles et inutiles
1. Les métiers à éviter
2. Le métier comme déshonneur
3. La profession comme risque
VI. Juifs, avares, gens ordinaires
1. Juifs et presque juifs
2. Foi et citoyenneté
3. Avares et « assassins des pauvres »
4. L’ennemi d’à côté
VII. L’infamie des pauvres
1. La pauvreté comme déshonneur
2. Les pauvres comme majorité à risque
3. Argent, propriété, identité civique
4. Le « bien commun » et les pauvres
VIII. Honneur citoyen et déshonneur économique
1. L’honneur travesti en déshonneur
2. Le déshonneur des gens comme il faut
3. L’appréciation de l’honneur
4. L’importance d’être au centre : la sanior pars
IX. Une humanité périphérique
1. La citoyenneté initiatique
2. Groupes et identités précaires
3. Le danger qu’il y a à être des « gens de peu »
4. De l’anonymat à la marginalité
Libération, 25 juin 2015, par Jean-Yves Grenier
Histoire pour tous, 8 juin 2015, par Aurélie Perret
L’Humanité.fr, 5 juin 2015, par Cynthia Fleury
Le Revenu, juin 2015, par Philippe Jérante
Le Point, 21 mai 2015, par Pierre-Antoine Delhommais
Télérama, 9 mai 2015, par Gilles Heuré
L’Histoire, mai 2015, par Jacques Berlioz
Le Monde, 30 avril 2015, par Étienne Anheim
Le Monde, 30 avril 2015, par Étienne Anheim
L’Obs, 19 mars 2015, par Laurent Lemire
Politis, 12 mars 2015, par Olivier Doubre
« Comment pouvait-on être “infâme” au Moyen Âge ? », France Culture, 14 mars 2023 : chronique de Gérard Noiriel.
« La Fabrique de l’histoire », par Emmanuel Laurentin (et avec Valérie Hannin du magazine L’Histoire), France Culture, vendredi 24 avril 2015, de 9h à 10h
« L’essai et la revue du jour », par Jacques Munier, France Culture, jeudi 12 mars 2015, de 6h35 à 6h42