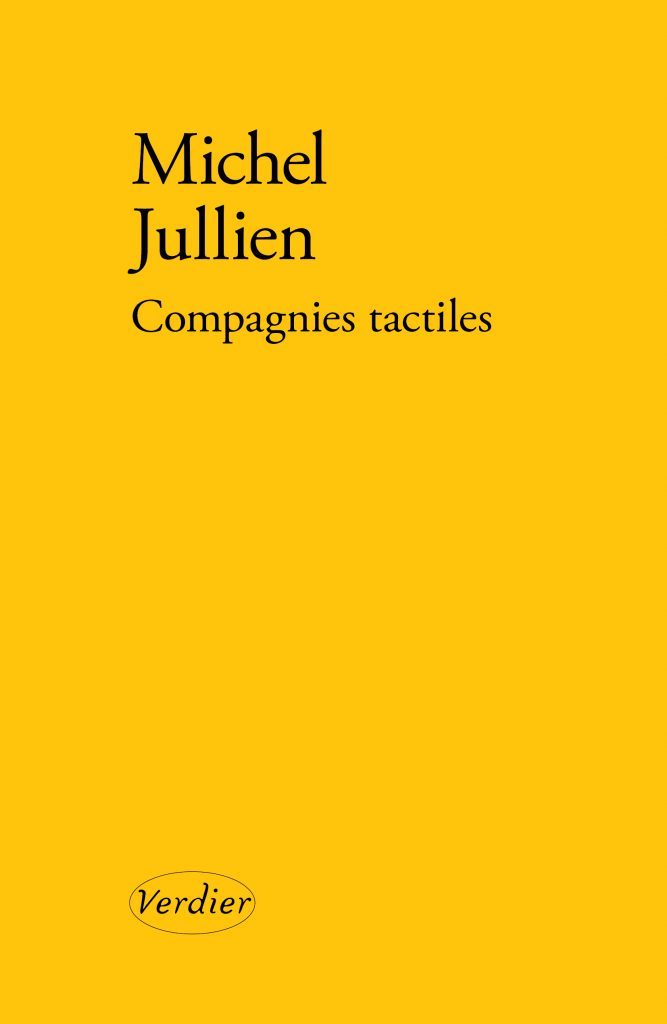
Michel Jullien
Compagnies tactiles
Collection : Collection jaune
80 pages
9,94 €
978-2-86432-575-8
mars 2009
À travers une suite de quinze textes courts, Michel Jullien propose une quête du toucher, évoque le souvenir de sensations tactiles issues de l’enfance. Sensations simples, communément partagées, enfouies dans la mémoire de chaque lecteur et que le narrateur lui restitue.
Comme tempo, il est donné que l’ennui fut un apprentissage inéluctable avec lequel l’enfant devait compter. Pour mieux y faire face, afin de le tromper, de contrecarrer l’attente, l’auteur crée un univers clos dans lequel s’établissent des connivences particulières, des « compagnies tactiles » : avec un aimant, un vélo, une clarinette démontée, une machine à écrire, une bougie de voiture, l’algue, la figue… Autant de variations sur des fétiches passés au microscope. Avec eux, il construit des conversations hésitantes, menées à voix basse, des dialogues intimes, des variations sensuelles, une suite d’anciennes faveurs remontées de l’enfance.
Avec une poétique qui, parfois, rappelle Le Parti pris des choses de Ponge, Michel Jullien revient sur l’évocation étonnamment précise d’une manipulation, la conscience qui l’unit à ces sensations intimes. Comme si l’esprit du narrateur possédait une fraîcheur sans cesse renouvelée, mettant de côté les acquis et les présupposés pour accueillir ce qu’il perçoit dans son essence même, dans sa singularité et son étrangeté.
Les qualités physiques de l’objet et les qualités linguistiques du mot apparaissent sur le même plan. Chaque objet commande sa propre rhétorique destinée à rendre compte de ses qualités. Ces objets, ces matières formant des mondes aimés, sont à ce point disséqués que les quinze pièces introspectives constituant ce recueil finissent par former elles-mêmes des objets palpables : à son tour la lecture devient tactile.
J’ai démonté l’aimant carré de mon placard en formica, un spécimen d’une puissance exceptionnelle. Pour ouvrir la porte, il fallait s’y reprendre, convoquer une force exagérée pour un geste somme toute anodin. Et lorsqu’on la repoussait d’une chiquenaude, elle s’en allait rejoindre l’embrasure sous l’effet du magnétisme mieux que sous l’impulsion de la poussée. Cela produisait un claquement désagréable, sec, après quoi tout semblait se taire dans l’appartement. Je l’ai démonté – la porte bâille lâchement depuis qu’a cessé la scène du heurt entre l’aimant et sa réplique métallique –, je l’ai glissé dans le fond de ma poche et, de même qu’on agrémente l’existence de nos poissons, décorant d’algues et de rochers leur bocal, d’épaves, de trésors miniatures, j’ai pris soin d’alimenter son repaire. Il gît parmi un assortiment sélectionné de petits morceaux pêle-mêle, ferreux ou non, des débris : une bille d’acier, des brins de fil, un trombone, deux clefs sur un trousseau, des peluches de fer, des restes de tabac… Le décor varie. En fourrant ma main à l’aveugle dans la poche, je devine du bout des doigts la nature respective des matières. Je tombe d’abord sur l’aimant, lourd au fond de l’habit, légiférant le petit monde fini de mon veston avec une assiduité de kapo. Je palpe les individus en marchant comme le cyclope aveuglé tâtait le dos des moutons sortant de sa grotte. Je saisis l’aimant, le racle sur toutes ses arêtes, libère la limaille. Je m’amuse à contrarier l’ordre de l’antre un certain temps, puis je lâche tout. Une nouvelle disposition revient aussitôt, soumise à l’intransigeance du petit concierge dans sa tanière.
« Dans quelle éta-gère… », par Monique Atlan, France 2, lundi 1er juin 2009 à 8h50 et avant le journal de la nuit