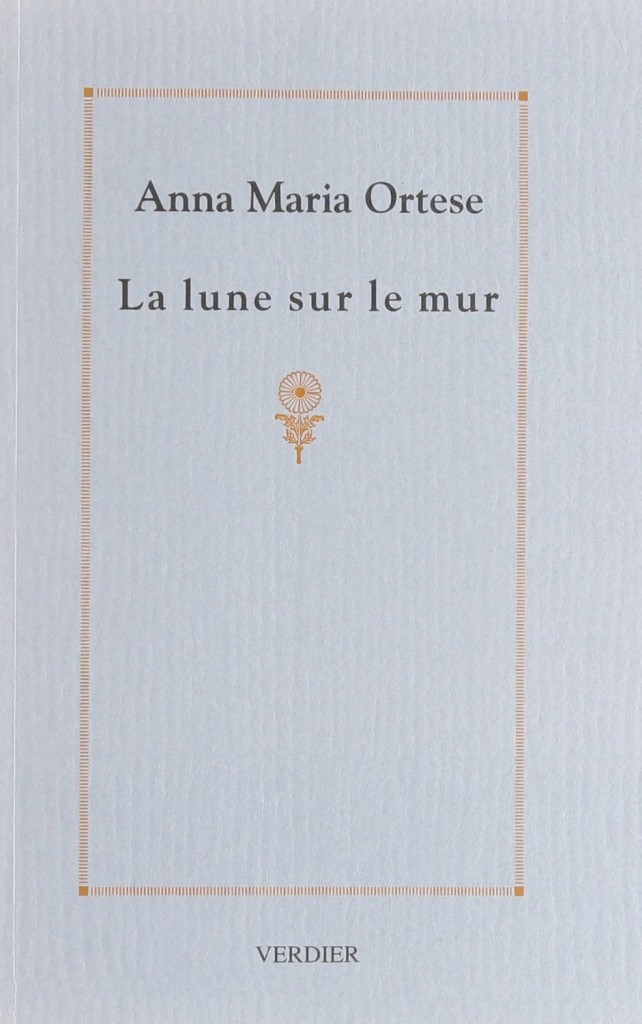
Anna Maria Ortese
La lune sur le mur
Nouvelles. Traduit et préfacé par Bernard Simeone
Collection : Terra d’altri
120 pages
10,14 €
978-2-86432-124-8
mars 1991
Rome, Naples, Milan… L’Italie d’Anna Maria Ortese, pauvre et seule, se peuple d’exclus promis à une déréliction aussi profonde que leur soif d’aimer : un frère et une sœur connaissent avec le départ d’un ami la fin des utopies généreuses ; une jeune femme des beaux quartiers assiste à la détresse d’une serveuse avant que ne retombe entre elles un voile d’impuissance et d’hypocrisie… Mais dans ce désert, d’autres personnages – un Anglais entouré d’animaux, un jeune couple que son idéal de pauvreté rend immatériel – incarnent l’innocence intacte et le rêve. Par leur vibration triste et belle au bord du gouffre, êtres et lieux veinent d’une subtile exaltation ces récits faussement réalistes où l’auteur, livrant un quotidien souvent tragique, parfois fantasque, oppose à la douloureuse apparition qu’est le monde une épiphanie de bonté : la quête périlleuse du don.
Mais le déluge et sa menace, pour l’heure, étaient passés. Venait une pluie fraîche et belle, comme des larmes attendues, elle venait à Bologne depuis Orte, et tout était plus sombre et plus clair, plus aérien et précis, plus éclatant et tendre. Puis il tonna un peu, puis il cessa de pleuvoir, puis il plut à nouveau, mais doucement, comme les petites larmes d’une veuve, et là, entre ces larmes, se leva comme un rêve un grand arc lumineux.
On vit, dans cet arc de trois couleurs, un beau coteau, avec une maisonnette et deux arbres et, derrière, un nuage couleur abricot, qui ressemblait à un beau navire. « Et qui donc nous amènera ce navire, me mis-je à penser, qui seront, dans dix ou vingt ans, les nouveaux seigneurs d’Italie ? »
Sur ce navire, il me sembla voir accoudés deux anges du Trecento, peut-être même bibliques, mais on ne comprenait pas s’ils s’approchaient ou bien s’ils nous quittaient pour toujours : leur visage un peu pâle était légèrement incliné, de leurs yeux baissés s’échappait je ne sais quelle parole triste et tendre.
Puis, peu à peu, l’arc-en-ciel se défit en une myriade de gouttes et le train ralentit sur un immense pont de fer : au-delà du pont apparurent deux rives et des barques tranquilles, une plaine enveloppée d’une légère brume.
Ici, dans la vallée du Pô, on eût dit déjà l’automne : ici, ni printemps, ni été ; ici, du fer et la tête vide ; ici, nuit, brume, soliloques, pain.