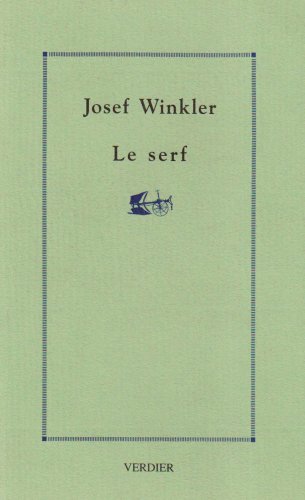
Josef Winkler
Le serf
Roman. Traduit de l’allemand (Autriche) par Éric Dortu
Collection : Der Doppelgänger
304 pages
15,22 €
978-2-86432-174-3
septembre 1993
Né dans une vallée des Alpes de Carinthie, dans le sud de l’Autriche, Josef Winkler pourrait fuir son village, gagner les villes, s’installer par exemple en Italie. Mais l’enfant prodigue hait trop son pays pour pouvoir le quitter durablement : c’est sur place, avec pour armes quelques livres admirés et la violence baroque de son écriture, qu’il lui faut mener son combat. « Serf de la mort », il compose avec ce livre tourmenté une symphonie funèbre aux thèmes vengeurs : la violence ordinaire de celui qu’il appelle « le laboureur », son père ; la folie croissante d’une sœur à jamais figée dans ses voiles de deuil ; le lent déclin de sa mère ; la vie méprisée des servantes et des valets de ferme ; la toute-puissance d’un catholicisme qui exalte la souffrance et n’a plus d’autre fonction que répressive ; enfin sa propre homosexualité, que sa révolte le conduit à afficher et, face au mépris général, à vivre comme un destin. Le village de Kamering, brûlé par les enfants à la fin du siècle dernier et reconstruit en forme de croix, acquiert ainsi la force d’un mythe qui contraste avec l’idée que notre temps voudrait se faire de l’innocence perdue du monde rural.
Michael ! J’aimerais arracher les ongles de tes pieds et déposer des perles sur tes orteils sanglants ! J’aimerais, de mon museau de hérisson, fouiller le drapé rouge du linceul de tes couilles où s’embourbent deux prunelles aveugles, et de ma langue, puiser le lait à ta fosse ombilicale ! J’aimerais exposer ta crasse et tes immondices à l’étal de ma chambre, afin que les admirent aussi tous ceux qui longent ma fenêtre. Qui me servira tes talons coupés au festin de nos noces ? Comme jadis, quand, vêtu de mon surplis rouge d’enfant de chœur, je laissais lentement fondre les hosties sur ma langue, je garde aujourd’hui sur ma langue la semence des garçons, attendant qu’elle s’écoule entre mes dents et dégoutte de ma bouche comme la salive de la gueule d’un chien.
Quand Michael rentrait de la pêche, il déposait les truites mortes sur son piano noir, avant de les éventrer à la cuisine pour leur extraire les entrailles. Il mettait des grenouilles mortes sous mon oreiller, que je découvrais seulement le lendemain matin en faisant mon lit. Je ne percevais qu’une odeur de putréfaction, me rappelant celle des marécages, tandis que je me retournais sans cesse dans mon lit et m’endormais sur le cœur des grenouilles mortes. Un jour, il me fit réciter à genoux le Notre Père, m’ayant promis que je pourrais ensuite le toucher. Mais lorsqu’il m’eut écouté, il partit d’un rire moqueur et s’enfuit vers la rive du lac. Si tu me tues, lui dis-je un jour, je m’efforcerai, dans mon agonie, à ce qu’on croie à un suicide. Michael n’obtempéra pas à cette invite, mais sa cruauté était sans bornes : il éventra vivante une chatte enceinte. Tandis que l’animal qu’il avait cloué à une croix en bois hurlait et gesticulait, les petits embryons nus et roses s’échappèrent du ventre et tombèrent sur le sol. Il ouvrit une truite et y introduisit son membre en érection. La semence s’écoula de la gueule du poisson après qu’il eut retiré du corps de l’animal son sexe raide et maculé de sang.
Le môme de seize ans me promit que je pourrais le déshabiller une nouvelle fois si je me laissais enfermer plusieurs heures dans la cave. Il y régnait une odeur de pommes de terre, de crottes de rat, de bouteilles vides de moût et de liqueur de sureau, de pommes et de poires pourries, de terre fraîche. Une lampe à pétrole éclairait ce lieu tapissé de toiles d’araignées. Je pris un sac de jute que je posai sur un cageot de pommes et m’assis. Les heures passèrent, mais Michael ne vint pas. Comme la cave n’avait pas de fenêtre, je ne sus plus, au bout d’un certain temps, s’il faisait encore jour ou si la nuit était déjà tombée. Assis sur la caisse de pommes, je songeai au laboureur et à mes frères avec qui je tuais des rats que nous portions du bout de la queue jusqu’au fumier. Lorsque nous croisions ma sœur le balai à la main, en traversant le couloir avec le rat mort, nous cachions l’animal derrière notre dos et, une fois à sa hauteur, le brandissions sous son nez comme un mouchoir noir. Ravis par ses cris, nous inspections la cave en quête d’autres bestioles.
Tandis que, d’une main, Michael massait le prépuce de son membre d’un mouvement de va-et-vient, tenant dans l’autre main une revue de photos en couleur de femmes entièrement nues, sa mère, debout derrière la porte, s’écria, mais qu’est-ce que tu fais là ? Michael ramena aussitôt les couvertures sur son ventre nu. Michael arrache les cheveux blonds d’une jeune fille étendue morte sur le sol de l’église : Si j’avais eu un pistolet sur moi, je me serais tué sur-le-champ. J’imaginais que je crachais sur elle, couchée dans son cercueil, et que je léchais ma salive sur son visage froid et cireux. J’aperçus un jour son cadavre au fond du lac de Millstatt. Sa chevelure ondoyait comme des plantes aquatiques. D’immenses anges en pierre vêtus de noir veillaient la morte. Le corps de ma mère, sous les scellés de l’eau profonde, était exposé au milieu du lac, sur son lit funèbre. Ses mains étaient croisées, prises dans l’enchevêtrement d’un chapelet en plastique. Elle était coiffée de la barrette rouge des cardinaux. Des poissons en flammes tournoyaient autour de sa dépouille. Lorsque je m’aperçus que la morte tenait ma verge raide entre ses mains jointes, je m’éveillai en sursaut et cherchai le trou sanglant entre mes jambes.