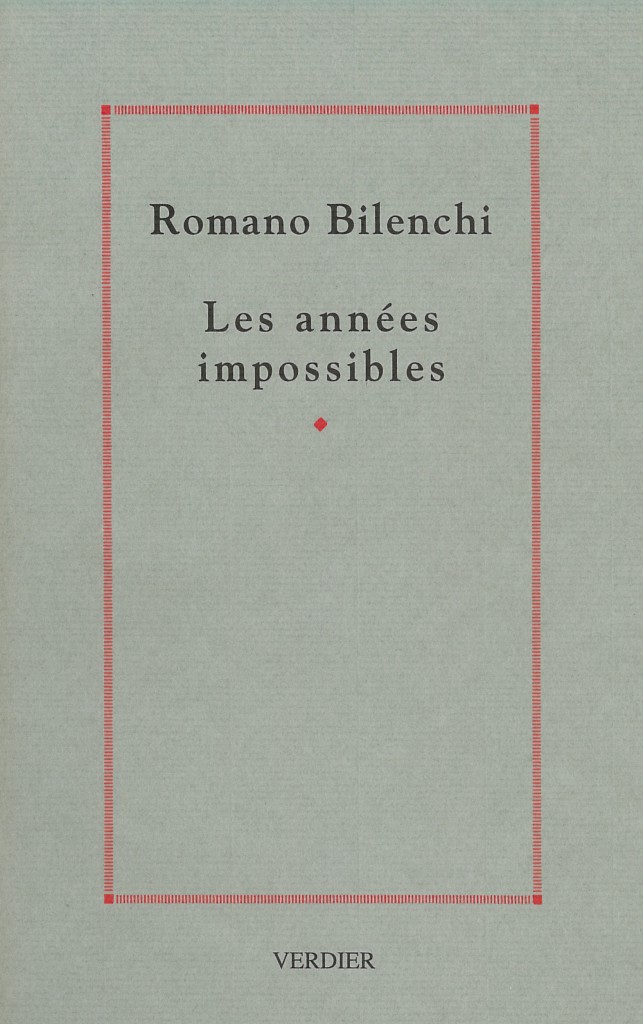
Romano Bilenchi
Les années impossibles
Récits (trilogie). Traduit par Marie-José Tramuta. Préface de Mario Luzi
Collection : Terra d’altri
192 pages
14,70 €
978-2-86432-191-0
avril 1994
L’arrière-pays de Sienne est une terre tantôt prodigue de vert, tantôt âpre et nue. Y naître, y grandir, y devenir adulte, c’est découvrir qu’à l’apaisement du paysage peut succéder soudain sa violence ou celle des hommes. Dans la Toscane provinciale du début du siècle, le jeune garçon des Années impossibles idéalise la figure de son grand-père, autrefois propriétaire d’une auberge, qui l’initie à la plénitude d’une campagne menacée par les passions. Mais ce guide s’éloigne, s’égare dans ses chimères, puis meurt. La brutalité ou la ruse des humains, la sécheresse qui prend possession de la terre et des êtres tel un monstre implacable, autant d’épreuves pour le garçon qui apprend, avec la vie, l’ambiguïté, la cruauté, ce gel qui toujours le séparera des hommes, tout en l’unissant à eux.
Bilenchi explore avec la précision d’un entomologiste et l’intensité d’un poète les plis et replis de l’origine, cette enfance qui nous constitue si intimement qu’elle en paraît incroyable voire, par chacune de ses années, impossible, et qui tisse pourtant tout au long d’une vie, comme le souligne Mario Luzi dans sa préface, les fils d’une temporalité infinie.
L’histoire de cette trilogie est singulière : ses deux premiers temps, La Sécheresse et La Misère, parurent à Florence en 1941. Le Gel, lui, fut publié, isolé, en 1982. L’auteur estima, deux ans plus tard, que ces trois récits, dont le dernier avait été composé plus de quarante ans après les deux autres, constituaient une seule fiction en trois mouvements. Il en remania certains aspects afin d’accroître la cohérence du triptyque.
Le printemps s’achevait, ç’avait été un printemps étouffant, uniforme, privé de ses lumières habituelles et de ses couleurs, avec très peu de pluies, et la pluie avait été rare aussi pendant l’hiver, quand survint la sécheresse. Le soleil, se dressant sur les malédictions des habitants de la ville, s’empara de tout. Un monstre terrible s’était établi dans le ciel et de là-haut plongeait ses tentacules dans la terre. Il tuait les plantes, s’acharnait sur les animaux et les hommes. La mort avait frappé d’abord les faubourgs de la ville, aussitôt dépouillés de toute végétation, et s’était abattue sur les collines telle une vague géante, envahissant aussi l’étendue des champs et des prés. Elle avait attaqué et desséché de même les bois des collines et ceux plus touffus des vallées. Sur les collines se trouvait le domaine de grand-père, notre domaine. Nous allâmes lui et moi le visiter. Les plantes étaient desséchées, les fruits noirs, flétris. La maison bleue était devenue blanchâtre, brûlée, inhospitalière. Le paysan pleura, et sa femme aussi. Grand-père les consola tout en essuyant la sueur de son front et de son menton. Moi aussi je transpirais d’émotion. Nous revînmes tout de suite sur nos pas. En chemin, grand-père donna libre cours à son désespoir, affirmant que désormais il était ruiné. Il dit que s’il avait eu d’autres capitaux, il aurait essayé d’amener l’eau du fleuve sur les collines, mais ensuite il ajouta qu’un tel travail aussi aurait sans doute été vain. Toutes les années de travail à l’hôtel allaient être balayées par ce désastre. Il n’aurait pas les moyens de reprendre les cultures quand la sécheresse serait passée. Il maudit le genre humain qui, par son inconscience, avait attiré la sécheresse sur la terre et jura qu’il tuerait le premier qui émettrait une opinion quelconque sur le cours du temps.