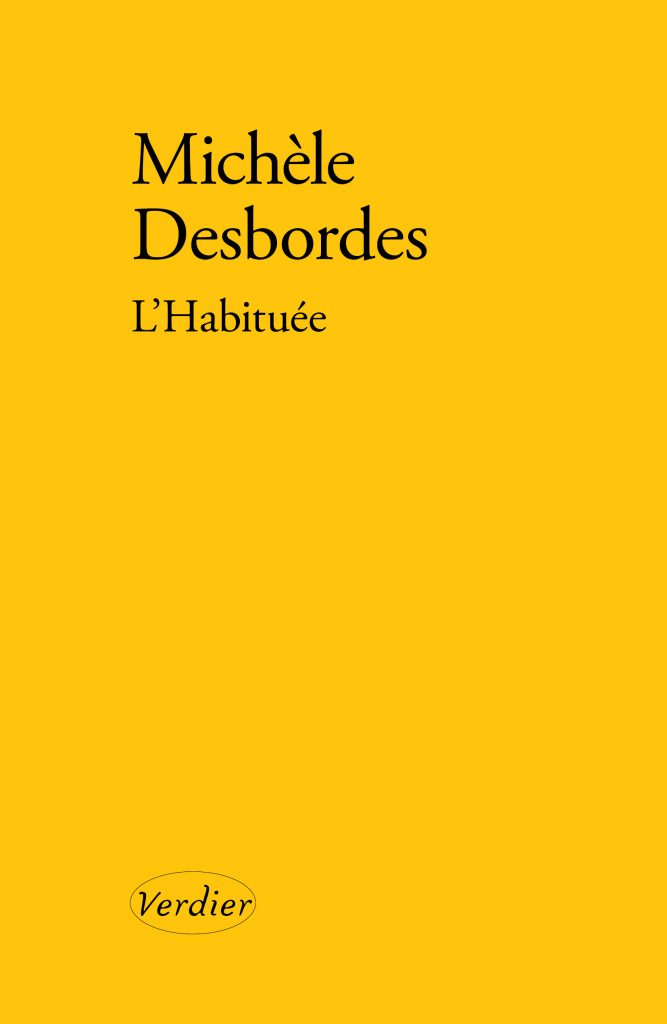
Michèle Desbordes
L’Habituée
Collection : Collection jaune
192 pages
15,22 €
978-2-86432-253-5
décembre 1996
Au village, dans sa villa L’Habituée, le colonel vit retiré depuis trente ans, avec deux filles et sa petite fille. Un soir de décembre, il meurt. Avec sa disparition, le silence qui entourait la famille est enfin levé. C’est de la servante, Adrienne, que la narratrice, qui habite une maison voisine, apprendra le récit de ces vies enveloppées de mystère jusqu’à ce que soit révélé au lecteur tenu en haleine le secret tant attendu. Après la mort d’Emmeline, la femme du colonel, Adrienne s’est occupée de l’intendance et a élevé les trois sœurs, Gabrielle, Constance et Mathilde, sous le regard peu amène du père. Peut-être trop tôt habituées au malheur, elles vont connaître chacune un destin éprouvant contre lequel elles n’oseront jamais lutter. Des amours contrariées ou honteuses façonnent trois grandes solitudes que les événements ne feront qu’exacerber. Sur un rythme lent et posé comme des paysages de landes et de côtes escarpées, le roman met en œuvre une action vivante, et fait preuve d’une grande maîtrise et de beaucoup de charme dans la narration.
La vraie, l’ancienne mémoire. La mémoire éparpillée, affaiblie dans ses interminables méandres, jusqu’à ce que parfois, avec la beauté des choses perdues, surgisse une image d’une absolue netteté. Mathilde qui à peine descendue du car courait jusqu’à la grille blanche au bout du chemin, puis quelque part, non loin de là, un autre jour, un jour ordinaire, un moment très bref quand elle se tournait vers vous, le sourire et le regard de Gabrielle, profond, appuyé comme si soudain elle vous retrouvait après une longue absence, ou comme si simplement elle découvrait alors à quel point elle vous aimait.
La mémoire vive, enfouie, comme insoupçonnable, sous toutes ces strates de souvenirs plus ou moins récents qui se fondant les unes aux autres, en arrivaient à mêler les temps et les lieux – seul le temps d’Emmeline était marqué, circonscrit, et leur offrait par la présence même de leur mère les repères dont elles finissaient par manquer. Ainsi en était-il d’inoubliables comme les dimanches d’été quand ils déjeunaient sous les tilleuls de la terrasse, et pourtant il ne s’y passait rien, rien d’autre que le temps qui coulait doucement et parfois à peine perceptible, un léger ennui, oui sans doute, aussi impalpable que la brume d’un matin d’été l’ennui était-il là et le savaient-elles. Un de ces ennuis vaporeux, comme aériens, qui accompagnent les jours tranquilles. Elles avaient sorti les nappes blanches et les plats d’argent, et sur la table les carafes ruisselaient de l’eau où on les avait mises à rafraîchir. L’air était léger, le vent agitait les feuillages et quand il montait des terres, il portait avec lui des bouffées d’herbe chaude, tandis que doucement la mer venait battre la falaise. Elles mangeaient en silence sous le regard de leur père jusqu’à ce que, par une observation, ou l’une de ces questions qu’il leur posait parfois, il donnât le signal d’une conversation entre eux. À l’une des extrémités de la table, à l’ombre de son grand chapeau de paille, Emmeline lui faisait face, elle souriait encore.
La mémoire de ce qu’elles avaient toujours su, comme la mémoire d’autres choses qui appartenaient aux rêves, inconnues, insoupçonnées même parfois, aussi précise pourtant que le souvenir de ce qu’elles avaient vu et entendu réellement (jusqu’à ne plus savoir quand elle relira les carnets démêler elle-même le vrai du reste, et cela bien avant qu’elle n’oublie, bien avant les années sur le palier. Oui un jour tout finissait par se ressembler et quelle importance cela pouvait-il avoir ?).
La mémoire des jours difficiles et, les précédant de si peu tellement était fragile la frontière qui les séparait, la certitude de quelque chose qui devait ressembler au bonheur, et si peu de temps ensuite, si peu ! pour qu’elles comprennent que tout était perdu, l’heure très brève, la fraction de minute qui séparait le bonheur du malheur. Le vrai. Celui qui ne laisse rien derrière lui. Si joyeuse Mathilde quand elle voyait la pluie, et qu’elle sortait en courant sur le chemin entre les genêts, elle qui bientôt et pendant longtemps appellerait sa mère dans la solitude glacée du dortoir où en plein milieu de la journée elle montait se réfugier, tandis qu’en bas dans les salles du pensionnat les leçons continuaient.
Le moment approchait où, sans même avoir eu le temps de rien qui ressemblât un peu au bonheur, elles n’auraient plus que des souvenirs ; ce moment où cessant peu à peu d’imaginer les lendemains, jeunes encore et bien avant la vieillesse – et sans même avoir soupçonné la nature de ce qu’elles ignoraient, le vertige fugace et profond des découvertes et des commencements puis (même si elles étaient de plus en plus brèves et rares) ces trêves qu’on connaît dans l’inébranlable avancée des chagrins, des déceptions ou des malheurs, quand à la douceur se mêle encore l’exaltation, l’espoir ou simplement la confiance – elles commenceraient à se dire que l’important maintenant était derrière elles. Lorsque comme d’autres de leur âge elles pensaient encore aux lumières des villes et à tous ces endroits où les gens se rencontraient, aux salles de bal, aux longues robes claires qui tourbillonnaient sur les parquets luisants, aux parfums légers et aux fleurs dans les cheveux des femmes, était-ce pour se dire que cela les concernait ? Les choses se mettaient en place pour plus tard, pour bientôt, quand peu à peu et sans jamais rien avoir soupçonné, insensiblement à l’attente succéderait la mémoire, et rien d’autre que la mémoire.
Oui le moment approche, elles sont dans la dernière ligne droite et c’est comme si elles le savaient. Mais cela fait partie des choses qu’elles taisent. Une fois encore elles préfèrent le silence aux annonces bruyantes et claironnées comme des certitudes.