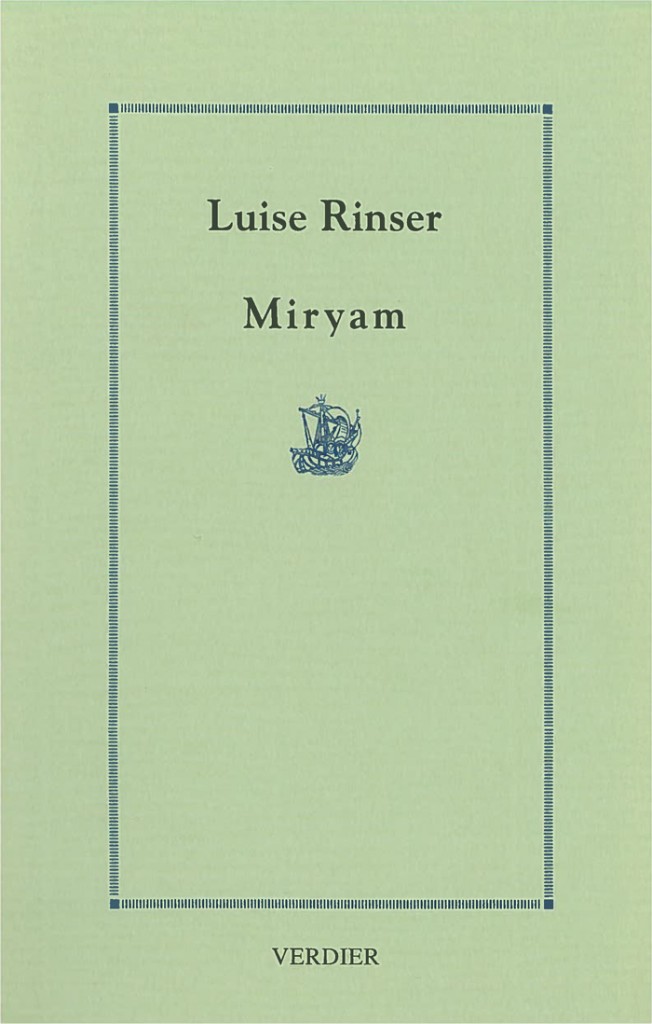
Luise Rinser
Miryam
Roman. Traduit de l’allemand par Jean-Yves Masson
Collection : Der Doppelgänger
272 pages
23,33 €
978-2-86432-208-5
septembre 1994
« Marie-Madeleine, c’est ainsi que vous m’appelez. Mais il faut que vous me donniez mon vrai nom : Miryam. En araméen, ma langue maternelle, Miryam veut dire : la Belle, et aussi : l’Amère. L’un et l’autre me conviennent : je fus belle, et il y eut beaucoup d’amertume tout au long de ma jeunesse, jusqu’au jour où je rencontrai Yechoua ; et une autre amertume encore m’était réservée pour le jour où il fut tué. »
Réfugiée dans la grotte de Saintes-Maries-de-la-Mer, Marie de Magdala se souvient et raconte, sans rien cacher de ses indignations, de son amour, de ses faiblesses, la quête de liberté et la soif de justice qui l’amenèrent à se joindre aux disciples du rabbi de Nazareth.
La romancière qui lui prête sa voix, s’appuyant sur une documentation historique précise, relève le défi de la fiction et arrache aux clichés les personnages que l’on croyait connaître. Laissant à chacun la liberté de conclure selon ses convictions, c’est avant tout le portrait saisissant d’une femme passionnée qu’elle livre au lecteur.
Magdala est le nom de la ville d’où je viens. Une petite ville en Galilée, amoncellement de cubes de pierre blanchis à la chaux, si blancs qu’ils aveuglent sous le plein soleil et brillent dans le clair de lune. Une ville marchande, une de ces villes aux odeurs fortes, parfums et puanteur mêlés : l’odeur de poisson venue du lac de Tibériade et de l’aire de salage, les parfums des denrées dont mon grand-père faisait le négoce en gros : bois de santal, myrrhe, baume, huile d’olive parfumée ; et, se mêlant à tout cela, l’odeur des bouses de chameaux et de l’urine des ânes, et la sueur des hommes, des commerçants et des caravaniers qui venaient du désert. Lorsque le vent du nord soufflait, il purifiait l’air, et la ville, pendant quelque temps, sentait le désert et les neiges lointaines de l’Hermon. Ma ville natale. C’est aux poissons qu’elle doit son nom ancien : Migdal Nounaya, la citadelle des poissons. Les Grecs qui vivaient dans la province orientale voisine, la Décapolis, l’appelaient Tarichaia, et ce nom lui aussi est lié aux poissons.
Lorsque, longtemps après la mort de Yechoua, je vécus dans ma caverne, dans cette contrée qu’on appelait la Provincia, bien loin de mon pays natal, bien loin du théâtre de la grande souffrance, l’odeur de la mer arrivait jusqu’à moi, portée par le vent d’ouest : une odeur de sel, de poisson, odeur bien connue, mêlée à vrai dire avec une étrange odeur d’eaux mortes et de marécages ; mais la faible trace d’odeur de sel et de poisson suffisait à éveiller mes souvenirs, et me faisait mal. Durant ces jours-là, je me recroquevillais dans le recoin le plus profond de cette caverne profonde, je frappais de mes poings la roche rugueuse et mouillée, et je criais, appelant Yechoua. Tout en sachant parfaitement la vanité de mes cris, je criais et je frappais autour de moi. Je criais si fort que les moutons qui paissaient devant ma caverne s’enfuyaient à toute allure en même temps que les chiens de garde et que le berger qui m’apportait chaque jour du pain et du lait. C’était lui qui m’avait montré la caverne, alors que j’allais au hasard, désemparée, sans feu ni lieu. En ce temps-là, c’était un enfant. Je l’ai vu grandir. Il ne s’éloignait pas de moi et il était aussi doux que ses moutons. Malgré cela, quand je criais, il détalait précipitamment, poussant lui aussi de grands cris. Il n’ignorait pourtant pas pour quelle raison je hurlais, et il le comprenait car je lui parlais beaucoup de Yechoua ; il me croyait sa veuve, et je le laissais dans cette croyance.
C’était lui qui, le premier, nous avait vu aborder ; il était debout au bord de la mer, à cet endroit de la côte sablonneuse vers lequel la tempête nous avait poussés et où elle avait fait échouer notre navire, la vieille embarcation à voile toute vermoulue, et qui depuis longtemps ne tenait plus la mer qu’avec peine, grâce à laquelle nous échappâmes aux persécutions de Saulus, dix ans après la mort de Yechoua : Miryam Choulamith, Miryam Yaakovi et moi, accompagnées de Chochana, Yohana et Sara, nos fidèles servantes ; les deux sœurs de Béthania nous accompagnaient, ainsi que leur frère Lazare, qu’elles appelaient Liézer, et qui commença bientôt à prêcher courageusement. Nous avions également engagé deux marins phéniciens, qui nous avaient conduits jusque-là moyennant une grosse somme d’argent. Après le débarquement, ils se firent baptiser et devinrent les compagnons de Lazare.