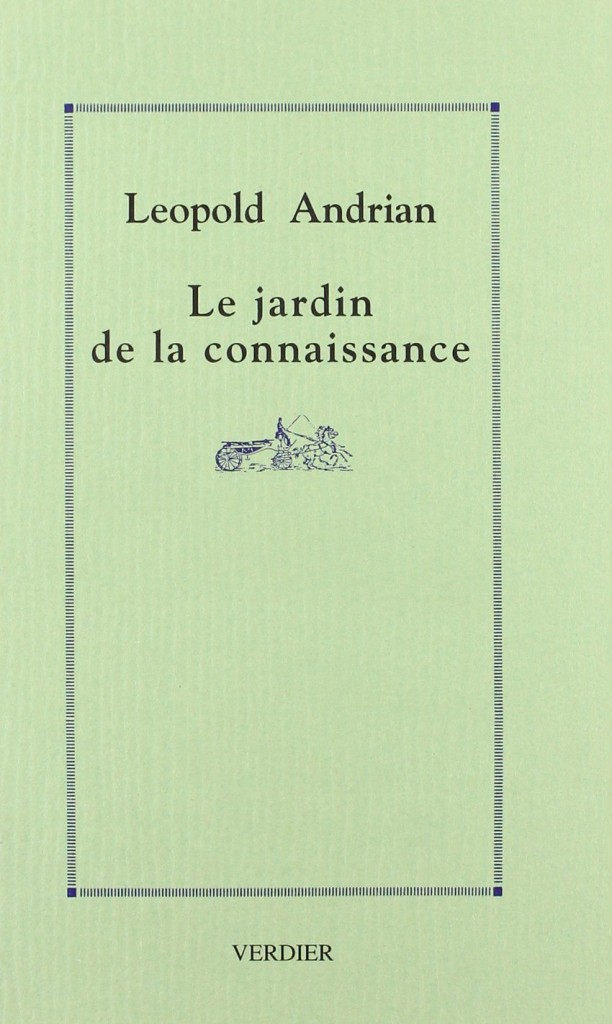
Leopold Andrian
Le jardin de la connaissance
Traduit de l’allemand par Jean-Yves Masson. Postface de Francis Claudon
Collection : Der Doppelgänger
80 pages
10,65 €
978-2-86432-144-6
février 1992
Que cherche Erwin, le jeune prince ? Les paysages qu’il traverse, les souvenirs qui s’imposent à lui au fil du temps, les êtres qu’il rencontre ne cessent de lui promettre illusoirement et de lui refuser toujours une impossible initiation.
Profondément ancré dans un temps et dans un lieu – l’Autriche de la fin du XIXe siècle – ce bref récit, paru en 1895, fut de ceux qui surent traduire la sensibilité de toute une génération. Il valut à son auteur une immense réputation que celui-ci fut peu soucieux d’exploiter. Il frayait une voie à des œuvres comme Les Désarrois de l’élève Törless de Musil, ou le Tonio Kröger de Thomas Mann.
Quand Erwin vint à Vienne, il avait dix-sept ans ; peu de temps après son arrivée, il retourna au collège religieux. À cette occasion, de nombreux anciens camarades lui promirent de venir lui rendre visite à Noël. Il se réjouissait de cette perspective, et particulièrement de l’idée de revoir Lato, mais il attendait en même temps avec impatience la visite d’un nouveau venu au collège, dont il venait seulement de faire la connaissance ; c’était un garçon fort laid, avec de grands yeux, qui travaillait mal, et qui, parce qu’il n’était pas riche, voulait devenir officier afin de parvenir au service d’un archiduc.
Erwin rendit souvent visite à ses anciens camarades pendant les premiers mois, mais, peu à peu, il les oublia et n’aima plus que Vienne. Il aimait les grands palais baroques dans les ruelles étroites, et les inscriptions tonitruantes gravées au fronton de nos monuments, et le pas des chevaux quand ils vont à l’espagnole, et les uniformes des gardes, et la cour de la résidence impériale, les jours d’hiver, quand une musique de parade bruyante passe au travers de la foule et réchauffe et détend les corps engourdis des badauds ; et il aimait aussi les grandes fêtes que tout le monde célèbre, en particulier la Fête-Dieu, le jour où le corps glorifié de Notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vient à nous, nimbé d’un éclat et porté par une allégresse qui n’ont rien à envier aux jours solennels de jadis où l’empereur Charles VI, revenu d’une tournée sur ses terres d’Espagne, faisait son entrée dans Vienne, sa résidence et la capitale de son empire.
À Erwin plaisaient aussi les étalages des magasins, le drap d’une seule couleur destiné à couvrir les voitures, la batiste sombre des mouchoirs au milieu des étoffes de soie de couleurs vives ; lui plaisaient aussi les quadriges de chevaux au pelage noir comme le jais, quand ils passaient au milieu des massifs de roses du Prater ; il aimait que les cochers fussent élégants ; et il aimait que ses amis fussent élégants, et ce qui lui plaisait dans l’élégance de ses amis, c’était que leur vie fût comme une ligne négligemment tracée, mais plus encore, qu’ils fussent parfois capables d’aller danser toute la nuit dans un bal de village, qu’un mot suffît à les rendre joyeux, à moins que ce ne fût la simple pensée qu’ils étaient Viennois et qu’à Vienne, même les orgues de barbarie dans les rues jouaient juste. Il lui semblait que l’art de vivre viennois avait le charme gracieux et toujours plus attirant d’une lampe dont on doute si elle émet deux couleurs qui se mêlent continuellement, ou s’il ne s’agit que du chatoiement d’une seule et même couleur qui se déploie selon toutes ses nuances.
Souvent, il était rempli d’ivresse par la sensation que Vienne lui réservait encore tant et tant de plaisirs, et par la pensée que le mystère qui était cause de leur charme se trouvait caché au fond de ces plaisirs. Cette pensée lui permettait aussi d’apaiser ce désir « d’autre chose » qui s’emparait de lui plus fortement et plus souvent qu’à Bozen ; car il avait maintenant à portée de la main tout ce qui pouvait lui offrir cette « autre chose » qu’il appelait autrefois de ses vœux : les bals de l’Opéra, et les salles du Sofienbad, et le cabaret Ronacher, et l’Orpheum, et le cirque, et les fiacres. Il disait : « autre chose », et en prononçant ces mots, il avait le sentiment que, quelque part, il ne savait dans quelle direction, s’étendait un monde où tout était à la fois interdit et secret, aussi grand que celui qu’il connaissait. C’étaient surtout les cochers qu’il regardait avec une excitation singulière, mêlée d’effroi. Un grand nombre d’entre eux ressemblaient étrangement à de jeunes messieurs ; mais que le contraste se dissimulât précisément au cœur de cette similitude devait avoir un rapport avec la nature de cette « autre chose » qu’il recherchait. L’un d’entre eux surtout lui plaisait, lorsque son fiacre traversait le Prater au printemps ; ses chevaux portaient des bouquets de violettes glissés dans leur harnais, et il était assis au-dessus d’eux, le buste légèrement incliné vers l’avant, tenant haut et largement écartées les rênes avec ses bras, dans une attitude pleine de recherche, roide comme une statue et pourtant étrangement vivant, comme une estampe pleine de grâce et quelque peu maniérée dans l’élégance maniérée de son cadre.