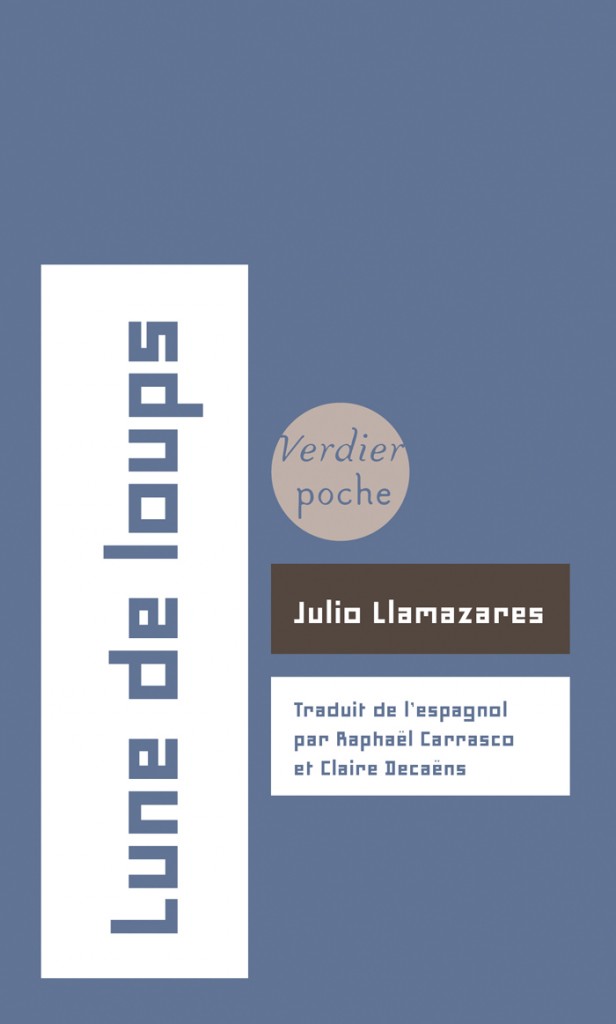
Julio Llamazares
Lune de loups
Roman. Traduit de l’espagnol par Raphaël Carrasco et Claire Decaëns
Collection : Verdier/poche
192 pages
10,20 €
978-2-86432-551-2
mars 2009
(collection d'origine : Otra memoria)
Quatre jeunes gens traqués par la haine fratricide tâchent de survivre dans la montagne, cachés dans les cavernes et les bois. La guerre civile passe au fond de ce récit avec sa cohorte de détresse, de violence et de mort. Mais au fond seulement. L’histoire de ces hommes, de ces animaux nocturnes et solitaires, est plutôt celle d’un mauvais rêve, celle d’un voyage intérieur vers les sources mêmes du lyrisme et de la transfiguration poétique du réel. Loin de nous enfermer dans la nuit sans issue d’un maquis condamné, le récit ouvre sur un autre monde, moins visible et plus incarné à la fois, plus élémentaire et plus dense.
À midi, la pluie qui s’est calmée, la boue qui a envahi la rivière et les chemins, les aboiements des chiens et les cloches de La Llánava, entrent me chercher jusqu’au fond de la grotte, jusqu’au coin glacial où, des heures durant, j’ai essayé en vain d’oublier le glapissement de ce chien qui se nourrit de sang à l’intérieur de mon cœur.
Devant la porte de ma maison, sous les parapluies, les gens attendent la dernière sortie de mon père. Ils sont comme des ombres noires, gommées par la pluie et la distance à travers les jumelles. Des ombres lointaines, sûrement en train de commenter à voix basse ce que tout le village doit déjà savoir : que moi, hier au soir, je suis allé là-bas. Que moi, hier au soir, pendant qu’ils dormaient, tandis que le vent frappait sur leurs carreaux et que les chiens hurlaient dans leurs étables, pressentant l’arrivée de la mort, j’ai abandonné ma cachette dans les entrailles de la forêt, j’ai traversé les cercles concentriques de la nuit et de l’oubli, et, subitement, je me suis présenté dans ma maison afin de dire un dernier adieu à cet homme qui en sort à présent, sur les épaules de ses voisins, pour n’y jamais revenir.
Le glas s’est mis à sonner avec une tristesse encore plus profonde. Humide, il frémit sur les toits et les champs avant de se briser dans une douleur de fer contre les rochers transis. La pluie jaillit avec une force soudaine quand la charrette avec le cercueil se met en mouvement devant chez moi, laissant derrière elle une traînée de parapluies et la légende de cet homme invisible et indompté qui, hier au soir, a une fois de plus trompé la vigilance des gardiens et qui est sans doute en ce moment quelque part en train de les observer.
Cet homme qu’on s’est imaginé nuit après nuit dans la chaleur des étables et des cuisines, immortel comme son ombre, lointain comme le vent, courageux, rusé, intelligent, invincible. Cet homme à qui le miroir de la pluie, dans la montagne, rend cependant la mémoire de ce qu’il a toujours été : un être pourchassé et solitaire. Un homme traqué par la peur et par la vengeance, par la faim et par le froid. Un homme à qui l’on refuse même le droit d’enterrer le souvenir des siens.
Lorsque j’arrive sur le chemin, la pluie a cessé. Une lumière grise, de lune très lointaine – « Regarde, Ángel, regarde la lune : c’est le soleil des morts » – éclaire légèrement la ligne des montagnes et le frisson ému des arbres.
La rivière descend grosse et rauque, furieuse. Elle frappe de son hurlement les troncs des peupliers et les toits noirs qui dorment au loin, entre les branches cassées, le dos tourné à ce jardin solitaire où poussent les orties et le silence depuis la nuit des temps, depuis le début des âges.
La porte est close. Un cadenas de fer garde sous sa rouille le sommeil de ceux qui ont déjà traversé le fleuve de l’oubli. Mais le mur n’est pas très haut. Et un craquement de ronces m’attend de l’autre côté, quand je me plaque en douceur contre la boue.
Les voilà enfin, silencieux et gris devant mes bottes, les monticules de terre où fermente le temps, où pourrissent avec un calme ancien passions et souvenirs. Ils sont là, comme des montagnes de tristesse sous une lune très lointaine et mouillée : celui de ma mère, près de la porte, durci par les ans ; celui de María, élevé seulement pour m’avoir donné sa solitude et sa vengeance ; celui de Benito ; celui de Teresa, la fillette noyée ; celui de Ramiro, dans le coin des proscrits, définitivement effacé par les orties – il fut enterré après qu’on eut exhibé dans les villages comme un trophée de chasse son corps calciné.
Et voici, devant mes bottes, sans nom encore, sans date face à l’oubli, le carré de terre retournée où, depuis cet après-midi, mon père m’attend.
« C’est moi : Ángel. Je suis descendu. »