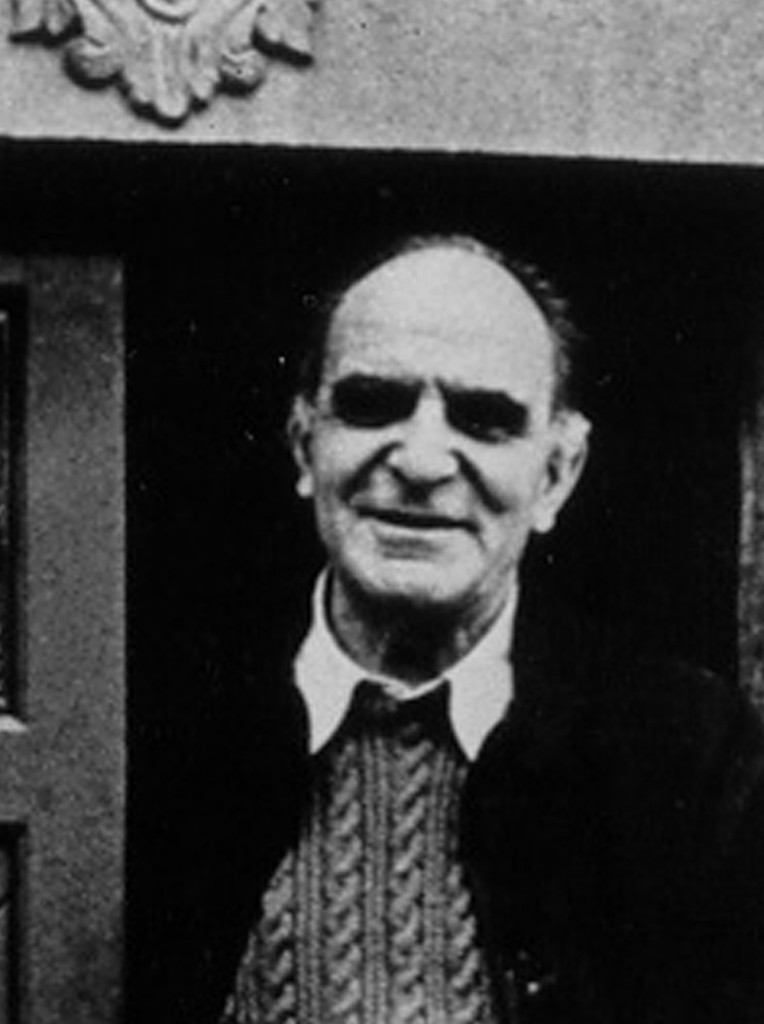
Attilio Bertolucci
(1911-2000)
« Survivance, notre terre ? Mais ils durent longtemps / ces crépuscules, comme l’été où jamais, jamais / n’arrive l’heure de la lampe allumée, de ces / phalènes déraisonnables qui s’y heurtent, / attirées et repoussées par la clarté qui est vie / (et pourtant vie aussi était le jour qui meurt). » Le poème À Pasolini (en réponse), extrait de Voyage d’hiver, second recueil important d’Attilio Bertolucci, évoque un long couchant, saignement doux mais inexorable au cœur d’une œuvre d’abord considérée par la critique comme étrangère à son temps car nourrie par une inspiration très privée. Au moment où disparaît son auteur, elle s’impose pourtant comme une des plus denses et des plus cohérentes qu’ait données en poésie le XXe siècle italien.
Né à San Lazzaro, près de Parme, trois ans avant la Première Guerre mondiale, Attilio Bertolucci appartient à une génération de poètes qui compte d’autres grandes figures : Giorgio Caproni, Vittorio Sereni et Mario Luzi. Quatre voix unies par une amitié de plusieurs décennies, et dont les écritures, si complémentaires, ont dessiné, malgré les convulsions du siècle, un possible âge d’or pour la poésie de l’autre côté des Alpes.
« Fils de moyenne bourgeoisie agraire », comme il se définissait lui-même, Bertolucci restera lié au mythe modeste et sensuel de sa ville natale, Parme, la « petite capitale d’autrefois » chère aux écrivains français (Stendhal, Proust, mais aussi Madame de Staël). Propriétaire terrien et jeune homme attentif à la culture étrangère, en particulier la littérature anglaise dont il se fera dès 1939, aux éditions Guanda, l’un des plus fins défenseurs en Italie, Bertolucci devient l’élève, à Bologne, une dizaine d’années avant son ami Pasolini, du grand historien d’art Roberto Longhi : cet enseignement, né de la quête anxieuse des formes et des secrets du visible, enrichit la sensibilité la plus profonde du poète, tournée vers un monde agraire et provincial menacé, vers un impossible chant virgilien, vers un réel somptueux et fragile où l’émotion, à sa pointe extrême, se fait angoisse du néant. « Poétique de l’extrasystole » – donc de la palpitation, de l’anxiété du cœur – deviendra le maître mot de Bertolucci pour qualifier sa propre création, que Paolo Lagazzi, son ami proche et pénétrant exégète, situe pour sa part au confluent de l’inquiétude et d’un calme voluptueux.
Après avoir lui-même enseigné l’histoire de l’art, et publié dès l’âge de dix-huit ans sa première plaquette de vers, Sirius, que suivra en 1934 Feux en novembre salué par Montale, Bertolucci gagne Rome au début des années cinquante avec sa femme Ninetta et ses deux fils, les futurs cinéastes Bernardo et Giuseppe. Naissent alors des liens très forts avec Pier Paolo Pasolini et Giorgio Bassani, que le hasard fera disparaître peu avant Attilio. La splendeur calcinée de Rome, sa « vitalité désespérée » – célèbre expression pasolinienne – sont une joie et un tourment pour le poète : « la ville […] / nous aura embrassés, douce prostituée, / nous aura vaincus à jamais. » En 1951 paraît son premier recueil conséquent, La Chaumière indienne, dont la seconde édition, augmentée, date de 1955. Suit un silence poétique de seize années, rompu par Voyage d’hiver, sans doute le chef-d’œuvre de Bertolucci, en dépit du prestige de son « roman familial en vers » La Chambre, où se nouent poésie et narration comme dans le lointain modèle constitué par Eugène Onéguine, et dont la première partie sera publiée en 1984, la seconde quatre ans plus tard. Qu’il célèbre le monde dans des vers qu’on peut qualifier de « païens » en dépit du christianisme qu’il revendique, ou qu’il oscille au bord des abîmes de l’âme qu’évoquera la critique italienne à sa mort, Bertolucci, comme protégé par une légère névrose en forme d’hypochondrie littéraire, a créé une œuvre reconnaissable entre toutes, mélange troublant et raffiné d’angoisse et de sérénité, de beauté sonore et de références visuelles, de langueur pudique et de vertiges contrôlés. Selon Pietro Citati, « dans l’espace infime construit autour de lui, dans le réduit dont il fortifie continuellement les défenses, afin que rien d’extérieur n’y pénètre, il erre avec la même inquiétude que d’autres lorsqu’ils sillonnent les routes et les mers du vaste monde ». À l’instar d’autres poètes italiens – Umberto Saba, Sandro Penna, voire Carlo Betocchi – d’abord négligés puis reconnus comme essentiels, Bertolucci laisse une empreinte d’autant plus profonde que son œuvre semble réticente à l’égard des grands thèmes de l’histoire collective : « Il y a peu de poètes du XXe siècle, a écrit Pier Vincenzo Mengaldo, chez qui l’on trouve une opposition aussi radicale, orgueilleuse et tenace, entre l’histoire personnelle et l’Histoire : ce qui suffirait à garantir la totale modernité de la position de Bertolucci, apparemment si retranchée. »
Passionné de cinéma dès les années trente, constant interlocuteur de ses fils à la frontière difficile de cet art et de la poésie, remarquable traducteur (en prose) des Fleurs du mal, Bertolucci fut un homme de vaste culture, comme le prouvent ses deux volumes de proses, le premier au titre caractéristique, Arythmies, et le second paru quelques jours avant sa mort, J’ai volé deux vers à Baudelaire. Unissant poèmes de jeunesse et compositions tardives, il publia encore deux minces et précieux recueils, Vers les sources du Cinghio en 1993 et Le Lézard de Casarola (lieu proche de Parme où subsiste la maison familiale) en 1997. Sa correspondance avec Vittorio Sereni, Une longue amitié (1994), est une des plus subtiles qu’ait engendrées la littérature italienne en des temps où, comme l’a souligné le poète et critique Giovanni Raboni, « on pouvait ne pas avoir honte d’être poète, de saigner sous les yeux de tous ».
Avec une lucidité qui n’interdit pas le chant, Attilio Bertolucci a dessiné en vers un inoubliable autoportrait : « C’est moi, disciple d’un siècle qui croit / ne pas mentir, qui me reconnais dans cet homme malade, / me mentant à moi-même : et j’écris / pour exorciser un mal auquel je crois et ne crois pas. » Dans cette hésitation du cœur, dans la sensualité inquiète qui l’accompagne inévitablement, réside la plus vive substance de sa poésie.
Bernard Simeone, juin 2000
Aux éditions Verdier
Chez d’autres éditeurs
Voyage d’hiver et autres poèmes, trad. Philippe Renard, Obsidiane, 1986 Poèmes traduits par Philippe Renard dans Prisma. Quatorze poètes italiens contemporains, Obsidiane, 1986 Poèmes traduits par Philippe Jaccottet dans D’une lyre à cinq cordes, Gallimard, 1997
En langue originale
Sirio, poesie, Minardi, Parma 1929 ; La Pilotta, Parma, 1979 ; SEN, Napoli, 1984 Fuochi in novembre, poesie, Minardi, Parma, 1934 La capanna indiana, poesie, Sansoni, Firenze, 1951, 1955 ; Garzanti, Milano, 1973 Viaggio d’inverno, poesie, Garzanti, Milano, 1971, 1984 La camera da letto, romanzo famigliare in versi, Garzanti, Milano, 1984 (Libro I) ; La camera da letto,libro secondo, ibidem, 1988 ; La camera da letto, libri I e II, ibidem, 1988 Le poesie (tutte le poesie precedenti La camera da letto), Garzanti, Milano, 1990 Aritmie, prose, Garzanti, Milano, 1991 Al fuoco calmo dei giorni. Poesie 1929-1990, a cura di Paolo Lagazzi, Rizzoli, Milano, 1991 Verso le sorgenti del Cinghio, poesie, Garzanti, Milano, 1993 Versi nel tempo 1929-1993, a cura di Paolo Lagazzi, Tallone editore, Torino, 1994 Una lunga amicizia. Lettere 1938-1982, carteggio Attilio Bertolucci – Vittorio Sereni, a cura di Gabriella Palli Baroni, Garzanti, Milano, 1994 La lucertola di Casarola, poesie, Garzanti, Milano, 1997 Poesie scelte, a cura di Giancarlo Pontiggia, TEA, Milano, 1997 Bertolucci, poesie, Mondadori « I Miti », Milano, 1997 Opere, a cura di Paolo Lagazzi e Gabriella Palli Baroni, Mondadori (« I Meridiani »), Milano, 1997
Bibliographie critique en français
Muriel Gallot, préface à sa traduction de La Chambre, Verdier, Lagrasse, 1988 Bernard Simeone, Dans le temps qui se consume, préface à la trad. par Muriel Gallot de Voyage d’hiver, Verdier, Lagrasse, 1997
Bibliographie critique en italien (sélection)
Pier Vincenzo Mengaldo, Attilio Bertolucci in Poeti italiani del Novecento, Mondadori, Milano, 1978 Paolo Lagazzi, Attilio Bertolucci, La Nuova Italia, Firenze, 1981 Paolo Lagazzi, Rêverie e destino, Garzanti, Milano, 1993 Attilio Bertolucci, Paolo Lagazzi, All’improvviso ricordando. Conversazioni, Guanda, Parma, 1997 S. Giovannuzzi, Introduzione alla lettura di Attilio Bertolucci, Mursia, Milano, 1997
Attilio Bertolucci vu par quelques écrivains italiens
Son mythe, il l’a construit parmi les formes qui l’entourent : il est comme baigné, comme imprégné, par la lumière dorée de Parme. Sa sensibilité est avant tout réceptive : il accueille et restitue avec une extrême fidélité le don de l’air et des heures. Manque-t-il pour autant de mystère ? Je ne crois pas. Je pense à certaines maisons de campagne où le calme est instantanément troublé par le bruissement d’un rideau, par le battement d’une porte, et la brève animation qui en résulte devient aussitôt une légère obsession.
Vittorio Sereni, 1948
Depuis cet observatoire immobile et si intime, vivant comme dans un intérieur, le poète perçoit, de façon presque obsessionnelle mais sans le moindre soupçon de violence, le cours des années, la vie qui se consume, et ses notations provoquent parfois, du fait de leur grâce discrète, le frisson que procure le sable dans le sablier.
Mario Luzi, 1951
Dans l’espace infime construit autour de lui, dans le réduit dont il fortifie continuellement les défenses, afin que rien d’extérieur n’y pénètre, il erre avec la même inquiétude que d’autres lorsqu’ils sillonnent les routes et les mers du vaste monde.
Pietro Citati, 1971
Ce qui constitue la signification profonde de La Chambre, c’est la reconnaissance de la vérité globale de la vie – à commencer par le mystère du mal –, et donc l’acceptation religieuse, totale, de la vie.
Mario Soldati, 1984
Liens
Profilo di Attilio Bertolucci: un texte critique de Andrea Bollini sur l’œuvre de l’auteur. Une biographie de Bertolucci et quelques poèmes sur le site Il club degli autori, site dédié à la littérature italienne.