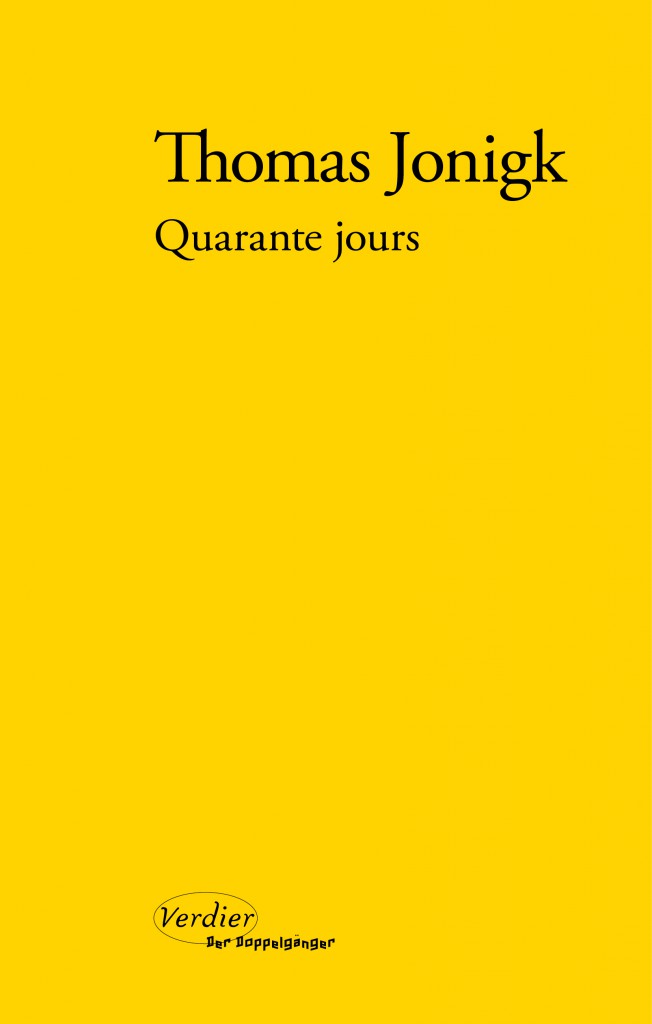
Thomas Jonigk
Quarante jours
Traduit de l’allemand par Bernard Banoun
Collection : Der Doppelgänger
176 pages
15,22 €
978-2-86432-510-9
septembre 2007
« Vous vivez, hurle une voix qui sort de Jan, vous vivez mais moi la terre ne me soutient plus, quelque chose m’entraîne vers le bas, dans un abîme, pour que je n’existe plus, pour que je sois aussi mort que la tête enveloppée dans du plastique de l’homme allongé sur la moquette rouge bifteck de mon appartement, comme s’il était moi… »
Parvenu « au milieu du chemin de sa vie », Jan Jonas a trente-cinq ans et, autour de lui, la fin du monde semble s’annoncer : c’est de nouveau la guerre sur une ville allemande d’aujourd’hui. Un déluge va noyer la terre pendant quarante jours. Qui recréera la vie à neuf ?
Sur un canevas de références bibliques subtilement brouillées et subverties, Thomas Jonigk a bâti ce roman violent et drôle, parodie de roman policier, de film érotique, de roman picaresque ou de conte de fées. Faisant de son héros tour à tour un nouveau Noé, un nouveau Cham (le fils indigne qui se moque de la nudité de son père), un nouveau Jonas, le romancier l’amène peu à peu à échapper aux stéréotypes et aux automatismes dans lesquels il s’enlisait. Pour finir, Jan montera dans l’Arche en compagnie de Face-de-Grenouille, la jeune fille laide qu’il s’est mis à aimer et qui lui montre enfin le visage de l’humanité qu’il avait toujours ignorée.
En fait, il avait seulement voulu traverser rapidement le carrefour, mais le voilà planté là depuis quinze minutes au moins, sous la pluie comme tous ces gens qui disparaissent avec détermination dans les centres commerciaux, Jan essuie énergiquement quelques larmes sur son visage, elles se mêlent à la pluie et forment un ruisseau triste qui dévale la montagne, encore et toujours ce père de merde, ce nul, ce mort obséquieux et sans langage gisant sur son drap couleur chair, Jan ne peut pas arrêter de lui placer dans la bouche des réponses qu’il a toujours attendues, la clé de l’énigme qui ne livre pas son mystère.
À chaque pas auquel il consent en pensée vers son père, Jan perd quelques centimètres, il rapetisse, lui qui en apparence seulement était un géant, sa grande taille lui dégouline dessus et forme des flaques à ses pieds, il se retrouve dans une enfance dont les manches trop longues lui pendent au-delà des doigts, ici rien n’est sur mesure, Jan porte des vêtements légués par d’autres enfants plus grands, il se compare à eux, à son désavantage. Rares sont les images agréables qui arrivent jusqu’à lui, images d’une enfance avec le père qu’il admirait, incomparable dans son absence et en soi indispensable. Modèle de virilité et excitant de par sa hauteur. La traversée de la forêt enchantée, les premières parties de pêche aux côtés du père, le premier puzzle entièrement reconstitué, le mur du garage maçonné ensemble, les promenades familiales au bord de la mer et les montagnes de chocolat ensuite, quatre ou cinq beaux instants, beaux mais banals, se reprend Jan, il a honte de ses larmes, il a honte de ses parents, des gens simples, incultes, qui le gênent et qu’il faut dissimuler, qui le tirent vers le bas, une meule, un poids lourd, une faute de goût, à ras de terre, une dépréciation, mais c’est de lui-même surtout qu’il a honte, parce que père et mère lui manquent, et qu’il n’y peut rien.
Serpent motorisé, le flot des voitures passe devant Jan, un cri veut se déployer et prendre sa part d’espace, dépasser un corps qui appartient à Jan, le cri a la dimension d’une alarme, d’un hurlement et d’une révolte, mais Jan a déjà stoppé ses sirènes, muettes elles se tordent pour sortir du dedans de lui-même et elles s’élèvent par-delà les toits des maisons vers la gueule ouverte et baveuse d’un ciel de grande ville.
À leur suite Jan se déploie vers le ciel, là on n’entend pas son désespoir, tout d’un coup un vrombissement de machines recouvre tout et le ciel entier est noir d’avions de chasse qui, l’instant d’avant, étaient encore invisibles, ils volent en formations inconnues, corps métalliques noirs devant des nuages en fuite, Jan sait ce que cela signifie.
Sous leurs parapluies et vestes en tissu imperméabilisé, des humains pressent le pas et courent d’un côté à l’autre, disparaissent dans des entrées de maisons ou des rues adjacentes pour ne pas être déchiquetés par cette averse mortelle. Devant les yeux en larmes de Jan des façades coulent comme une aquarelle, de sinistres ombres à moteur pleuvent sur la ville, blessures étales qui transforment en plaies béantes le déroulement des jours. Jan aperçoit maintenant au-dessus de lui au moins quatre-vingt, non, cent avions, essaims d’insectes sans visage qui pondent des œufs empoisonnés, encore une attaque, la guerre, de nouveau, pense Jan, une femme lui crie de se chercher un abri, là, tout près, derrière la pharmacie. À peine s’est-elle détournée qu’une grêle de balles se déverse sur toute la surface de bitume, la femme lève brièvement les yeux avant d’être emportée. Les yeux de Jan prennent leur élan, mais son corps, lui, ne bouge pas, il se fige en fils de son père.
Prix Amphi, 2008