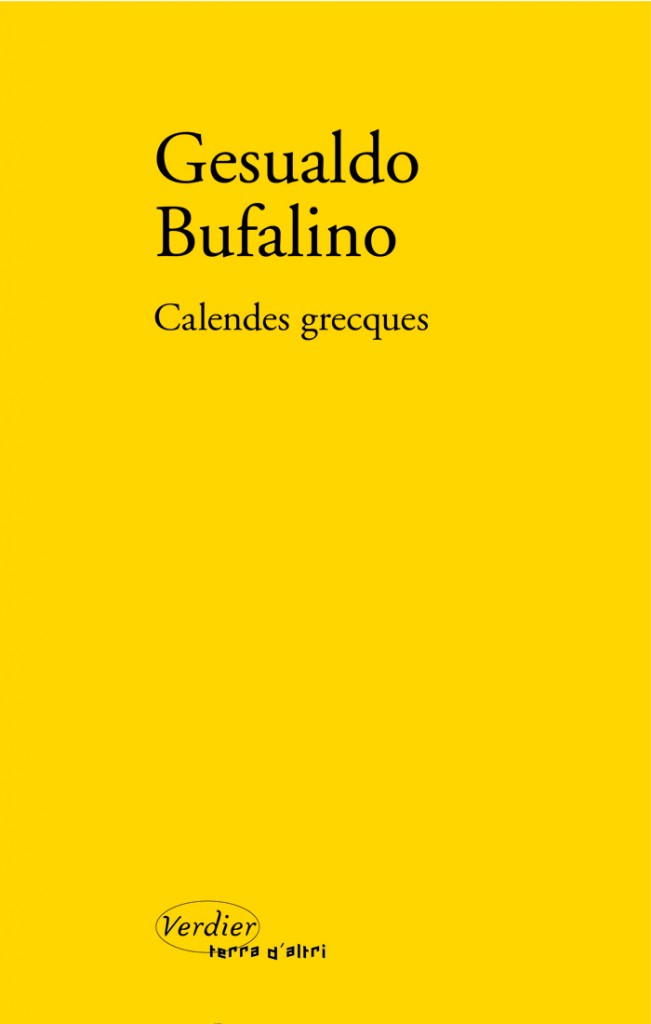
Récit. Traduit de l’italien par Jacques Michaut-Paternò
Collection : Terra d’altri
208 pages
14,70 €
978-2-86432-322-8
septembre 2000
Comment rendre compte de sa propre vie ? Sur quelle page en inscrire la trace ? En sous-titrant son livre « Souvenirs d’une vie imaginaire », Gesualdo Bufalino affirme d’emblée, comme Calderón, que la vie est un songe. Mais que déchirent parfois les éclairs d’une réalité poignante.
Dans une Sicile écrasée par la richesse de sa propre culture, le narrateur, composant son autobiographie, réelle ou prétendue – mais au fond ni plus ni moins que tout récit de soi –, laisse percer des accents de vérité que son ironie ne parvient pas à étouffer.
Ses considérations sur la naissance en tant que mise à mort, sur les ambiguïtés de la maladie, souffrance et refuge, sur les infinies volutes de l’amour, sur le joyeux et terrible enfermement dans l’écriture, pourraient n’être que lieux communs ou prétexte à la misanthropie. Mais toujours, dans cette bibliothèque infinie qu’il fut à l’égal de son personnage, Bufalino laisse entendre la nostalgie d’une communauté véritable entre les hommes, et une tendresse, une fragilité, qui refusent de transformer en cruauté le désespoir. Là prend source pour le lecteur, dans un scepticisme qui est une forme très haute de pudeur, dans une apparente solitude des confins, une présence au bout du compte fraternelle comme il en est peu.
Naissance
Un sac aveugle, une tanière délicate. Inutile d’ouvrir les yeux, il ne verrait que ténèbres. Le petit corps néanmoins mûrit une vague certitude de soi ; et d’être soi à l’intérieur d’un autre. Il flotte, îlot dérisoire, dans un bain de mystérieuse tiédeur. Où il nage et stagne, à la fois élastique et inerte, à l’abri du vernis gras qui le protège. Il s’en enduit, s’en abreuve et s’en nourrit comme d’une goutte d’eau la motte de terre dans son pot. Mais ici le pain quotidien du placenta lui garantit tout au long d’un infaillible cordon d’autres sucs et d’autres humeurs. Grâce auxquels il grandit, grossit, de moignon se fait créature. Jusqu’à l’instant où, dans son intouchable exil, un éclair brille, un souffle susurre : « Moi, moi, moi ! » ; un souffle qui n’est pas encore voix, conscience, pensée, mais seulement libération, imperceptible, opaque, hébétée, hors du Néant… « Moi, moi, moi ! » si l’on peut ainsi appeler le tressaillement en lui confus de sons et de mouvements enfouis et lointains ; et l’alliance encore plus inconsciente avec le monstre au-dedans duquel il se trouve : ce Léviathan de chair tendre et montueuse dont il sent le cœur battre au rythme du sien.
Puis, un matin, se sentant à l’étroit dans cet antre exigu, il brûle de s’en échapper. Il devine dans le ventre qui jusque-là était sa patrie un obstacle qu’il force durement de la tête, cherchant en bas la sortie. Des spasmes sauvages, irréfrénables, pareils à ceux qui l’accueillirent, semence, dans les voluptés d’une nuit, secondent sa révolte. Une agonie – la première et avant-dernière agonie de sa vie – le dirige dans la sueur et le sang vers la lumière. Il entend des cris au-dessus de lui, des cris aigus. Et un grondement de cataracte. Mais lui, impavide, use précocement, pour émerger, d’astuce et de violence ; il allonge, aplatit la tête, en rapetisse les fontanelles ; il atténue l’encombrement des os ; il entreprend de se couler, de se glisser le long du boyau mieux que ne saurait le faire entre les barreaux le plus agile des évadés. Attention : l’issue est imminente. Par l’orifice, entre deux jambes écartées et convulsées le petit vieillard fripé apparaît, masse de plis à la peau timide et bleue. Gnome misérable et pleureur, énième feu éphémère, mais aussi écorce et pulpe de vitalité barbare, témoin incomparable qui d’un simple vagissement absout et certifie le monde.
Regardez-le : déjà il enseigne à ses poumons les merveilles de la respiration, il les gonfle, les contracte, les gonfle à nouveau ; il inaugure glorieusement l’air et ses nourrissantes mixtures.
Il est né. Il a commencé à vivre, il a commencé à mourir.