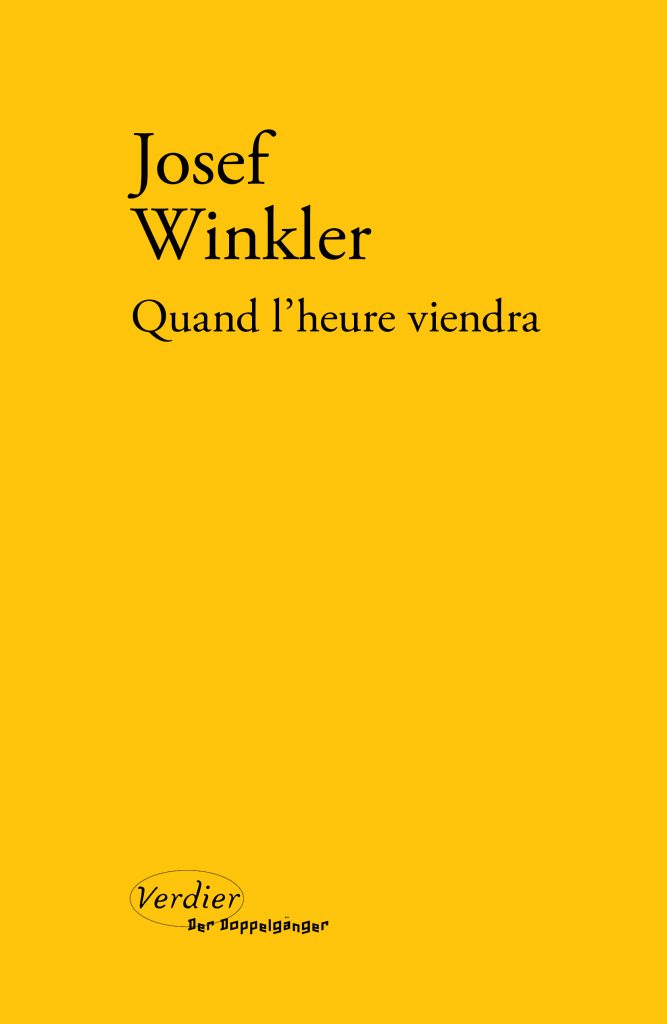
Josef Winkler
Quand l’heure viendra
Récit. Traduit de l’allemand (Autriche) par Bernard Banoun
Collection : Der Doppelgänger
208 pages
15,22 €
978-2-86432-174-3
octobre 2000
Dans Cimetière des oranges amères, Josef Winkler partait pour l’Italie, non sans emporter avec lui les souvenirs de son pays natal, la Carinthie. C’est là, dans le village en forme de croix déjà familier des lecteurs du Serf, qu’il revient pour ce récit.
Les paysans carinthiens avaient coutume, pour éloigner les insectes, de badigeonner leurs chevaux d’un liquide à l’odeur nauséabonde fabriqué à partir d’ossements d’animaux. Maximilien, le narrateur, s’inspire de cette étrange coutume pour définir sa tâche d’écrivain : ramasser les ossements des morts que le village voudrait oublier, et rendre justice à leurs vies sacrifiées. À leur mémoire, il compose en faisant appel à ses propres souvenirs et à ceux de son père nonagénaire, une symphonie funèbre dont les thèmes sont les récits de trente-six destins au dénouement tragique, jusqu’à la scène finale où trois vieillards échangent avec nostalgie leurs souvenirs de guerre au cours d’un repas de la Toussaint. Cet épilogue donne au livre une portée politique (d’autant plus forte quand on sait que la Carinthie est la base électorale de l’extrême-droite autrichienne) mais les citations des Litanies de Satan de Baudelaire qui ponctuent le récit attestent que la question du Mal est ici posée, aussi bien, sur un plan métaphysique.
Écrit dans une langue flamboyante, traversé de scènes hallucinées, Quand l’heure viendra est l’un des sommets de l’œuvre de Josef Winkler : un triomphe de la mort qui saisit tout le tragique du vingtième siècle à travers le microcosme d’un village autrichien.
La mère de Maximilien raconta que Ludmilla Felfernig, quinze ans, devait travailler à la ferme Schaflechner en compagnie de garçons de ferme et de jeunes paysans qui ne cessaient de la taquiner et de se moquer d’elle. Un jour que les jeunes gens empilaient des gerbes de paille sur l’aire de battage de la grange, la jeune fille, pour reprendre ses mots, ne se sentit pas bien. Comme elle se penchait vers les gerbes pour en soulever une, les jeunes gens firent des blagues quand ils aperçurent le sang qui suintait sur sa culotte. En larmes, la jeune fille laissa retomber la gerbe de paille, traversa la passerelle du fenil, descendit la rue du village en courant jusqu’au calvaire, où elle s’agenouilla, les mains croisées pour prier, sous les flammes rouges qui se dressaient sur le sol de l’Enfer. Tandis que les menstrues coulaient sur ses cuisses, elle pria, le cœur battant, à travers ses larmes : Bon ange gardien, céleste guide qui soutiens, tends-moi vite la main, protège ton enfant. Elle se passa la main sur les cuisses, barbouilla de sang son visage, le mur chaulé du calvaire et le crâne cornu du Diable puis, avec ce masque rouge, les mains et les cuisses en sang, elle passa en courant devant l’église et devant les hautes croix du cimetière qui, debout comme des soldats de plomb, dressaient leurs têtes couronnées d’épines, descendit la butte de la mare, longea les champs clôturés de barbelés rouillés où étaient restées accrochées des touffes de poils gris et bruns des bœufs qui paissaient là, traversa le petit bois touffu qui longe la rivière et se jeta dans les flots de la Drave. On la chercha en vain pendant des jours, et c’est à Villach qu’on finit par retirer de la rivière le cadavre de la désespérée. Elle était accrochée dans les grilles près du pont sur la Drave, la Milla ! dit la mère de Maximilien, la femme du nonagénaire à la moustache poivre et sel et aux sourcils taillés.
Dans la jarre où se préparait à partir d’ossements d’animaux le pandapigl dont on badigeonnait les yeux, les naseaux et le ventre des chevaux pour les protéger des moustiques et des taons qui les harcèlent, le ramasseur d’os pose les ossements de la jeune fille de quinze ans repêchée dans la rivière où elle était restée accrochée aux dents de fer parmi des branchages charriés par les eaux sur ceux d’August Rosenfelder, dont il avait fallu dépendre de la porte de l’étable le cadavre maculé de bouse devant les queues brimbalantes des vaches. Devant le calvaire placé face à l’école au milieu du village bâti en croix, où gît entre les flammes de l’Enfer le sacrilège qui avait précipité par-dessus les rochers le Jésus de taille humaine et que Lucifer, penché au-dessus de lui, ses ailes rouges déployées, abreuve en déversant le contenu d’un gobelet de fiel dans la bouche ouverte de sa victime hurlant de douleur, le cortège funèbre, avec le prêtre vêtu de noir, les enfants de chœur en noir et blanc et les garçons de ferme et jeunes paysans portant des cierges allumés et marmonnant des prières, s’arrêta. Avec l’encens et l’eau bénite, le prêtre bénit les empreintes sanglantes laissées par la jeune suicidée sur le mur du calvaire et sur la représentation de l’Enfer que lui-même avait peinte, et dit : Ô Prince de l’exil, à qui l’on a fait tort,/ Et qui, vaincu, toujours te redresses plus fort,/ Ô Satan, prends pitié de ma longue misère !
Prix André-Gide de la traduction littéraire franco-allemande (Fondation DVA, Stuttgart), 2000