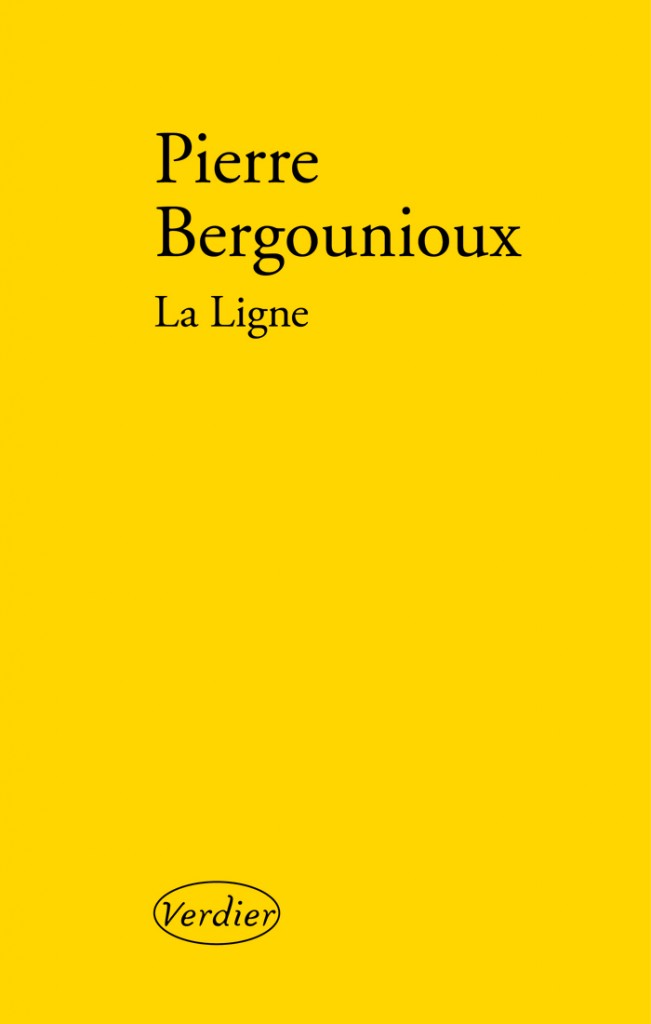
Pierre Bergounioux
La ligne
Collection : Collection jaune
80 pages
10,65 €
Tirage de tête : 39 €
978-2-86432-262-7
mars 1997
L’univers des origines ruisselait de sources, miroitait d’étangs. Des hommes qui m’entouraient partageaient, quoique pour des raisons opposées, le goût de l’eau. Si nous participons à quelque degré du monde extérieur et, par notre ascendance, des âges antérieurs, comment, dans de pareilles conditions, ne pas naître pêcheur ?
La mouche est une pêche entrante, d’eau vive. Quand on a décelé le cercle fugitif qu’un poisson en chasse trace au loin, dans les courants, il faut s’immerger, approcher à bonne portée et lui présenter le simulacre d’insecte en plume de coq de façon qu’il ne puisse douter qu’il a affaire à la réalité. C’est ainsi que je me suis retrouvé, à la fin de la première année, au milieu de la Dordogne, en aval du pont de M. Je concentrais toute mon attention sur l’emplacement limité où il semblait se passer quelque chose tout en avançant vers le milieu de la rivière. Elle peut accuser, à cette hauteur, une centaine de mètres de large et court sur un lit de galets. J’aurais dû me méfier. Mais on n’a que deux yeux et c’est à terre que nous avons nos fondations, notre ancrage. La première des cuissardes s’est remplie d’un seul coup. J’ai noyé la seconde en voulant me dégager et je me suis retrouvé avec l’équivalent, à chaque pied, des boulets qu’on passait, au bagne, aux condamnés. Ce fut la première chose. La seconde – il est d’étranges lenteurs au cœur des pires urgences –, ç’a été de détacher mes regards du point très précis sur lequel je les tenais obstinément fixés, vers la gauche, pour les reporter devant moi. La vision, lorsque prudemment je la ravive et l’étudie à loisir, conserve à vingt-cinq ans de distance sa violence irruptive, déracinante. La Dordogne tout entière se ruait sur moi. Je me découvrais aux prises avec un fleuve, affronté sans préavis et pour de bon à ce qui n’écoute ni ne pardonne – l’eau, l’élément, l’impavide matière –, chassé, à reculons, avec des bottes pleines comme des chaînes aux pieds. Il y avait une dernière chose, et c’est elle qui a éveillé la terreur que nous portons lovée aux tréfonds de notre être. Le pavement de galets que je dévalais malgré moi s’abaissait vers les creux – les « gours » – de trois et quatre mètres de profondeur où la Dordogne aime à paresser, à dormir d’un sommeil qui n’est que feint, entre ses brillantes foucades. On y avait récupéré, sous mes yeux, trois ou quatre ans plus tôt, avec des crochets, les corps d’une famille d’estivants qui s’étaient fiés à ses fossettes, à son babil le long des plages de galets.
C’est curieux. C’est ce jour-là, disputant mètre par mètre le terrain à la rivière, que je me suis su en charge de la vie, avisé que c’est chose grave. Lorsqu’on l’examine à tête reposée, qu’on y pense en toute sûreté, il peut sembler que c’est l’affaire de la matière et non pas vraiment la nôtre puisque nos pensées n’y changent rien, qu’elles sont peut-être sans rapport avec ce qui est et ceci, par contrecoup, sans pouvoir sur ce que nous pensons, sur l’être, quel qu’il soit, que nous sommes. À la seconde où j’ai compris vers quoi j’étais en marche, je me suis senti empli d’une prodigieuse gravité, la même, exactement, que celle qui nous submerge, un jour, devant l’amour, et j’en fus revêtu, occupé jusqu’à ce que, imperceptiblement, le fond, sous moi, se relève, la vie – l’oubli, la possibilité de penser à autre chose, de faire un peu ce que l’on veut, de rêver – me soient rendus.