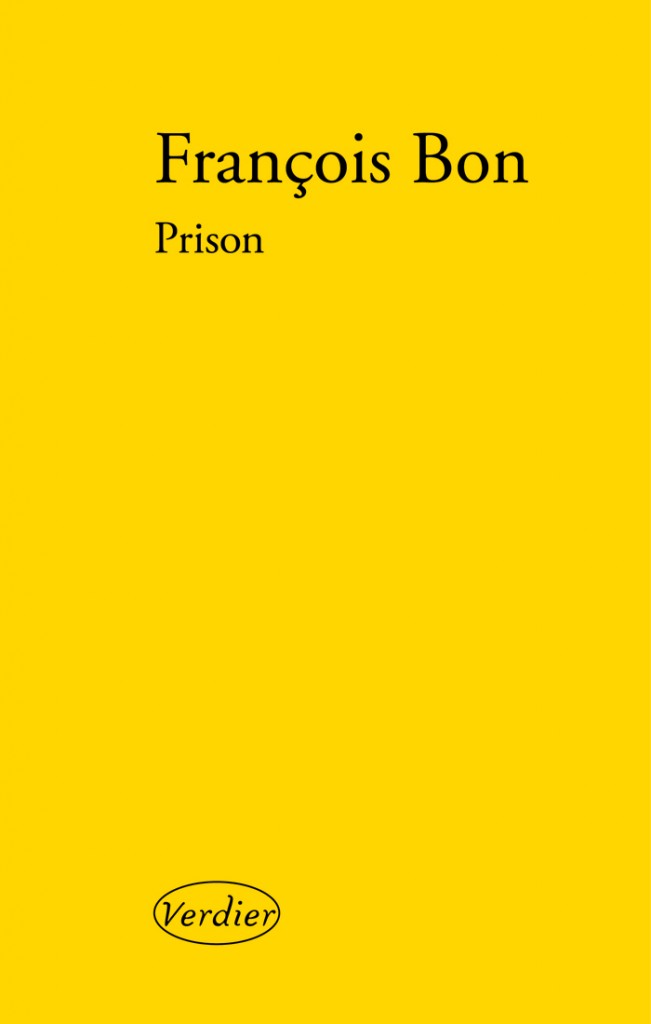
François Bon
Prison
Si Brulin – à peine croisé avant d’être assassiné dans un squat – est la figure en creux qui soutient le récit, elle laisse à d’autres la charge de dire le désarroi et la rage de ceux que notre monde rejette dès l’enfance aux bords des villes, et dont l’une des premières expériences de jeunesse est la prison.
Au regard de ces situations extrêmes, les mots ont-ils pouvoir de forcer un destin trop souvent fixé d’avance ?
Réponses extrêmes elles aussi : « Écrire, ça fait quelque chose à l’intérieur de soi » ; « Car parfois les mots sont sensibles » ; ou « Peut-être que ça ferait sortir mes sentiments mais ma douleur restera en moi. Ce n’est pas vous qui m’aiderez à la quitter ».
Christian, Tignasse, Jean-Claude, Sefia, Ciao : témoignages épars que la fiction resserre en une structure éclatée. Les silhouettes apparaissent, s’estompent et se fondent. Les paroles rugueuses, comme en amont de la langue, sont des voix véritables que l’écrivain, lui aussi aux prises avec elle, nous fait entendre comme un partage.
Car nous ne savons rien de clair, nous errons.
Le mot planté. Le gardien-chef, alors que je sortais, ayant franchi la première porte-sas du bloc et repris ma carte d’identité, juste là devant le portique d’entrée à sonnerie, avant la porte verte à barreaux rectangulaires près du portail pour le passage des fourgons cellulaires : « Et vous avez su que Brulin a été planté ? »
Le mot squat. Non, je ne savais pas, et il a complété par ce qu’il savait : « C’était dans le journal ce matin. Dans un squat, un nommé Tignasse, que nous connaissons aussi. » Brulin, Jean-Claude Brulin je ne savais même pas qu’il avait été libéré et ce serait donc là toute son épitaphe (et pourquoi il me disait ça le gardien-chef, ce n’était pas son habitude de parler du travail autrement que ce qui me concernait seulement : parce que lui aussi donc tout d’un coup ça le dépassait, camouflet mis à leurs propres efforts d’accompagnement comme à me dire : « Tu viens là chaque mardi mais les clés nous-mêmes on n’en dispose pas, toi et tes petites feuilles qu’est-ce que ça compte par rapport à ce qui ainsi nous déborde » et c’est justement dans cette fragilité et la rage aussi qu’on passe cinq mois ensuite à les racler, les mots sous l’épitaphe, quand bien même on n’a pas les clés et qu’on n’aura rien su d’autre, qu’on se croyait guéri d’écrire comme ça sur ce qu’on prend dans la figure comme une claque).
Le gardien-chef a ajouté, et c’était des mots pesés : « Trois jours après nous avoir quittés. Il méritait pas ça, Brulin. »
Le journal Sud Ouest. J’ai marché, il y a le mur gris, où à midi des familles tendent des enfants au haut de leurs bras pour que les mères de très loin les aperçoivent (le bâtiment des femmes est un bâtiment blanc rectangulaire plus petit au pied de l’autre, dominé aussi par le mirador d’angle, entre le mur et la rue où sont des rouleaux de fer barbelé et de gros moutons grisâtres mangeant éternellement l’herbe qui repousse), et ceux des étages renvoient aussi à la rue des cris et appels qu’on déchiffre mal ou même vous sifflent, s’éloignant de la prison on longe un centre commercial abandonné aux rideaux de fer tirés (un ancien Conforama racheté par Intermarché, c’est indiqué sur le permis de construire sur un grand panneau de bois), puis le carrefour avec le bus G desservant Gradignan depuis Bordeaux-Centre, les quatre voies de la rocade sud sous un pont et enfin la ville. C’est à la gare que j’ai acheté le journal et trouvé tout de suite l’article, page 5 en haut à gauche, deux colonnes approximatives (les âges étaient faux et on croyait en dire assez sur chacun en les disant compagnons d’infortune), titre : « Pour un motif futile. »