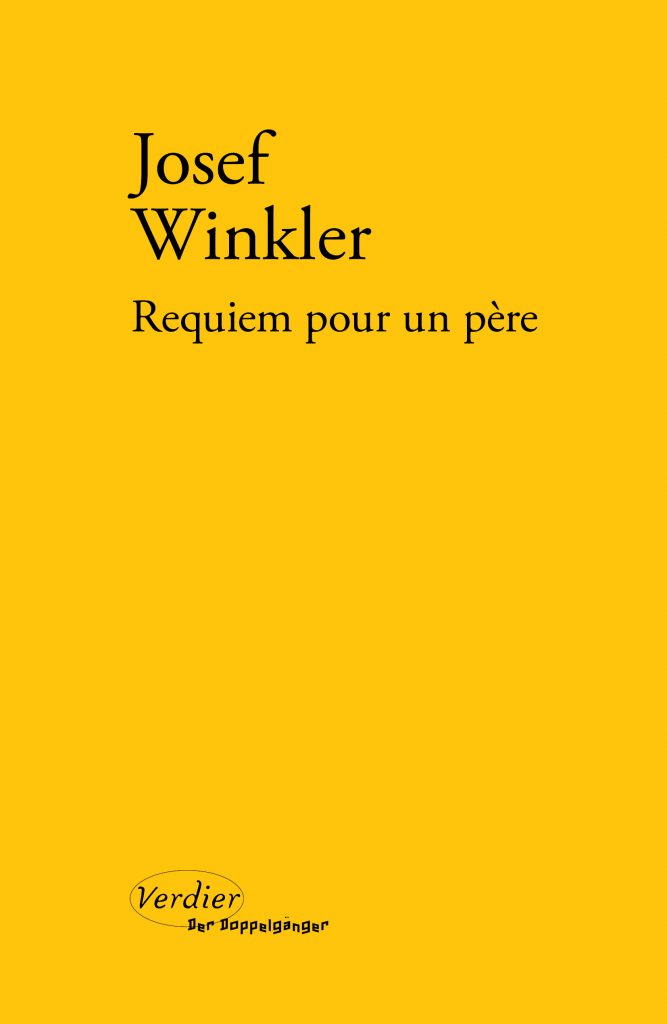
Roman. Traduit de l'allemand (Autriche) par Bernard Banoun
Collection : Der Doppelgänger
144 pages
18,00 €
978-2-86432-711-0
janvier 2013
C’est à Roppongi, un quartier de Tokyo, que Josef Winkler apprend la mort de son père, âgé de 99 ans, dans le village de Carinthie où lui-même est né et dont il a bâti de livre en livre le mythe tragique et funèbre. Ce père qui est sans doute le personnage central de son œuvre lui avait un jour défendu, dans une explosion de colère, de venir à son enterrement : l’éloignement se sera donc chargé d’exaucer son vœu.
Entre le « laboureur de Carinthie » et son fils, l’enfant prodigue qui n’a cessé de partir toujours plus loin, vers l’Italie (Cimetière des oranges amères) ou vers l’Inde (Sur la rive du Gange), il n’y aura donc pas d’adieux. C’est par l’écriture, en onze étapes initiatiques et mémorielles, que l’écrivain entreprend de se réconcilier avec le vieil homme qui, on le devine au fil des pages, n’aura été si impitoyable pour son fils que parce que la vie ne l’a lui-même en rien ménagé.
Ce livre de deuil, qui reprend et magnifie tous les grands thèmes de l’œuvre de Winkler, est aussi un livre d’apaisement. Pour le lecteur qui ne le connaîtrait pas encore, c’est aussi une excellente porte d’entrée dans l’univers particulier de cet écrivain rare.
Sur la photo jaunie des années trente accrochée au mur au-dessus du téléphone beige, mon père est assis sur sa faucheuse neuve tirée par ses deux chevaux et tient les rênes en cuir desséché et cassant. On distingue nettement le moignon de son auriculaire gauche mutilé par une broyeuse à foin alors qu’à l’âge de trois ans, comme il aidait déjà au fenil en plaçant le foin par gerbes dans la machine, il n’avait pas retiré sa main assez vite. La main sanglante où pendait encore le doigt retenu par un lambeau de peau, il avait dégringolé avec son frère cadet l’escalier du fenil pour courir vers sa mère qui, entendant les cris et les pleurs et devinant quelque chose de grave, s’était précipitée hors de la maison. « Jogele, Fingerle weg ! » Petit doigt parti, le Jojo ! criait le grand frère. Il ne resta plus à la mère qu’à prendre les ciseaux pour trancher dans le bout de peau. Assis sur sa faucheuse neuve, il avait l’air satisfait, il n’avait plus à saisir la faux avec les valets pour passer des jours, voire des semaines à faucher des champs entiers à la main, désormais il trônait fièrement sur le siège à trous en acier moulé d’une faucheuse tirée par deux chevaux qui, eux, avaient un nom, l’un s’appelait Fuchs, quant au nom du second je ne me le rappelle plus. Peut-être, me dis-je aujourd’hui lorsque je me rends sur la tombe de mon père à Kamering à la Toussaint ou le jour des Morts et que le cimetière tout entier sent l’odeur des innombrables bougies crépitant dans l’humidité, l’encens et le parfum des chrysanthèmes jaunes et blancs, peut-être que si j’appelais plusieurs fois « Fuchs ! Fuchs ! » il me répondrait depuis la profondeur de sa tombe et me révélerait le nom du second cheval qui tire la faucheuse neuve sur la photo des années trente accrochée au-dessus du téléphone beige dans l’entrée de cette ferme, sa ferme, où lui aussi est né, comme moi, dans la même chambre que moi. C’est son frère, notre oncle Franz, instituteur à Oberdrauburg et photographe amateur, qui l’avait pris en photo avec son Hasselblad. L’oncle Franz, qui avait été SS à Nuremberg pendant la Deuxième Guerre mondiale, assurait toujours, et en particulier quand une fois par an dans le brouillard de la Toussaint ou du jour des Morts les fraternels camarades de guerre se retrouvaient dans leur maison natale avant d’aller au cimetière assister à l’aspersion des tombes de leurs parents et qu’ils descendaient côte à côte la rue du village jusqu’au cimetière pour aller planter dans la terre du tertre funéraire couverte de givre et déjà un peu durcie par le gel quelques grandes et larges bougies couleur coquille d’œuf, quand le prêtre vêtu de violet accompagné des enfants de chœur vêtus eux aussi de violet et de blanc allaient d’une tombe à l’autre avec l’encensoir argenté fumant et le bénitier portatif en cuivre cabossé et que tous les villageois debout devant les caveaux familiaux faisaient attention que le goupillon à poils d’argent ait bien aspergé de quelques gouttes d’eau bénite la terre de la tombe familiale et que les bouffées d’encens aient embrumé les bougies allumées qui crépitaient et les chrysanthèmes jaunes, blancs, et parfois rouges, et quand après cette aspersion des tombes les vétérans remontaient ensemble la poutre verticale du village bâti en forme de croix pour regagner la maison parentale où ils ôtaient leurs manteaux saint-hubert en loden vert sur lesquels étaient tombées et restées collées quelques gouttes de cire des bougies allumées qu’ils avaient manipulées, et que, ayant pris place à table, ils sirotaient leur infusion de cynorrhodon brûlante dans laquelle ils se versaient de l’eau-de-vie maison et commençaient le récit de leurs aventures de guerre, toujours l’oncle Franz, sans que ses frères ni son beau-frère lui aient rien demandé, assurait qu’à Nuremberg il avait passé son temps assis à un bureau et n’avait rien fait du tout. « Moi, à Nuremberg, j’étais assis à un bureau et je n’ai rien fait du tout ! », telle était la formule immuable que nous entendîmes d’année en année deux décennies durant, en particulier à la Toussaint ou le jour des Morts quand il venait d’Oberdrauburg dans sa voiture anglaise dans le toit de laquelle il avait fait percer une fenêtre si bien que ce n’était plus une voiture anglaise d’origine, comme il le déplorait souvent, et qu’il tirait de la poche de son veston un chocolat Suchard mauve et nous l’agitait sous le nez sans jamais oublier de demander d’un air sévère : « Et qu’est-ce qu’on dit ? — Merci, tonton Franz ! » Il était trop radin pour une grande tablette, il apportait toujours des petites tablettes, pas une seule fois une grande. Les chocolats Suchard étaient mauves et carrés, les Bensdorp bleus en barre. Lorsqu’après des années à collectionner des centaines de nœuds d’emballages bleus nous les envoyâmes à l’entreprise Bensdorp, quelques semaines plus tard, à notre grande surprise, le facteur livra un petit paquet qui contenait vingt tablettes de chocolat Bensdorp.