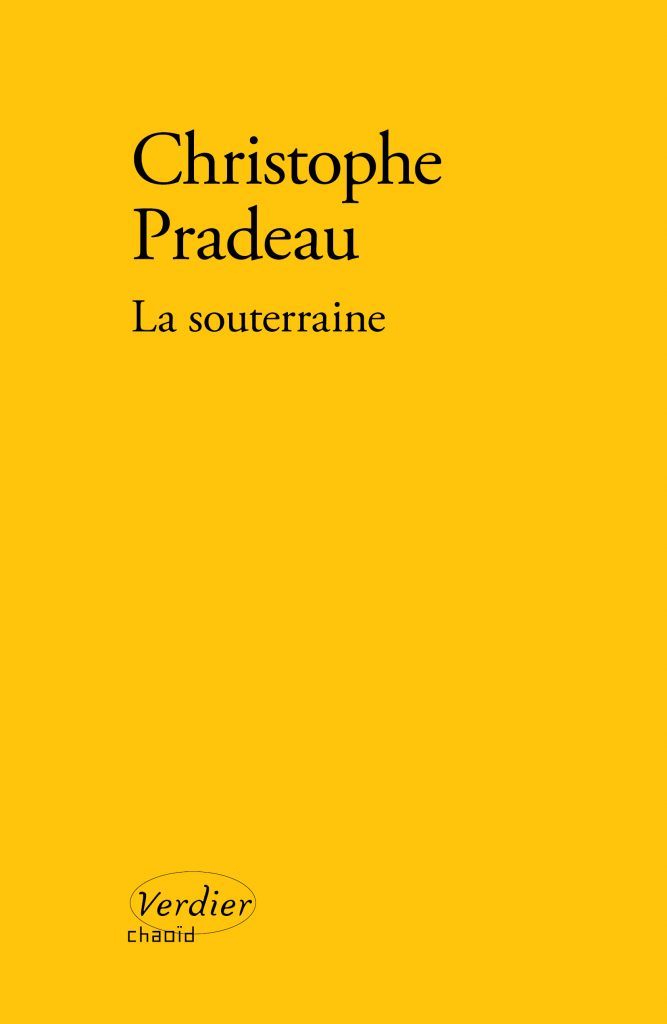
Christophe Pradeau
La souterraine
Collection : Chaoïd
160 pages
12,17 €
978-2-86432-445-4
septembre 2005
La Souterraine peut se lire comme l’accomplissement d’une promesse : « Nous avions juré de nous rappeler jusqu’à l’heure de notre mort – c’était la formule que j’avais répétée après elle – ce que ça fait d’être un enfant. »
Sur le chemin qui les ramène chaque dimanche de Lubersac, le village de la grand-mère, vers cette ville qui est la leur et « dont le nom est secret », Laurence et son frère, le narrateur, ont inventé, pour conjurer l’ennui et la nausée qui les assaillent en voiture, un jeu qui consiste à s’emparer de chaque détail du paysage en lui attribuant une histoire.
C’est ainsi que l’enfance se protège et s’oriente dans le brouillard des routes, de la peur, de la famille, de la géographie et de l’Histoire. Un soir d’hiver, sur l’écran de la vitre, ce brouillard que fend la voiture devient pour le frère et la sœur l’épaisseur même du langage. « S’engouffrer dans les mots », comme tout y invite dès lors, c’est explorer « l’intimité insituable des rêves » au risque de se perdre en retour dans ce qu’ils ont pour fonction de conjurer.
Le moment venait où les récits finissaient par s’épuiser. Le silence se faisait. Quelqu’un confessait sa fatigue. Nous montions nous coucher, en veillant à ne pas faire de bruit pour ne pas risquer de réveiller ceux qui dormaient déjà. À peine Maman avait-elle éteint la lumière et quitté la pièce que Laurence me rejoignait sous les draps et me redisait sa certitude que c’était des ptérodactyles. Elle était persuadée que le passé tout entier était encore là, au fond de l’étang de Cherchaux, depuis les monstres préhistoriques jusqu’à la petite chienne de Mamie, Quinette, morte un soir d’hiver, écrasée par un chauffard. C’était là que l’on allait quand on mourait. Il suffirait d’avoir le cran d’y descendre pour retrouver tous ceux qu’avait emportés depuis le commencement des temps la navette des nuits et des jours. Ils demeurent tous ensemble sur les rives d’une mer souterraine aux eaux lourdes, luminescentes, dont la houle irrite les ténèbres de lueurs, du brasillement, des saccades de ces noctiluques qui venaient danser autour des caravelles, inquiétant l’œil des Grands Découvreurs. Du jour où l’oncle Raymond avait entrepris de nous apprendre à regarder le ciel, le prestige de l’étang de Cherchaux avait passé toute mesure. Rien n’avait retenu l’attention de Laurence comme le Big Crunch incidemment évoqué un soir, alors que nous admirions la Voie lactée et qu’elle nous apparaissait emportée par le mouvement d’un grand départ. Que l’on dût considérer comme probable un reflux de l’univers nous avait coupé le souffle. De comparaison en métaphore, à force de questions et de réponses embarrassées, le Big Crunch était apparu à Laurence comme l’instant où il faudrait qu’enfin le monde se débonde. Il serait aspiré tout entier. Rien n’échapperait : montagnes, mers et forêts, soleils, lunes et constellations ; l’univers, ses milliards de milliards de mondes, viendrait en tournoyant s’engouffrer, en un immense effondrement de formes, dans l’étroit goulot de l’étang de Cherchaux.