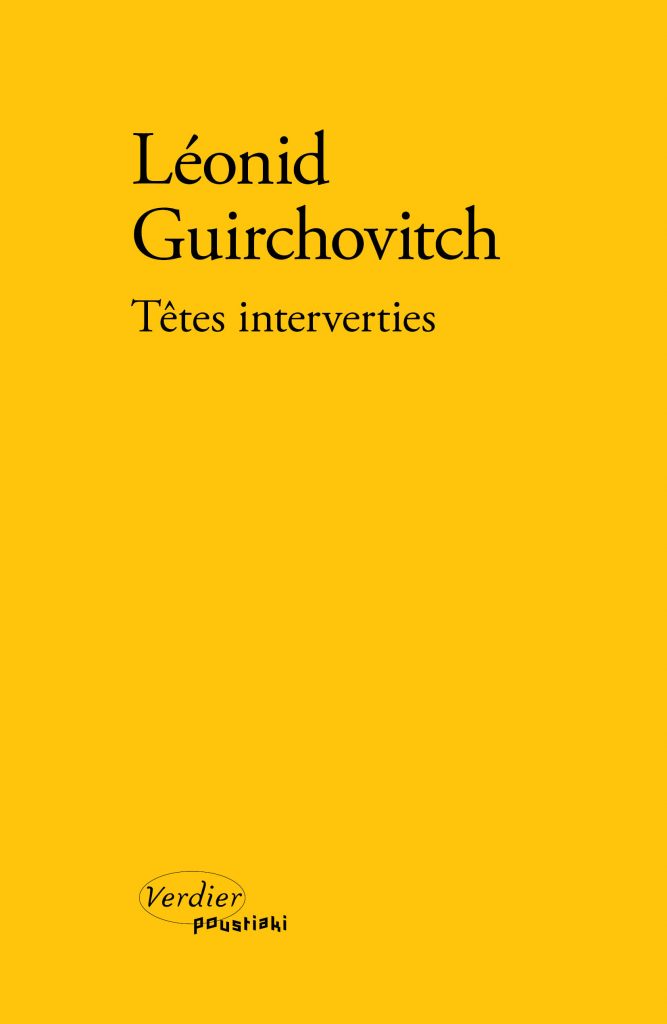
Léonid Guirchovitch
Têtes interverties
Roman. Traduit du russe par Luba Jurgenson
Collection : Poustiaki
288 pages
22,82 €
978-2-86432-492-8
février 2007
Têtes interverties est un roman policier. Au début des années quatre-vingt, après une année passée en Israël, le narrateur, un jeune violoniste russe originaire de Kharkov, est engagé comme co-soliste dans l’orchestre d’opéra d’une grande ville d’Allemagne de l’Ouest, Zickhorn. Par un concours de circonstances extraordinaire, il découvre que son grand-père, violoniste également, que sa famille croyait fusillé par les Allemands en 1941, a travaillé dans l’orchestre de Rotmund en 1943, protégé par le grand compositeur nazi Gottlieb Kunze. Les recherches qu’il tente auprès des proches de Kunze l’entraîneront dans un labyrinthe où des révélations l’attendent à chaque pas, notamment sur sa propre famille, tout comme de nouvelles énigmes.
Nous recommanderons au lecteur de ne pas chercher Zickhorn sur la carte. Il serait également inutile de se plonger dans des encyclopédies en quête de la biographie de Kunze, malgré la réalité convaincante de ce personnage enraciné dans la vie musicale sous le IIIe Reich et dans le destin de l’Europe, ami de Goebbels, rival de Strauss, cible des critiques de Stravinski, auteur de l’opéra Têtes interverties auquel Thomas Mann empruntera son titre pour un de ses livres.
Sous cette forme captivante qui permet plusieurs niveaux de lecture, l’auteur, lui-même premier violon à l’opéra de Hanovre enchevêtre sa méditation sur l’exil et la question des origines à l’histoire de la culture européenne et, tout particulièrement, de la musique.
Elle avait absolument tort. Je ne ressentais, à l’égard de l’Allemagne, rien de tout cela. L’attitude d’un Juif à l’égard de l’Allemagne, d’un Arménien à l’égard de la Turquie, du capitaine Nemo envers l’Angleterre, je ne l’avais qu’à l’égard d’un pays. Celui qui avait abattu sa propre population comme du bétail atteint de la fièvre aphteuse. J’avais pour obligation morale une « haine sainte » envers les nazis (un euphémisme pour désigner les Allemands, comme « sioniste » en est un pour désigner les Juifs qu’il convient également de haïr). Tout l’art soviétique, toute la religion national-communiste avait œuvré dans ce sens, avec le soutien des « classiques » russes qui, depuis des temps immémoriaux, n’appréciaient pas « l’Allemand ». Dans mon cas, on avait obtenu le résultat inverse : Hitler m’apparaissait comme un « petit tyran de l’époque stalinienne », quant à Tolstoï ou à Tchékhov qui, à en croire nos manuels, avaient rêvé du communisme toute leur vie (dans leur inconscient), je leur préférais L’Aéroport d’Arthur Hailey.
Mon grand-père Juzef m’aurait compris : deux années de vie à Kharkov avaient transformé ce libéral en un anticommuniste chauffé à blanc, au point qu’il avait déclaré, en dépit de sa vieille germanophobie qui datait de l’époque de Vienne : « Staline est pire que les Allemands. Une fois déjà, j’ai tout laissé tomber comme un imbécile et j’ai fui Varsovie. À présent, je reste. Une chose est sûre, c’est que ça ne pourra pas être pire. » Maman me l’avait raconté, et chez le glacier d’Odessa, elle l’avait répété devant Essia qui secouait la tête, les yeux fermés, refusant de le croire, elle aussi.
J’ajouterai à cela que je devais haïr l’Allemagne non seulement au nom des vingt millions de soldats de l’armée Rouge qui avaient péri « au pays des bouleaux » ; non seulement par solidarité pour ceux qui portaient en eux leur propre Yad Vachem et dont le cœur était brûlé par les cendres d’Auschwitz. Paradoxalement, les Allemands eux-mêmes m’enjoignaient de les haïr. Ils attendaient de moi de la haine, ils me collaient leur stéréotype de Juif russe qui ne peut que voir un assassin potentiel en chacun d’eux. Certains me manifestaient une tendresse débordante, tout en se fustigeant eux-mêmes. D’autres, au contraire, pour la même raison, étaient prêts à vous cogner dessus à titre préventif, ce qui était lourd de conséquences, surtout s’il s’agissait de vos supérieurs hiérarchiques. Et pourtant, je les préférais. À la différence des « sympathisants », méfiants et toujours malvenus, ils se laissaient circonvenir, il suffisait de les convaincre qu’ils s’étaient trompés à votre égard. Ce n’était pas difficile. D’abord, ça les arrangeait. Et puis, je réussissais à trouver un ton juste, « académique ». La culture allemande s’était constituée bien avant l’État allemand. Lorsqu’une très grande culture, surtout une grande culture romantique, une grande culture musicale, se retrouve à la base d’un État qui manque de maturité, celui-ci ne parvient pas à la maîtriser. Elle devient un mode d’emploi. Et comme le caractère allemand a la particularité, heureuse et malheureuse à la fois, d’aller jusqu’au bout en toutes choses, en bien comme en mal (les Russes se flattent également d’être ainsi), il est arrivé ce qui est arrivé.
Transfuge, mars 2007, par Rachel Nef
La Libre Belgique, 14 septembre 2007, par Jacques Frank
Chronic’Art, mai 2007, par Morgan Boëdec
Le Soir, 27 avril 2007, par Marc Henry
La Liberté, samedi 31 mars 2007, par Alain Favarger
L’Humanité, 29 mars 2007, par Alain Nicolas
Le Magazine littéraire, mars 2007, par Alexandre Sumpf
Les Inrockuptibles, 20 février 2007, par Judith Steiner
Livres hebdo, 9 février 2007, par Jean-Maurice de Montremy
« Des mots de minuit », chronique de Minh Tran Huy, France 2, mercredi 14 mars 2007